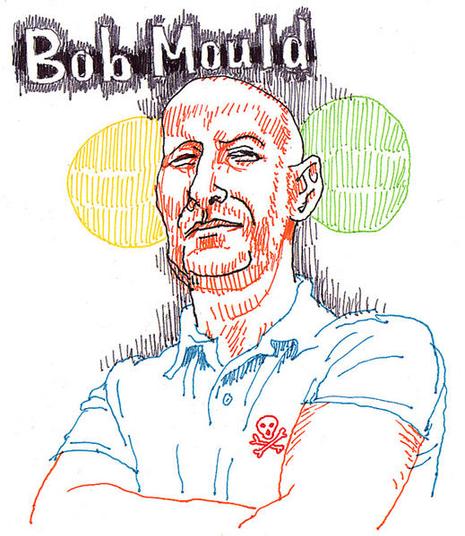 Bob Mould, par Thibault Balahy
En Normandie, dans une petite ville proche d'une plus grande, à Barentin près de Rouen, à Montivilliers près du Havre, j'ai mes artistes fétiches : Paul McCartney, Kate Bush, et Bob Mould.
(Plus au Sud, franchies la Seine et même la Loire, je passe aux Pet Shop Boys.) Au bar-presse-pmu local, si la radio diffuse une chanson d'auteur (souvent, Losing My Religion de REM), la
salle et le comptoir font l'inverse de s'animer : chacun s'y fige en sa posture mythologique. Le néon extérieur, grenadine ou turquoise, qui teinte le haut de la vitre même à midi, fait son
office de beauté. Dehors, sous le ciel blanc cassé, passent des jeunes gens vêtus de noir, maquillés comme ma fiancée, encore et encore, depuis les années 8O. (Les jeunes gens de la plus grande
ville semblent des New-Yorkais par comparaison.) J'écoute District Line, le dernier Bob Mould, et je pourrais être ailleurs, je pourrais être un autre, toujours surveillant la baie
vitrée, rêvant à la jeunesse comme l'extrême-gauche invente le peuple.
Au début des années 8O, Bob Mould appartenait au trio hardcore (hardcore, speed-core, punk, pop, jazz, et gay) Hüsker Dü, dont l'album Zen Arcade (1984) n'est pas moins important que les
London Sessions vol.2 de Thelonious Monk ou le Winterreise de Schubert par Britten et Pears. Mais une partie de la grandeur de Bob Mould consiste à n'avoir jamais recherché ce
genre de légitimité culturelle. Regardez plutôt ceci. C'est l'extrait d'un
concert de trois ans antérieur à ce chef d'œuvre. La composition y est moins complexe, le groupe débute encore, je veux juste attirer votre attention sur un étrange effet : la musique ne
semble pas émaner d'eux. Et ce n'est pas (ou pas seulement) un problème d'étalonnage de la vidéo, mais lié au caractère classiquement prométhéen de ce qui se joue là. Ils sont au cœur impossible
du feu. Ils ne l'ont pas produit, ils l'ont volé (aux Ramones, en l'occurrence). Et ils le paient en direct, pour être plus précis : ils le paient en live. Le batteur-chanteur
semble aussi peu responsable de son mouvement qu'un type qui se masturbe ; il est agi. Et comme il est intelligent, il le signifie : son regard semble dire, voyez ce que je suis obligé
de faire, quelqu'un viendra-t-il me sauver, personne ? alors je continue. Un peu comme votre voisin, en train de porter un meuble lourd, qui sourit pour vous dire qu'il a conscience du
spectacle qu'il donne. Il y a dans le regard de Grant Hart ce laconisme légèrement moqueur et retourné contre soi. La musique les englobe, lui et Greg Norton et Bob Mould, plus qu'ils ne la
produisent. Elle est l'air qu'ils respirent, le feu qui abolit la frontière corporelle, intérieur/extérieur. Quelques années plus tard, Bob Mould (guitare + chant sur 50% des autres titres)
emploiera la métaphore de la flèche : « J'envoyais des flèches dans le public, sauf que je continuais d'en recevoir en retour, bien après le concert, la nuit qui
suivait. » Cette flèche ne contredit pas l'image : le trait traverse l'espace en feu. Cela ne s'arrêtera jamais. Bob Mould, c'est superbe sur cette vidéo, joue peu :
d'abord il se marre, avec son physique du cousin qui a fait math sup / math spé, en se regardant dans les yeux avec le public. Puis il fait la police. Il a face à lui de possibles dégénérés
totaux, la scène est particulièrement basse et non protégée, mais depuis le cœur du feu volé au Ramones, Bob a vu quelque chose : « Ça, c'est la dernière fois. » Et comme
l'incriminé n'a pas bien compris, il le lui redit d'un geste plus net encore : non. C'est non. Et moi, spectateur de cette vidéo de 1981, je ne comprends pas pourquoi le public ne prolonge
pas l'orgie dans le sang, et n'investit pas la scène pour les tuer tout simplement. La musique (le son, l'espace, le feu) ne cesserait pas. Du moins, la « musique » est alors le
processus consistant à le faire croire.
Vingt-sept ans plus tard. Une voix catastrophique, couleur jaune, presque Bashung dans ses incurvations lisses, une voix fausse à force de s'être éloignée de la joie, ouvre District
Line ainsi :
Please listen to me... and don't disagree.
Mots malades... Cette supplique me met tellement mal à l'aise que je voudrais mal la traduire, me montrer bien maladroit : S'il te plaît écoute-moi... Et n'entre pas en
désaccord... Voilà, ainsi, c'est suffisamment gros de honte, de mauvais rapport à soi. Ne tombe pas pas d'accord avec moi, s'il te plaît, je t'en supplie. Oh là là.
On le sait, le fond de la sensibilité de Bob Mould est une grande souffrance personnelle. Il a toujours écrit pour échapper à l'hôpital psychiatrique. Cette souffrance traverse, égale, les
différentes étapes de sa vie, mais c'est justement de la maintenir égale, où elle ne demandait qu'à empirer, qui est l'exploit. La mutation, Bob Mould y a bien été forcé pour égarer son ennemi
dans la glace : en 1988 par exemple, quand Hüsker Dü se sépare dans une apocalypse de drogue, d'alcool et de détestation avec Grant Hart, et que Mould s'enferme à la campagne, revient en
solo, fonde un groupe, signe un quasi-tube en faveur du mariage homo (If I can't change your mind) puis se passionne pour l'electronica et recommence tout à zéro en 2002 avec des
machines, non sans avoir arrêté un temps la carrière pour exercer la profession de scénariste de matchs de catch. Racontée ainsi, et bien que ses composants soient exacts, l'histoire n'est qu'une
fable.
C'est ce que va nous expliquer District Line : en quoi l'histoire, même vraie, n'est qu'une fable. Simplement il ne va pas falloir que nous entrions en désaccord avec lui, il nous
le demande d'emblée. Ce n'est pas à nous de savoir à sa place. Nous devons faire confiance à l'auteur, appliquer la politique des songwriters. Ce que fait District Line, c'est
rejouer, avec discrétion et patience, le processus de mutation perpétuelle par quoi le patron a échappé au suicide. L'opération éclate au grand jour à la septième plage, Shelter
Me : une electronica pas de la toute dernière génération, mais ne jouant pas non plus la carte rétro, une electronica éternelle et quasi neutre, apparaît. A la seconde écoute de
l'album, nous découvrirons que cette subversion de la rythmique jouait dès la première plage, avec un travail assez fin de mixage sur la batterie. Ce remplacement progressif d'un son par un
autre, soudain accéléré, procure le vertige d'un malade qui se toucherait le corps en hurlant « Mes cellules ! Mes cellules ! » Quelque chose s'est passé dans le code
génétique de la musique, et ce doute sur la nature de ce qu'on entend, invite à partager le doute existentiel de celui qui produit ce son. D'ailleurs la voix (d'abord jaune, puis enrouée, puis
excessive selon différents modes) est maintenant traitée au vocoder ou quelque équivalent contemporain, sans les excès infligés à celle de Cher sur Believe, tube de l'été 1999, mais
justement : de façon moins souriante, moins bonasse. L'on croit que le dernier tiers de l'album va dérouler ce scénario d'une mutation trouvant sa fin ni heureuse ni malheureuse dans un
nouveau corps bionique - il n'en est rien : voici qu'apparaît une petite descente de cordes, à la Eleanor Rigby, et présentée d'ailleurs de la même manière : comme
incidente. Le mutant poursuit son processus, hors de sa propre portée.
Les chansons de Bob Mould ressemblent une série de signaux, envoyés par une intelligence depuis sa lutte pour la survie. Une intelligence qui sait qu'elle ne peut pas compter sur le corps très
longtemps, et qui ne renonce pas à chercher son éternité, via l'électricité qu'elle n'a pas inventé, via le feu qu'elle a dû voler, via cette électronique apprise sur
le tard. Et sans que celui dont le corps héberge cette intelligence puisse jamais répondre, pendant toutes ces années, à la question « qui suis-je ? » autrement que par des actes,
toujours à renouveler, comme un Moloch à nourrir. Pour cette raison, l'album s'achève sur une chanson pouvant évoquer la première, à ceci près que la mélodie s'y présente en structure ouverte,
attentive, en vigie. Un peu comme dans I won't share you, conclusive à l'œuvre des Smiths, la chanson semble se tenir aux avants-postes d'elle-même. C'est alors, dans ce mouvement au
large, que les premiers mots du disque se rappellent à notre souvenir : « Please listen to me, and don't disagree... » Je peux maintenant traduire cette
phrase : Attends pour me juger, pour juger ma parole, car ma parole est construite. Je ne me serais pas permis de te parler si je n'avais auparavant construit ma parole. Je suis sûr de ma
parole, et j'ai besoin de ta confiance même si tu penses que par le passé ta confiance a été trahie. Les raisons pour lesquelles tu penses que ta confiance a été trahie sont les mêmes que celles
pour lesquelles je tiens ici à prendre la parole. Oui, ma parole se fonde sur un accord profond avec les raisons qui pourraient te pousser à te méfier de moi. S'il te plaît, ne dis pas que tu
n'es pas d'accord, parce que ce que je veux te dire avant tout, c'est que moi, je suis d'accord avec toi.
Bob Mould est bientôt en tournée européenne. Dates en Angleterre et à Paris fin mai. (Calendrier.)
Un morceau par album est en écoute ici.
On a Good Day fait désormais relâche le week-end. Vous retrouvez Guillaume lundi avec Old Time Relijun, accompagné
d'un dessin de François Matton.
Quant à moi, je vous retrouve vendredi 2 mai avec Strangeways, Here We Come, des Smiths.
Bob Mould, par Thibault Balahy
En Normandie, dans une petite ville proche d'une plus grande, à Barentin près de Rouen, à Montivilliers près du Havre, j'ai mes artistes fétiches : Paul McCartney, Kate Bush, et Bob Mould.
(Plus au Sud, franchies la Seine et même la Loire, je passe aux Pet Shop Boys.) Au bar-presse-pmu local, si la radio diffuse une chanson d'auteur (souvent, Losing My Religion de REM), la
salle et le comptoir font l'inverse de s'animer : chacun s'y fige en sa posture mythologique. Le néon extérieur, grenadine ou turquoise, qui teinte le haut de la vitre même à midi, fait son
office de beauté. Dehors, sous le ciel blanc cassé, passent des jeunes gens vêtus de noir, maquillés comme ma fiancée, encore et encore, depuis les années 8O. (Les jeunes gens de la plus grande
ville semblent des New-Yorkais par comparaison.) J'écoute District Line, le dernier Bob Mould, et je pourrais être ailleurs, je pourrais être un autre, toujours surveillant la baie
vitrée, rêvant à la jeunesse comme l'extrême-gauche invente le peuple.
Au début des années 8O, Bob Mould appartenait au trio hardcore (hardcore, speed-core, punk, pop, jazz, et gay) Hüsker Dü, dont l'album Zen Arcade (1984) n'est pas moins important que les
London Sessions vol.2 de Thelonious Monk ou le Winterreise de Schubert par Britten et Pears. Mais une partie de la grandeur de Bob Mould consiste à n'avoir jamais recherché ce
genre de légitimité culturelle. Regardez plutôt ceci. C'est l'extrait d'un
concert de trois ans antérieur à ce chef d'œuvre. La composition y est moins complexe, le groupe débute encore, je veux juste attirer votre attention sur un étrange effet : la musique ne
semble pas émaner d'eux. Et ce n'est pas (ou pas seulement) un problème d'étalonnage de la vidéo, mais lié au caractère classiquement prométhéen de ce qui se joue là. Ils sont au cœur impossible
du feu. Ils ne l'ont pas produit, ils l'ont volé (aux Ramones, en l'occurrence). Et ils le paient en direct, pour être plus précis : ils le paient en live. Le batteur-chanteur
semble aussi peu responsable de son mouvement qu'un type qui se masturbe ; il est agi. Et comme il est intelligent, il le signifie : son regard semble dire, voyez ce que je suis obligé
de faire, quelqu'un viendra-t-il me sauver, personne ? alors je continue. Un peu comme votre voisin, en train de porter un meuble lourd, qui sourit pour vous dire qu'il a conscience du
spectacle qu'il donne. Il y a dans le regard de Grant Hart ce laconisme légèrement moqueur et retourné contre soi. La musique les englobe, lui et Greg Norton et Bob Mould, plus qu'ils ne la
produisent. Elle est l'air qu'ils respirent, le feu qui abolit la frontière corporelle, intérieur/extérieur. Quelques années plus tard, Bob Mould (guitare + chant sur 50% des autres titres)
emploiera la métaphore de la flèche : « J'envoyais des flèches dans le public, sauf que je continuais d'en recevoir en retour, bien après le concert, la nuit qui
suivait. » Cette flèche ne contredit pas l'image : le trait traverse l'espace en feu. Cela ne s'arrêtera jamais. Bob Mould, c'est superbe sur cette vidéo, joue peu :
d'abord il se marre, avec son physique du cousin qui a fait math sup / math spé, en se regardant dans les yeux avec le public. Puis il fait la police. Il a face à lui de possibles dégénérés
totaux, la scène est particulièrement basse et non protégée, mais depuis le cœur du feu volé au Ramones, Bob a vu quelque chose : « Ça, c'est la dernière fois. » Et comme
l'incriminé n'a pas bien compris, il le lui redit d'un geste plus net encore : non. C'est non. Et moi, spectateur de cette vidéo de 1981, je ne comprends pas pourquoi le public ne prolonge
pas l'orgie dans le sang, et n'investit pas la scène pour les tuer tout simplement. La musique (le son, l'espace, le feu) ne cesserait pas. Du moins, la « musique » est alors le
processus consistant à le faire croire.
Vingt-sept ans plus tard. Une voix catastrophique, couleur jaune, presque Bashung dans ses incurvations lisses, une voix fausse à force de s'être éloignée de la joie, ouvre District
Line ainsi :
Please listen to me... and don't disagree.
Mots malades... Cette supplique me met tellement mal à l'aise que je voudrais mal la traduire, me montrer bien maladroit : S'il te plaît écoute-moi... Et n'entre pas en
désaccord... Voilà, ainsi, c'est suffisamment gros de honte, de mauvais rapport à soi. Ne tombe pas pas d'accord avec moi, s'il te plaît, je t'en supplie. Oh là là.
On le sait, le fond de la sensibilité de Bob Mould est une grande souffrance personnelle. Il a toujours écrit pour échapper à l'hôpital psychiatrique. Cette souffrance traverse, égale, les
différentes étapes de sa vie, mais c'est justement de la maintenir égale, où elle ne demandait qu'à empirer, qui est l'exploit. La mutation, Bob Mould y a bien été forcé pour égarer son ennemi
dans la glace : en 1988 par exemple, quand Hüsker Dü se sépare dans une apocalypse de drogue, d'alcool et de détestation avec Grant Hart, et que Mould s'enferme à la campagne, revient en
solo, fonde un groupe, signe un quasi-tube en faveur du mariage homo (If I can't change your mind) puis se passionne pour l'electronica et recommence tout à zéro en 2002 avec des
machines, non sans avoir arrêté un temps la carrière pour exercer la profession de scénariste de matchs de catch. Racontée ainsi, et bien que ses composants soient exacts, l'histoire n'est qu'une
fable.
C'est ce que va nous expliquer District Line : en quoi l'histoire, même vraie, n'est qu'une fable. Simplement il ne va pas falloir que nous entrions en désaccord avec lui, il nous
le demande d'emblée. Ce n'est pas à nous de savoir à sa place. Nous devons faire confiance à l'auteur, appliquer la politique des songwriters. Ce que fait District Line, c'est
rejouer, avec discrétion et patience, le processus de mutation perpétuelle par quoi le patron a échappé au suicide. L'opération éclate au grand jour à la septième plage, Shelter
Me : une electronica pas de la toute dernière génération, mais ne jouant pas non plus la carte rétro, une electronica éternelle et quasi neutre, apparaît. A la seconde écoute de
l'album, nous découvrirons que cette subversion de la rythmique jouait dès la première plage, avec un travail assez fin de mixage sur la batterie. Ce remplacement progressif d'un son par un
autre, soudain accéléré, procure le vertige d'un malade qui se toucherait le corps en hurlant « Mes cellules ! Mes cellules ! » Quelque chose s'est passé dans le code
génétique de la musique, et ce doute sur la nature de ce qu'on entend, invite à partager le doute existentiel de celui qui produit ce son. D'ailleurs la voix (d'abord jaune, puis enrouée, puis
excessive selon différents modes) est maintenant traitée au vocoder ou quelque équivalent contemporain, sans les excès infligés à celle de Cher sur Believe, tube de l'été 1999, mais
justement : de façon moins souriante, moins bonasse. L'on croit que le dernier tiers de l'album va dérouler ce scénario d'une mutation trouvant sa fin ni heureuse ni malheureuse dans un
nouveau corps bionique - il n'en est rien : voici qu'apparaît une petite descente de cordes, à la Eleanor Rigby, et présentée d'ailleurs de la même manière : comme
incidente. Le mutant poursuit son processus, hors de sa propre portée.
Les chansons de Bob Mould ressemblent une série de signaux, envoyés par une intelligence depuis sa lutte pour la survie. Une intelligence qui sait qu'elle ne peut pas compter sur le corps très
longtemps, et qui ne renonce pas à chercher son éternité, via l'électricité qu'elle n'a pas inventé, via le feu qu'elle a dû voler, via cette électronique apprise sur
le tard. Et sans que celui dont le corps héberge cette intelligence puisse jamais répondre, pendant toutes ces années, à la question « qui suis-je ? » autrement que par des actes,
toujours à renouveler, comme un Moloch à nourrir. Pour cette raison, l'album s'achève sur une chanson pouvant évoquer la première, à ceci près que la mélodie s'y présente en structure ouverte,
attentive, en vigie. Un peu comme dans I won't share you, conclusive à l'œuvre des Smiths, la chanson semble se tenir aux avants-postes d'elle-même. C'est alors, dans ce mouvement au
large, que les premiers mots du disque se rappellent à notre souvenir : « Please listen to me, and don't disagree... » Je peux maintenant traduire cette
phrase : Attends pour me juger, pour juger ma parole, car ma parole est construite. Je ne me serais pas permis de te parler si je n'avais auparavant construit ma parole. Je suis sûr de ma
parole, et j'ai besoin de ta confiance même si tu penses que par le passé ta confiance a été trahie. Les raisons pour lesquelles tu penses que ta confiance a été trahie sont les mêmes que celles
pour lesquelles je tiens ici à prendre la parole. Oui, ma parole se fonde sur un accord profond avec les raisons qui pourraient te pousser à te méfier de moi. S'il te plaît, ne dis pas que tu
n'es pas d'accord, parce que ce que je veux te dire avant tout, c'est que moi, je suis d'accord avec toi.
Bob Mould est bientôt en tournée européenne. Dates en Angleterre et à Paris fin mai. (Calendrier.)
Un morceau par album est en écoute ici.
On a Good Day fait désormais relâche le week-end. Vous retrouvez Guillaume lundi avec Old Time Relijun, accompagné
d'un dessin de François Matton.
Quant à moi, je vous retrouve vendredi 2 mai avec Strangeways, Here We Come, des Smiths.
Magazine Culture
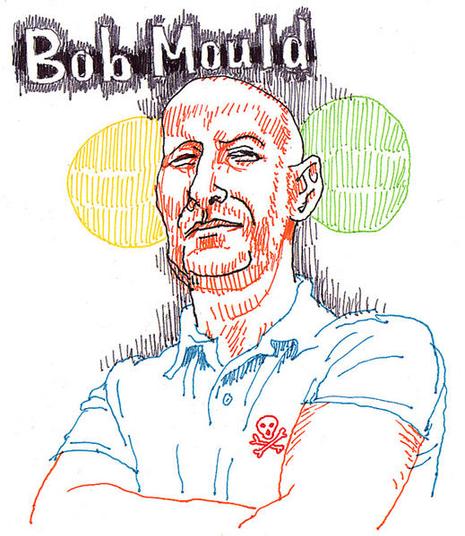 Bob Mould, par Thibault Balahy
En Normandie, dans une petite ville proche d'une plus grande, à Barentin près de Rouen, à Montivilliers près du Havre, j'ai mes artistes fétiches : Paul McCartney, Kate Bush, et Bob Mould.
(Plus au Sud, franchies la Seine et même la Loire, je passe aux Pet Shop Boys.) Au bar-presse-pmu local, si la radio diffuse une chanson d'auteur (souvent, Losing My Religion de REM), la
salle et le comptoir font l'inverse de s'animer : chacun s'y fige en sa posture mythologique. Le néon extérieur, grenadine ou turquoise, qui teinte le haut de la vitre même à midi, fait son
office de beauté. Dehors, sous le ciel blanc cassé, passent des jeunes gens vêtus de noir, maquillés comme ma fiancée, encore et encore, depuis les années 8O. (Les jeunes gens de la plus grande
ville semblent des New-Yorkais par comparaison.) J'écoute District Line, le dernier Bob Mould, et je pourrais être ailleurs, je pourrais être un autre, toujours surveillant la baie
vitrée, rêvant à la jeunesse comme l'extrême-gauche invente le peuple.
Au début des années 8O, Bob Mould appartenait au trio hardcore (hardcore, speed-core, punk, pop, jazz, et gay) Hüsker Dü, dont l'album Zen Arcade (1984) n'est pas moins important que les
London Sessions vol.2 de Thelonious Monk ou le Winterreise de Schubert par Britten et Pears. Mais une partie de la grandeur de Bob Mould consiste à n'avoir jamais recherché ce
genre de légitimité culturelle. Regardez plutôt ceci. C'est l'extrait d'un
concert de trois ans antérieur à ce chef d'œuvre. La composition y est moins complexe, le groupe débute encore, je veux juste attirer votre attention sur un étrange effet : la musique ne
semble pas émaner d'eux. Et ce n'est pas (ou pas seulement) un problème d'étalonnage de la vidéo, mais lié au caractère classiquement prométhéen de ce qui se joue là. Ils sont au cœur impossible
du feu. Ils ne l'ont pas produit, ils l'ont volé (aux Ramones, en l'occurrence). Et ils le paient en direct, pour être plus précis : ils le paient en live. Le batteur-chanteur
semble aussi peu responsable de son mouvement qu'un type qui se masturbe ; il est agi. Et comme il est intelligent, il le signifie : son regard semble dire, voyez ce que je suis obligé
de faire, quelqu'un viendra-t-il me sauver, personne ? alors je continue. Un peu comme votre voisin, en train de porter un meuble lourd, qui sourit pour vous dire qu'il a conscience du
spectacle qu'il donne. Il y a dans le regard de Grant Hart ce laconisme légèrement moqueur et retourné contre soi. La musique les englobe, lui et Greg Norton et Bob Mould, plus qu'ils ne la
produisent. Elle est l'air qu'ils respirent, le feu qui abolit la frontière corporelle, intérieur/extérieur. Quelques années plus tard, Bob Mould (guitare + chant sur 50% des autres titres)
emploiera la métaphore de la flèche : « J'envoyais des flèches dans le public, sauf que je continuais d'en recevoir en retour, bien après le concert, la nuit qui
suivait. » Cette flèche ne contredit pas l'image : le trait traverse l'espace en feu. Cela ne s'arrêtera jamais. Bob Mould, c'est superbe sur cette vidéo, joue peu :
d'abord il se marre, avec son physique du cousin qui a fait math sup / math spé, en se regardant dans les yeux avec le public. Puis il fait la police. Il a face à lui de possibles dégénérés
totaux, la scène est particulièrement basse et non protégée, mais depuis le cœur du feu volé au Ramones, Bob a vu quelque chose : « Ça, c'est la dernière fois. » Et comme
l'incriminé n'a pas bien compris, il le lui redit d'un geste plus net encore : non. C'est non. Et moi, spectateur de cette vidéo de 1981, je ne comprends pas pourquoi le public ne prolonge
pas l'orgie dans le sang, et n'investit pas la scène pour les tuer tout simplement. La musique (le son, l'espace, le feu) ne cesserait pas. Du moins, la « musique » est alors le
processus consistant à le faire croire.
Vingt-sept ans plus tard. Une voix catastrophique, couleur jaune, presque Bashung dans ses incurvations lisses, une voix fausse à force de s'être éloignée de la joie, ouvre District
Line ainsi :
Please listen to me... and don't disagree.
Mots malades... Cette supplique me met tellement mal à l'aise que je voudrais mal la traduire, me montrer bien maladroit : S'il te plaît écoute-moi... Et n'entre pas en
désaccord... Voilà, ainsi, c'est suffisamment gros de honte, de mauvais rapport à soi. Ne tombe pas pas d'accord avec moi, s'il te plaît, je t'en supplie. Oh là là.
On le sait, le fond de la sensibilité de Bob Mould est une grande souffrance personnelle. Il a toujours écrit pour échapper à l'hôpital psychiatrique. Cette souffrance traverse, égale, les
différentes étapes de sa vie, mais c'est justement de la maintenir égale, où elle ne demandait qu'à empirer, qui est l'exploit. La mutation, Bob Mould y a bien été forcé pour égarer son ennemi
dans la glace : en 1988 par exemple, quand Hüsker Dü se sépare dans une apocalypse de drogue, d'alcool et de détestation avec Grant Hart, et que Mould s'enferme à la campagne, revient en
solo, fonde un groupe, signe un quasi-tube en faveur du mariage homo (If I can't change your mind) puis se passionne pour l'electronica et recommence tout à zéro en 2002 avec des
machines, non sans avoir arrêté un temps la carrière pour exercer la profession de scénariste de matchs de catch. Racontée ainsi, et bien que ses composants soient exacts, l'histoire n'est qu'une
fable.
C'est ce que va nous expliquer District Line : en quoi l'histoire, même vraie, n'est qu'une fable. Simplement il ne va pas falloir que nous entrions en désaccord avec lui, il nous
le demande d'emblée. Ce n'est pas à nous de savoir à sa place. Nous devons faire confiance à l'auteur, appliquer la politique des songwriters. Ce que fait District Line, c'est
rejouer, avec discrétion et patience, le processus de mutation perpétuelle par quoi le patron a échappé au suicide. L'opération éclate au grand jour à la septième plage, Shelter
Me : une electronica pas de la toute dernière génération, mais ne jouant pas non plus la carte rétro, une electronica éternelle et quasi neutre, apparaît. A la seconde écoute de
l'album, nous découvrirons que cette subversion de la rythmique jouait dès la première plage, avec un travail assez fin de mixage sur la batterie. Ce remplacement progressif d'un son par un
autre, soudain accéléré, procure le vertige d'un malade qui se toucherait le corps en hurlant « Mes cellules ! Mes cellules ! » Quelque chose s'est passé dans le code
génétique de la musique, et ce doute sur la nature de ce qu'on entend, invite à partager le doute existentiel de celui qui produit ce son. D'ailleurs la voix (d'abord jaune, puis enrouée, puis
excessive selon différents modes) est maintenant traitée au vocoder ou quelque équivalent contemporain, sans les excès infligés à celle de Cher sur Believe, tube de l'été 1999, mais
justement : de façon moins souriante, moins bonasse. L'on croit que le dernier tiers de l'album va dérouler ce scénario d'une mutation trouvant sa fin ni heureuse ni malheureuse dans un
nouveau corps bionique - il n'en est rien : voici qu'apparaît une petite descente de cordes, à la Eleanor Rigby, et présentée d'ailleurs de la même manière : comme
incidente. Le mutant poursuit son processus, hors de sa propre portée.
Les chansons de Bob Mould ressemblent une série de signaux, envoyés par une intelligence depuis sa lutte pour la survie. Une intelligence qui sait qu'elle ne peut pas compter sur le corps très
longtemps, et qui ne renonce pas à chercher son éternité, via l'électricité qu'elle n'a pas inventé, via le feu qu'elle a dû voler, via cette électronique apprise sur
le tard. Et sans que celui dont le corps héberge cette intelligence puisse jamais répondre, pendant toutes ces années, à la question « qui suis-je ? » autrement que par des actes,
toujours à renouveler, comme un Moloch à nourrir. Pour cette raison, l'album s'achève sur une chanson pouvant évoquer la première, à ceci près que la mélodie s'y présente en structure ouverte,
attentive, en vigie. Un peu comme dans I won't share you, conclusive à l'œuvre des Smiths, la chanson semble se tenir aux avants-postes d'elle-même. C'est alors, dans ce mouvement au
large, que les premiers mots du disque se rappellent à notre souvenir : « Please listen to me, and don't disagree... » Je peux maintenant traduire cette
phrase : Attends pour me juger, pour juger ma parole, car ma parole est construite. Je ne me serais pas permis de te parler si je n'avais auparavant construit ma parole. Je suis sûr de ma
parole, et j'ai besoin de ta confiance même si tu penses que par le passé ta confiance a été trahie. Les raisons pour lesquelles tu penses que ta confiance a été trahie sont les mêmes que celles
pour lesquelles je tiens ici à prendre la parole. Oui, ma parole se fonde sur un accord profond avec les raisons qui pourraient te pousser à te méfier de moi. S'il te plaît, ne dis pas que tu
n'es pas d'accord, parce que ce que je veux te dire avant tout, c'est que moi, je suis d'accord avec toi.
Bob Mould est bientôt en tournée européenne. Dates en Angleterre et à Paris fin mai. (Calendrier.)
Un morceau par album est en écoute ici.
On a Good Day fait désormais relâche le week-end. Vous retrouvez Guillaume lundi avec Old Time Relijun, accompagné
d'un dessin de François Matton.
Quant à moi, je vous retrouve vendredi 2 mai avec Strangeways, Here We Come, des Smiths.
Bob Mould, par Thibault Balahy
En Normandie, dans une petite ville proche d'une plus grande, à Barentin près de Rouen, à Montivilliers près du Havre, j'ai mes artistes fétiches : Paul McCartney, Kate Bush, et Bob Mould.
(Plus au Sud, franchies la Seine et même la Loire, je passe aux Pet Shop Boys.) Au bar-presse-pmu local, si la radio diffuse une chanson d'auteur (souvent, Losing My Religion de REM), la
salle et le comptoir font l'inverse de s'animer : chacun s'y fige en sa posture mythologique. Le néon extérieur, grenadine ou turquoise, qui teinte le haut de la vitre même à midi, fait son
office de beauté. Dehors, sous le ciel blanc cassé, passent des jeunes gens vêtus de noir, maquillés comme ma fiancée, encore et encore, depuis les années 8O. (Les jeunes gens de la plus grande
ville semblent des New-Yorkais par comparaison.) J'écoute District Line, le dernier Bob Mould, et je pourrais être ailleurs, je pourrais être un autre, toujours surveillant la baie
vitrée, rêvant à la jeunesse comme l'extrême-gauche invente le peuple.
Au début des années 8O, Bob Mould appartenait au trio hardcore (hardcore, speed-core, punk, pop, jazz, et gay) Hüsker Dü, dont l'album Zen Arcade (1984) n'est pas moins important que les
London Sessions vol.2 de Thelonious Monk ou le Winterreise de Schubert par Britten et Pears. Mais une partie de la grandeur de Bob Mould consiste à n'avoir jamais recherché ce
genre de légitimité culturelle. Regardez plutôt ceci. C'est l'extrait d'un
concert de trois ans antérieur à ce chef d'œuvre. La composition y est moins complexe, le groupe débute encore, je veux juste attirer votre attention sur un étrange effet : la musique ne
semble pas émaner d'eux. Et ce n'est pas (ou pas seulement) un problème d'étalonnage de la vidéo, mais lié au caractère classiquement prométhéen de ce qui se joue là. Ils sont au cœur impossible
du feu. Ils ne l'ont pas produit, ils l'ont volé (aux Ramones, en l'occurrence). Et ils le paient en direct, pour être plus précis : ils le paient en live. Le batteur-chanteur
semble aussi peu responsable de son mouvement qu'un type qui se masturbe ; il est agi. Et comme il est intelligent, il le signifie : son regard semble dire, voyez ce que je suis obligé
de faire, quelqu'un viendra-t-il me sauver, personne ? alors je continue. Un peu comme votre voisin, en train de porter un meuble lourd, qui sourit pour vous dire qu'il a conscience du
spectacle qu'il donne. Il y a dans le regard de Grant Hart ce laconisme légèrement moqueur et retourné contre soi. La musique les englobe, lui et Greg Norton et Bob Mould, plus qu'ils ne la
produisent. Elle est l'air qu'ils respirent, le feu qui abolit la frontière corporelle, intérieur/extérieur. Quelques années plus tard, Bob Mould (guitare + chant sur 50% des autres titres)
emploiera la métaphore de la flèche : « J'envoyais des flèches dans le public, sauf que je continuais d'en recevoir en retour, bien après le concert, la nuit qui
suivait. » Cette flèche ne contredit pas l'image : le trait traverse l'espace en feu. Cela ne s'arrêtera jamais. Bob Mould, c'est superbe sur cette vidéo, joue peu :
d'abord il se marre, avec son physique du cousin qui a fait math sup / math spé, en se regardant dans les yeux avec le public. Puis il fait la police. Il a face à lui de possibles dégénérés
totaux, la scène est particulièrement basse et non protégée, mais depuis le cœur du feu volé au Ramones, Bob a vu quelque chose : « Ça, c'est la dernière fois. » Et comme
l'incriminé n'a pas bien compris, il le lui redit d'un geste plus net encore : non. C'est non. Et moi, spectateur de cette vidéo de 1981, je ne comprends pas pourquoi le public ne prolonge
pas l'orgie dans le sang, et n'investit pas la scène pour les tuer tout simplement. La musique (le son, l'espace, le feu) ne cesserait pas. Du moins, la « musique » est alors le
processus consistant à le faire croire.
Vingt-sept ans plus tard. Une voix catastrophique, couleur jaune, presque Bashung dans ses incurvations lisses, une voix fausse à force de s'être éloignée de la joie, ouvre District
Line ainsi :
Please listen to me... and don't disagree.
Mots malades... Cette supplique me met tellement mal à l'aise que je voudrais mal la traduire, me montrer bien maladroit : S'il te plaît écoute-moi... Et n'entre pas en
désaccord... Voilà, ainsi, c'est suffisamment gros de honte, de mauvais rapport à soi. Ne tombe pas pas d'accord avec moi, s'il te plaît, je t'en supplie. Oh là là.
On le sait, le fond de la sensibilité de Bob Mould est une grande souffrance personnelle. Il a toujours écrit pour échapper à l'hôpital psychiatrique. Cette souffrance traverse, égale, les
différentes étapes de sa vie, mais c'est justement de la maintenir égale, où elle ne demandait qu'à empirer, qui est l'exploit. La mutation, Bob Mould y a bien été forcé pour égarer son ennemi
dans la glace : en 1988 par exemple, quand Hüsker Dü se sépare dans une apocalypse de drogue, d'alcool et de détestation avec Grant Hart, et que Mould s'enferme à la campagne, revient en
solo, fonde un groupe, signe un quasi-tube en faveur du mariage homo (If I can't change your mind) puis se passionne pour l'electronica et recommence tout à zéro en 2002 avec des
machines, non sans avoir arrêté un temps la carrière pour exercer la profession de scénariste de matchs de catch. Racontée ainsi, et bien que ses composants soient exacts, l'histoire n'est qu'une
fable.
C'est ce que va nous expliquer District Line : en quoi l'histoire, même vraie, n'est qu'une fable. Simplement il ne va pas falloir que nous entrions en désaccord avec lui, il nous
le demande d'emblée. Ce n'est pas à nous de savoir à sa place. Nous devons faire confiance à l'auteur, appliquer la politique des songwriters. Ce que fait District Line, c'est
rejouer, avec discrétion et patience, le processus de mutation perpétuelle par quoi le patron a échappé au suicide. L'opération éclate au grand jour à la septième plage, Shelter
Me : une electronica pas de la toute dernière génération, mais ne jouant pas non plus la carte rétro, une electronica éternelle et quasi neutre, apparaît. A la seconde écoute de
l'album, nous découvrirons que cette subversion de la rythmique jouait dès la première plage, avec un travail assez fin de mixage sur la batterie. Ce remplacement progressif d'un son par un
autre, soudain accéléré, procure le vertige d'un malade qui se toucherait le corps en hurlant « Mes cellules ! Mes cellules ! » Quelque chose s'est passé dans le code
génétique de la musique, et ce doute sur la nature de ce qu'on entend, invite à partager le doute existentiel de celui qui produit ce son. D'ailleurs la voix (d'abord jaune, puis enrouée, puis
excessive selon différents modes) est maintenant traitée au vocoder ou quelque équivalent contemporain, sans les excès infligés à celle de Cher sur Believe, tube de l'été 1999, mais
justement : de façon moins souriante, moins bonasse. L'on croit que le dernier tiers de l'album va dérouler ce scénario d'une mutation trouvant sa fin ni heureuse ni malheureuse dans un
nouveau corps bionique - il n'en est rien : voici qu'apparaît une petite descente de cordes, à la Eleanor Rigby, et présentée d'ailleurs de la même manière : comme
incidente. Le mutant poursuit son processus, hors de sa propre portée.
Les chansons de Bob Mould ressemblent une série de signaux, envoyés par une intelligence depuis sa lutte pour la survie. Une intelligence qui sait qu'elle ne peut pas compter sur le corps très
longtemps, et qui ne renonce pas à chercher son éternité, via l'électricité qu'elle n'a pas inventé, via le feu qu'elle a dû voler, via cette électronique apprise sur
le tard. Et sans que celui dont le corps héberge cette intelligence puisse jamais répondre, pendant toutes ces années, à la question « qui suis-je ? » autrement que par des actes,
toujours à renouveler, comme un Moloch à nourrir. Pour cette raison, l'album s'achève sur une chanson pouvant évoquer la première, à ceci près que la mélodie s'y présente en structure ouverte,
attentive, en vigie. Un peu comme dans I won't share you, conclusive à l'œuvre des Smiths, la chanson semble se tenir aux avants-postes d'elle-même. C'est alors, dans ce mouvement au
large, que les premiers mots du disque se rappellent à notre souvenir : « Please listen to me, and don't disagree... » Je peux maintenant traduire cette
phrase : Attends pour me juger, pour juger ma parole, car ma parole est construite. Je ne me serais pas permis de te parler si je n'avais auparavant construit ma parole. Je suis sûr de ma
parole, et j'ai besoin de ta confiance même si tu penses que par le passé ta confiance a été trahie. Les raisons pour lesquelles tu penses que ta confiance a été trahie sont les mêmes que celles
pour lesquelles je tiens ici à prendre la parole. Oui, ma parole se fonde sur un accord profond avec les raisons qui pourraient te pousser à te méfier de moi. S'il te plaît, ne dis pas que tu
n'es pas d'accord, parce que ce que je veux te dire avant tout, c'est que moi, je suis d'accord avec toi.
Bob Mould est bientôt en tournée européenne. Dates en Angleterre et à Paris fin mai. (Calendrier.)
Un morceau par album est en écoute ici.
On a Good Day fait désormais relâche le week-end. Vous retrouvez Guillaume lundi avec Old Time Relijun, accompagné
d'un dessin de François Matton.
Quant à moi, je vous retrouve vendredi 2 mai avec Strangeways, Here We Come, des Smiths.
