Librement inspiré de : Erik Lindman, Open Hands, Almine Rech Gallery Bruxelles – Jocelyn Benoist, Le bruit du sensible, Editions du Cerf 2013 – Ghislaine Vappereau, Mine de rien, Galerie Jacques Levy – Georges Didi-Huberman, Phalènes. Essai sur l’apparition, 2, Editions de Minuit, 2013

C’est surtout en hiver que cela le démange. Quand son amie superpose des couches fines, de maillages différents, de douceurs et couleurs variées comme un dégradé de nuit et de chair, perlé ou pelucheux, soies et laines emmaillotant subtilement le corps pour en retenir la production calorique. Alors, quand il coule la tête vers l’encolure, déjà par ce mouvement se faufilant dans le visage de l’autre – lors de certaines éclipses partielles où deux astres se fondent en une nouvelle sorte d’étoiles générant luminosité et ténèbres spécifiques –, le bout des doigts écartant légèrement le col pour basculer à l’intérieur du mille feuille méticuleux des sous-vêtements, se dégage un entre-deux bouleversant, capiteux. Le regard, en premier lieu, se trouve atomisé, perd son statut de sens cognitif primordial dans une totalité perceptive où la vue n’a pas plus d’importance que l’odorat, l’ouïe et le toucher. Comme quand on passe trop rapidement de l’éclat solaire des champs à l’obscure touffeur des forêts. Les cinq sens reconduits au bord d’une originarité du sentir, au stade embryonnaire. Juste un fourmillement de bactéries qui recherchent le stade des perceptions. Une chaleur qui est une odeur. Un bruissement visuel. Une faille atemporelle, douce, insonorisée où le moindre son devient micro geste. Une nasse, une manche à air où se réfugier, chapiteau improvisé d’un cirque aérien où guetter les apparitions, les hallucinations désirantes. Et pas une seule chaleur ni une seule odeur, mais un mélange subtil, très vaste, de dizaines de températures et de fragrances, libérées par différentes zones corporelles, proches ou lointaines, visibles ou cachées. Multitude odorante du corps qui déroute le désir imaginant naviguer vers une cible unique, homogène. Superficielles et comme cérébrales, mélodieuses et rôdant brumeuses sur les rondeurs, plus âcres et émanant, discrètement, de l’intérieur, du bord des viscères. La chaleur du ventre, celle des bras, de la nuque, des aisselles, du nombril, des reins, des mamelons, du sexe, de l’anus, toutes transpirant différemment, poivrées, musquées, subtilement rances, fleuries, fruitées. Aucune trop accentuée, même la plus âcre, plutôt fraîche, rosées plurielles. Au sein de ce bouquet bourdonnant, la ligne de partage indistincte entre parfums corporels et eau de toilette, comme entre les flots d’un fleuve et les flux du rivage marin où il s’épanche. Un échange s’effectue entre molécules organiques et molécules chimiques et compose une identité olfactive unique, imprévisible, mixtion corporelle et spirituelle, de présence et d’absence. Mais toujours, diffuses, une nuance lactée, une de vanille épicée (plutôt tonka), une pointe de fleurs des sous-bois. Un flash, un bref instant, il se sent totalement dépouillé de ses intentions – quelque chose de substantiel reflue de lui –, il vacille, toute consistance perceptive lui échappe, il entraperçoit un mirage, un espace vierge illimité, il perd l’audible et le visible (« Audible ou visible qui s’exemptent de la figure synthétique transmodale qui est celle de l’objet et ne sont par là même rien de proprement « perçu » ». – Jocelyn Benoist, Le bruit du sensible, p. 215) Il flotte, chargé d’intuitions, sans boussole.
Dans le clair-obscur entre peau et linge de corps, un kaléidoscope pointilliste, imperceptibles tatouages d’ombres et lumières. Epingles de soleil à travers le tamis des chemisettes et tricots, en faisceau luminescent à certains endroits, à d’autres comme une poudreuse délicate, irréelle, clarté blutée. Là, sur un galbe, ici, entre deux côtes, dentelle immatérielle entre les seins, frange de piqûres brillantes, palpitantes, sur croissant lunaire autour du nombril, une épaule, le bord d’une clavicule. Faisant ressortir la diversité de grains et de teintes, ici lisses, là esquisse de chair de poule – fines bulles d’oxygène immobilisées sur l’épiderme –, au loin bronzée ou bistre, reflets nacrés, pâle et comme couverte d’un fin pollen, talquée. Thorax si banal et pourtant si vaste. Suspendus, les deux tétons, bruns et violacés, ocelles sombres, dardées vers un envol imminent. Ses doigts enchantés bougent, élargissent encore l’encolure et une vague parcourt les sous-vêtements, le picotement de lumières glisse sur d’autres creux et reliefs, comme l’ombre de nuages qu’il aime regarder, en avion, ramper souple sur les reliefs du paysage. Au centre, l’œil dissymétrique du nombril, fronce fondatrice, nœud stylé et crypté, orbe énucléé, cicatrice esthétique (départ d’une esthétique cicatricielle). Pourquoi une telle envie de s’abreuver à ce point d’eau sec, de le rouler dans sa langue, comme un de ces cailloux dans la bouche du bègue ?
Il est frappé d’un moment transitoire par excellence – lui-même, définitivement transitoire – où, avec une force jubilatoire interdite mais en attente d’explosion, le voir s’articule pleinement à l’imaginer (selon des mots de Didi-Huberman), le désir de prendre et pénétrer les tréfonds se confond – comme par inadvertance, diversion perverse – avec le désir de connaissance et espère une errance absolue dans cette faille diaprée, fluide comme une tente aux parois détendues, caressées par la brise, entre chrysalide des sous-vêtements et forme du corps tapi, surpris dans sa cache. Sans parade, sans avoir eu le temps d’adapter son maintien au regard posé sur lui, plus nu que nu, surpris par l’intrus dans son cocon d’hiver. Forme et informe. Désir de connaissance dont il craint qu’il ne vienne tout figer. Il prie le ciel pour que s’ouvre l’oubli d’apprendre, une expérience où cumuler les erreurs, les unes après les autres, de surprise en surprise, fuyant désespérément la mort sans même savoir qu’il est aussi question de mort, souhaitant ces errements plus que tout car sachant intimement du fond de toutes ses cellules effarées qu’« une connaissance sans erreur, c’est-à-dire sans errance, n’existe donc que sur fond de la mort de son objet. » (Didi-Huberman, Phalènes, Essais sur l’apparition, 2, Minuits, p.14) Il sait où son désir veut qu’il aille tout entier se consumer, à la manière des insectes attirés par la flamme, mais soudain, plutôt que d’y aller, tous ses sens papillonnent, s’abandonnent à une flânerie aérienne, voyant sans voir de la gorge à la ligne du pubis, sans plus aucune envie de conclure quoi que ce soit. « Il y a dans cette danse quelque chose comme une instabilité fondamentale de l’être, une fuite des idées, une toute-puissance de l’association libre, une primauté du saut, une rupture constante des solutions de continuité. » (Didi-Huberman, Phalènes, 2014, p.34), ceci caractérisant subjectivement le papillonnement, mais lui, transformant tout ça en bouffées libératoires, positives, fuite des idées, toute-puissance de l’association libre, libertés auxquelles il aspire. Ivresse mutique, fascination, allégresse d’éprouver, en contemplant la peau et ses éphémérides, cette « ignorance touchant l’avenir », « formule nietzschéenne qu’aima citer Bataille » rappelle Didi-Huberman en la caractérisant comme « une danse partenaire entre la peur du temps et le jeu avec la peur, comme lorsque le dieu-enfant dionysiaque poursuit en riant, fasciné, déjà endeuillé, des papillons auxquels il prête une connaissance spécialement profonde de ce qu’est le devenir lui-même. » (Didi-Huberman, ibid., p.43)
Et puis, la main plonge, sous les couches, à l’aveugle. En sachant très bien ce qu’elle cherche et veut toucher et, pourtant, à chaque fois, décontenancée et donc excitée, quelque chose de neuf, d’autre, autant connu qu’inconnu, recommencé après rupture. Une chasse, une fouille. « Dans le même sens, il est certain que l’expérience d’une surface lisse comporte toujours une certaine invitation à la poursuivre, et que la rencontre d’une aspérité, ou d’un trou, dont un autre sens ne nous aurait pas donné à l’avance la perception, est toujours vécue comme une forme de rupture et, il faut le dire, de surprise. En toute rigueur, toute discontinuité apparaissant soudain dans un champ d’expérience sensible jusque-là continu produit cet effet-là. A ce niveau, il semble qu’il y ait réellement un sens à parler de « surprise perceptuelle », au sens d’une surprise qui aurait son lieu proprement dans le tissu sensible de la perception. » (Jocelyn Benoist, Le bruit du sensible, P. 152) A la fois un silence, à la fois un bruit éolien, le trait d’un planeur, le jeu avec la proie d’un rapace jouette. Ainsi, il voit sa main, ses doigts, au bout du bras, leurs ombres comme une faune proliférant sur les seins, la plaine de l’abdomen, et plus loin disparaître, franchir une limite et basculer en un point aveugle, dans la culotte. Plongée dans le bruissement devenu assourdissant, éblouissant. Et bien que tout ce qu’il voit, hume et caresse relève du rigoureusement cartographié – scientifiquement, poétiquement pornographiquement –, ce qui le traverse et l’exalte est le sentiment d’une grande indétermination, comme si tout ce qu’il avait touché des yeux et entraperçu de la main dans la pénombre, appartenait à ce monde de « choses qui ne sont pas vraiment, ou pas tout à fait, des objets, et qui pourtant peuplent notre perception » (J. Benoist, p.183). Comme si une aspérité ou un trou le masquait au reste du monde, le phagocytait. Il voit sa main mue par une connaissance du terrain insoupçonnée, à son affaire, voletant autonome, main papillon, enjouée, agitée d’une sorte de transe, effleurant les sommités fleuries, dévalant les pentes douces vertigineuses, cajolant, enrobant, flattant, cinglant gentiment, faisant jaillir ou escamotant, se livrant à une rhabdomancie dont il ne se croyait pas capable, soucieuse des moindres particularités de la peau et des ondes émanant des organes caressés, des flux nerveux sous le derme. « Où va-t-elle chercher tout ça, cette main !? » Ne comprenant pas tout mais recevant au cerveau une quantité invraisemblable d’informations, une abondance qui submerge et donne cette impression de crue, préalable à la fusion. La main radiesthésique continue sa sarabande rituelle, cherchant les indices de points sensibles, écoutant, mesurant les vibrations, se décourageant puis s’exaltant, là hérissant, ici polissant, là avec un effet durcissant, galvanisant et ici attendrissant, liquéfiant, rétractant ou amplifiant. Les yeux fermés. « Papillonner consiste sans doute à découvrir les « cohérences aventureuses » – selon l’expression de Caillois – qui se trament d’image en image. C’est faire danser les objets du savoir, régler son pas sur un désir qui n’est pas celui du « tout savoir », encore moins du « savoir absolu », mais bien celui du gai savoir. » (Didi-Huberman, p.76) Et l’impression, amplifiée et en plus onirique – plus proche d’une aventure où il sortirait de son corps et voyagerait dans un ailleurs -–, se rapproche de ce qu’il éprouve certaines fois en bricolant, jardinant, cuisinant ou encore écrivant. Cette impression de se laisser guider par la main parce qu’elle sait, qu’elle possède une connaissance créative des objets, des matières, de leur aventure, mue par un sens pratique. Il se rappelle l’importance que Bourdieu accorde à la main de Manet dans la réalisation de ses tableaux, une fois qu’il se soit jeté à l’eau : 1. « Quand Manet se jette à l’eau, c’est pour apprendre à nager, c’est pour apprendre ce que c’est que Manet. » 2. « À chaque coup de pinceau, Manet aurait pu faire quelque chose d’autre. À chaque moment de l’action de peindre, ou de l’action d’écrire, tout se joue. » 3. « L’acte de peindre, un langage du savoir-faire, de l’œil, du coup d’œil, du sens pratique, du tour de main, de la manufacture. » Mais aussi, surtout, la main voletant en rase motte sur le buste paysage, dissimulée par les étoffes tièdes, lui rappelle ses travaux d’écriture où, là aussi, finalement, la main semble prendre les devants, comme dans n’importe quel bricolage et ce, bien qu’il s’agisse d’une activité jugée cérébrale. Ce qu’expriment ces mots de Claude Simon : « C’est seulement en écrivant que quelque chose se produit, dans tous les sens du terme. Ce qu’il y a pour moi de fascinant, c’est que ce quelque chose est toujours infiniment plus riche que ce que je me proposais de faire. (…) Il semble donc que la feuille blanche et l’écriture jouent un rôle au moins aussi important que mes intentions, comme si la lenteur de l’acte matériel d’écrire était nécessaire pour que les images aient le temps de venir s’amasser… »
De cette intrusion dans le monde des apparitions, choses qui ne sont pas vraiment, ou pas tout à fait, des objets, et qui pourtant peuplent notre perception, en en ayant non seulement vues une belle profusion, mais senties aussi, palpées – toutes fuyantes, ondes giboyeuses, se laissant traverser pour que d’autres soient effleurées, ainsi de suite –, ayant aussi été agité par les forces magnétiques, celles décochées et celles encaissées au bout de ses doigts, se sentant alors comme façonné de l’intérieur par le corps exploré et excité par le sentiment de modeler en retour, à l’image de son désir, les images du corps tendues sous ses gestes papillons, tout à coup, se réveillent tous les souvenirs, tous les impacts, alors qu’il passe devant la vitrine d’une galerie exposant des œuvres de Ghislaine Vappereau (« mine de rien, sculptures de 1997-1999 »). Un panneau irrégulier de cire traversé de deux carrés fondus de couleur et divaguant en une buse de treillis, manche à air perforée, objet qui n’en est pas et qu’avec les reflets de la vitre l’appareil photo ne parvient pas à saisir tel quel, juste une silhouette fantôme, poissonneuse, fuyante. Il entre, fasciné par ces corps d’alvéoles métalliques, vides, tricots volumétriques dont chaque maille a été touchée – appuyée ou tractée, pincée ou tordue – pour épouser la forme d’une idée, d’une existence invisible mais prégnante. Comme de voir arrachée aux profondeurs mentales, archéologie sensationnelle de l’infra-volupté, des gangues fluides de cette matière dont serait faite la plasticité du sensible, spécimens des innombrables textures avec lesquelles on construit du sens, on donne figure à ce que l’on ressent au fond du trouble. « En eux-mêmes, ils [ces fils de fer] ne sont aucun objet – et corrélativement aucune « forme » – déterminé ; mais, dans la perspective gestaltiste, ils deviennent la figure même de la plasticité figurale du sensible », et que Merleau-Ponty analysera comme « la texture imaginaire du réel ». (Jocelyn Benoist, p. 186) Aucun objet, aucune forme, et pourtant quelque chose de visible, à toucher, là, mais à peine en a-t-il une image extérieure, un contour, qu’il est passé outre, dedans, égaré parmi d’autres possibilités, d’autres variantes. Il passe au travers. Et c’est bien quelque chose de cet ordre qu’il éprouvait, sa main papillonnant à l’intérieur du cocon chaud, butinant la peau de son amie. « La simple forme sensible constituée par ce fil de fer tordu qui, en lui-même n’est « rien » – en tout cas certainement pas « objet » au sens d’objet bien identifié, déterminé – devient suggestive de quelque chose, et, à partir d’elle, autant d’effets de réalité et d’irréalité deviennent possibles. » Énergie suggestive – balancement entre réel et irréel, va et vient entre rien et tout, vie et mort –, évidemment, qui désaltère la paume papillon et qui la saoule. « Par là même, c’est le champ du sensible, en tant que champ de possibilités en deçà de la signification, qui apparaît. « L’image », certes, représente comme l’ébauche d’une intentionnalité traversant et instrumentant le sensible lui-même ; mais ce qui apparaît à sa lumière n’est pas de l’ordre de l’objet, mais un être, dans lequel « réel » et « imaginaire » se confondent, l’un et l’autre ne constituant que deux faces de ce que nous avons appelé quant à nous la réalité – et non la vérité- de la perception. Ici la plasticité des fils de fer, plasticité de forme comme de statut, entre leur être « réel » et leur être « imaginaire », devient le monogramme de l’être sensible. » (Jocelyn Benoist, p.187) Et voilà, la main papillon, comme tout insecte cherchant sa nourriture et sa reproduction, s’affairait à dénicher et décrypter le monogramme de l’être sensible lui correspondant.
Les autres pièces d’Erik Lindman, incrustant dans une toile des objets trouvés dans la rue (ou ailleurs), planches de bois ou plaques de fer, illustrent bien ce travail de la main, devançant ou complétant le regard et la réflexion, papillonnant sur les matières et les images qu’elles génèrent, morceaux de matériaux abandonnés, échoués, les auscultant, les transformant, et essayant des combinaisons. Ils ont des airs de famille avec ce que les flots rejettent sur le rivage, comme provenant d’une même embarcation démantibulée, fenêtre sur ce large composite. Bien entendu, les mains suivent l’impulsion d’idées, sont au service de projets – projection d’œuvres que l’artiste se représente mentalement pour s’orienter –, mais elles trouvent par elles-mêmes, en touchant, retournant, tâtonnant, essayant, ratant, recommençant, écoutant ce que les choses disent, leurs échos et vibrations avec quoi composer des tableaux, avant même que les autres outils – sensuels ou cognitifs – aient le temps de percevoir et réagir consciemment. (Pierre Hemptinne) – Erik Lindman – Ghislaine Vappereau -





















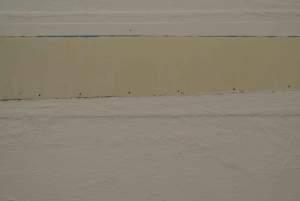

Tagged: culture de l'attention, empreinte, expérience du sensible, insecte, page blanche, penser sous forme de paysages, sentiment amoureux
