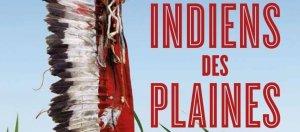
Au musée du Quai Branly se tient en ce moment une exposition sur les Indiens des Plaines, appellation qui condense à elle seule tous les fantasmes universels autour de la figure de l’Indien d’Amérique. Un port altier, un regard fier et perçant, une coiffe de plumes d’aigles spectaculaire, de longs cheveux noirs tressés, un costume en peau de bison, des parures de perles, un calumet dans une main, un arc à l’épaule, un tipi en arrière-plan ; les attributs de l’Indien des Plaines ont contribué à forger une image d’Épinal coriace et malheureusement réductrice de l’Indien d’Amérique dans l’imaginaire collectif.
Les Indiens des Plaines, ce ne sont pas moins de 18 peuples différents disséminés sur un territoire de plus de 2 millions de kilomètres carrés, entre le bassin de la Saskatchewan au Canada et le Rio Grande au sud du Texas, dans une région autrefois surnommée le « Grand Désert Américain », réputée pour l’immensité de ces paysages, l’hostilité de ces terrains et la ténacité de ses habitants.
L’exposition regroupe cent-quarante pièces : tableaux, dessins, costumes, outils et objets du quotidien, visant à révéler la permanence de la tradition artistique des Indiens des Plaines, dont les mœurs, les croyances et les rituels ont été profondément bouleversés par le contact avec les Européens. Elle est organisée en sept parties :
- Le renouveau artistique dans la vie contemporaine, 1965-2014
- Communautés et diaspora, 1910-1965
- Peuples anciens, Pré-contact
- La vie dans les Grandes Plaines, 1700-1820
- L'épanouissement d'une culture, 1820-1860
- La mort du bison, 1860-1880
- Dans les vestiges des terres ancestrales, 1880-1910
La scénographie inverse la chronologie : l’exposition commence avec la pièce consacrée au XXème siècle, où sont particulièrement mis en valeur les ouvrages de perlage, grande source d’inspiration pour les artistes de la nouvelle génération qui tentent de revivifier et de perpétuer leurs traditions. Cette technique est en effet contemporaine par définition, puisque les perles de verre ont été importées par les colons au début du XIXème siècle et ont fini par remplacer presque complètement l’utilisation de coquillages, de pierres polies et de piquants de porc-épics. Paradoxe ultime et presque dérangeant, de voir une culture développer de nouvelles techniques artistiques et enrichir son style visuel par le biais de l’acculturation. Cela, on ne l’apprend malheureusement pas dans l’exposition, dont on déplore, dès la première salle, le manque notoire de didactisme.
Dans une salle dédiée au cinéma, on veut nous rappeler comment les westerns ont massivement contribué à véhiculer le stéréotype du « Peau-Rouge », que les réalisateurs américains ont longtemps doté de tous les accessoires des Indiens des Plaines, et plus particulièrement des Sioux et des Cheyennes. Sur un grand écran sont projetés de courts extraits de films de John Ford (« La chevauchée fantastique », 1939) ou de Cecil B. De Mille (« Une aventure de Buffalo Bill », 1936), où prédomine la figure de l’Indien sanguinaire et alcoolique, toujours interprété par un acteur blanc – il faut attendre « Little Big Man » d’Arthur Penn, en 1970, pour que des rôles principaux soient confiés à des Amérindiens. Avant ce film, les Indiens américains au cinéma sont tous affublés de l’irrémédiable coiffe sioux en plumes d’aigles – que seuls les guerriers et chefs de tribus réputés pour leur extraordinaire bravoure et leur sagesse inégalable ont le droit de porter en réalité – dansant frénétiquement autour d’un feu et ligotant leurs prisonniers à des totems. Sur le mur à l’entrée de salle, un texte explicatif écrit par Michel Ciment, grand critique de cinéma s'il en est, apporte un éclairage bienvenu, bien que succint, à cette thématique cinématographique, et constitue l’un des rares moments réellement instructifs de l’exposition.
Quelques objets archéologiques, dans un état de conservation saisissant, alignés dans un couloir pour attester de l’ancienneté de ces peuples, puis un grand espace où s’alignent des rangées de caissons en verres pour accueillir les œuvres issues de la collection qui fait la fierté du Musée du Quai Branly. On déambule dans ce dédale de manière un peu hasardeuse, comme dans une file d’attente à l’aéroport, sans tout à fait saisir le déroulement que suit chronologie, l'ordre d'exposition des objets ou l’emplacement de certains cartels.
Comment comprendre l’irruption soudaine de tous ces drapeaux américains dans les ouvrages de perles, qui contrastent durement avec la diversité des motifs géométriques représentés jusqu’alors sur les vêtements et les objets ? Comment savoir, puisque les cartels ne disent rien sinon leur date d’exécution, que ces travaux ont été réalisés au temps où la quasi-totalité des populations des Plaines avaient été parquées dans des réserves, et qu’ils reflètent donc à la fois la progression irréversible de l’acculturation et la survivance d'une tradition résistante ?

Comment appréhender le profond bouleversement provoqué par l’arrivée du cheval, réintroduit sur le continent par les colonisateurs espagnols à partir du XVIIème siècle, qui a définitivement modifié le mode de vie des Indiens des Plaines, devenant tout à la fois leur moyen de transport principal, le moteur de leur économie, leur monnaie d’échange, un symbole prestigieux de statut social et le premier prétexte des guerres inter-tribales ?
Comment, avec quelques chiffres inscrits sur un « mur-atlas », saisir l’ampleur du massacre des bisons perpétrés par les colons en l’espace d’un siècle, et l’impact catastrophique sur la vie des autochtones vivant dans les Plaines, pour lesquels le mastodonte constituait l’essentiel de leur subsistance, dont ils tiraient la nourriture et la matière première pour les vêtements, les outils, le matériel de cuisine, les instruments de musique, les jouets, les parures et les tipis ?

Comment reconnaître l’importance inestimable de ces grandes peaux de bisons ornées de dessins à la fois naïfs et cryptés, évoquant des peintures rupestres, dont les Indiens des Plaines s’enveloppaient avec fierté lors des grandes occasions, portant sur leurs épaules ces véritables annales graphiques, garantes de l’histoire prestigieuse de leur tribu ?
Tous ces objets, contemporains ou anciens, qui interpellent indéniablement par leur beauté, leur symbolisme et leur mystère, manquent cruellement de contextualisation et de mise en perspective. Enfermés dans des cages en verre, qui créent une distance irrémédiable avec le spectateur, les costumes traditionnels et les objets manufacturés perdent toute leur dimension humaine et leur charge symbolique. Ces vêtements, qui ont été portés, ces objets, qui ont été manipulés, ne sont plus que des reliques désincarnées d’une époque perdue. Ainsi vidés de leur sens, ils ne sont plus que de belles pièces décoratives, plaisantes à l’œil et propices aux commentaires légers : « cette paire de mocassins brodés est pile dans la tendance ! » ; « Ce patchwork serait parfait sur mon lit »… À travers ce choix d’exposer les témoins d’une culture en les vidant de leur substance, de leur présence et de leur force d’évocation, cette exposition participe précisément au processus qu’elle entend enrayer : la muséification d’une culture et la fossilisation de ses représentants.
À cette absence de mise en perspective vient s’ajouter un remarquable défaut d’éclairage malheureusement entièrement délibéré, puisqu’il s’inscrit dans la scénographie « sobre et minimaliste » pensée par l’agence d’architectes Wilmotte et Associés (qui ont aussi officié pour certaines salles du Musée du Louvre et du Musée d’Orsay), censée évoquer « le voyage et les contrées lointaines ». La démarche même d’élaborer une mise en scène mystérieuse et exotique en dit long sur la vision édulcorée et folklorique que véhicule l’exposition. Les cartels écrits en beige sur des murs gris sont difficilement lisibles, en plus d’être mal placés par rapport à l’objet qu’ils décrivent et rudimentaires par rapport aux informations qu’ils dispensent. On apprend peu de choses sur la signification des objets, sur le détail des croyances et sur la symbolique des rituels. On ne sent pas l’histoire ni la présence des peuples représentés ; des Indiens des Plaines, on en voit les choses, mais pas les hommes.
En dehors de tout jugement élitiste, les spectateurs un peu avertis, simples amateurs de sciences humaines et non spécialistes des Indiens des Plaines, ne peuvent que regretter la superficialité des connaissances dispensées dans l’exposition du Quai Branly. Si l’on doit effectivement regretter l’hermétisme incontestable de certaines doctrines universitaires, comme l’anthropologie, il me semble qu’il est tout aussi déplorable de sacrifier les particularismes d’une culture au processus forcené de démocratisation du savoir, pour n’en faire qu’un simple objet de divertissement plutôt qu’un vrai sujet d’enrichissement intellectuel. Au lieu de faire dialoguer les cultures, comme le proclame si bien la devise du musée, cette exposition déroule un monologue occidental qui exploite et perpétue le mythe de l’Indien unique et folklorique, un stéréotype désuet et surtout dangereux au regard des nombreux peuples amérindiens qui continuent aujourd’hui de lutter âprement pour être reconnus et respectés dans leur diversité.
Pour en savoir plus
Exposition
- « Indiens d’Amérique – Paris Tribal » à la Galerie Flak (8 rue des Beaux-Arts, 75006 Paris) : des objets traditionnels issus de collections privées, dont celle d’Andy Warhol, exposés simplement, sur des promontoires, dans un petit espace modeste et bien éclairé, où l’on peut « toucher avec les yeux ». À voir pour comprendre les vertus d’une bonne scénographie
Livres
- « Indiens des Plaines », Connaissances des Arts hors-série n°618
- Les Indiens des Plaines de Paul H. Carlson, Albin Michel
Photographie
- The North American Indian de Edward Sheriff Curtis, photographe et ethnologue : 50 000 clichés pris entre 1907 et 1930 et regroupés en 20 volumes. Une œuvre incroyablement exhaustive et d’une rare intensité. Sublime.
- Photographs of North American Indians de William Henry Jackson : des dizaines de milliers de tirages rassemblés en deux catalogues : l’un de paysages, l’autre de portraits d’Indiens
Films
- « Sur la piste des Indiens des Plaines », documentaire de 52 minutes écrit par Timothy Miller et réalisé par Yves Riou et Philippe Pouchain, diffusé le dimanche 4 mai à 9h10 sur France 5
- « Little Big Man » d’Arthur Penn avec Dustin Hoffmann, 1970
- « Danse avec les loups » de et avec Kevin Costner, 1990

