Par Franck Pinay-Rabaroust | on 18/10/2014 |
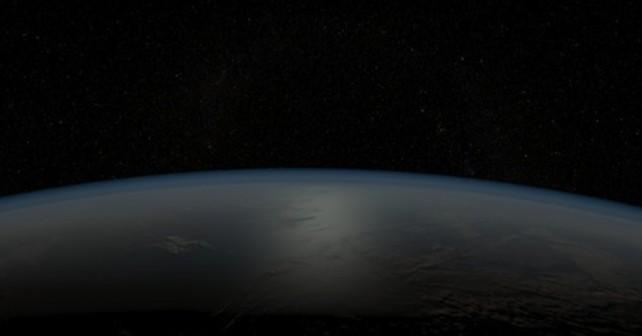
Le modèle agro-industriel marche sur la tête, la planète va à vau-l’eau et les hommes politiques jouent avec le feu. OGM, privatisation du vivant, dérèglement climatique, aveuglement humain sont autant de sujets qui devraient faire débat. Et urgemment. A moins qu’il ne soit déjà trop tard. Pour Marie-Monique Robin, journaliste d’investigation lauréate du prix Albert-Londres, il est ici question tout simplement de la survie de l’humanité.
ATABULA – Vous avez sorti en 2008 un film documentaire intitulé “Le Monde selon Monsanto”, qui dénonce les faits et gestes de cette multinationale qui prônent l’usage des organismes génétiquement modifiés (OGM) et qui accumulent les procès en raison de la toxicité de ses produits (hormones de croissance bovine et laitière, etc.). Ce film a eu un impact considérable et, encore aujourd’hui, vous êtes sollicitée partout dans le monde pour en parler. Comment expliquez-vous cet engouement ?
MARIE-MONIQUE ROBIN – Il y a une prise de conscience généralisée du lien étroit entre l’alimentation et la santé. Et ce documentaire, doublé d’un livre, met en évidence les incroyables mensonges de Monsanto. Cette entreprise a réussi a manipuler, à mentir, à corrompre pour mettre sur le marché mondial des produits aussi dangereux que les polychlorobiphényles (PCB), le roundup, l’hormone de croissance bovine et, bien sûr les OGM. Cela s’est fait à grands renforts de rapports scientifiques biaisés et la bienveillance d’hommes politiques peu regardants. Mais nous constatons surtout que le modèle agricole dominant n’a absolument rien résolu et n’a pas rempli sa première mission : alimenter correctement la planète. Près d’un milliard d’habitants ne mangent pas à leur faim. Et, paradoxe affligeant, l’obésité gagne chaque jour du terrain. Au Mexique, le constat est catastrophique. D’un côté, vous avez 19 millions de Mexicains qui souffrent de malnutrition et dans le même temps d’obésité. Ce pays concentre les symptômes du modèle agro-industriel. De plus en plus de personnes prennent conscience de cette situation et veulent réagir.S’il y a une prise de conscience individuelle, peut-on en dire autant de la sphère politique ?
Les gouvernements font preuve d’une frilosité coupable partout dans le monde. La France, même si elle s’en défend, encourage le modèle agro-industriel. Le lobbying des multinationales est énorme et les collusions d’intérêts sont fréquentes. Là encore le Mexique illustre parfaitement mes propos. En moyenne, un Mexicain consomme 160 litres de soda par an. Le gouvernement a donc lancé une campagne contre l’obésité, laquelle est financée par… Coca-Cola. Tout est dit.Comment a évolué la production alimentaire mondiale depuis un siècle ?
Selon les chiffres des Nations Unies, la production permet de nourrir 12 milliards d’habitants. Elle a quantitativement augmenté et nous sommes en réalité en situation de surproduction. Mais cela ne résout absolument pas les problèmes liés à la faim dans le monde. Les aberrations sont multiples. La première d’entre elles est liée aux problèmes de distribution et de répartition. Près de 30% de ce que nous produisons partent à la poubelle, c’est énorme. Ensuite, il y a les conditions de production. L’industrie produit à grands renforts d’intrants chimiques, ce qui provoque des maladies très graves, notamment chez les agriculteurs et une usure accélérée des sols. La facture sanitaire est très élevée.Existe-t-il des preuves qui mettent en évidence des liens entre l’usage d’intrants chimiques et le développement anormal de certaines maladies ?
Même si le travail des épidémiologistes est rendu compliqué par l’existence d’études scientifiques peu rigoureuses, voire commandées par les industriels eux-mêmes, il y a aujourd’hui des études très sérieuses qui mettent en avant des liens incontestables entre les maladies du système lymphatique (leucémies, myélomes) et les pesticides. Des chercheurs de l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médical (Inserm), ont suivi pendant neuf ans des cohortes d’agriculteurs qui utilisaient des pesticides et d’autres qui n’en utilisaient pas. En 2009, les résultats ont été publiés. Ils sont édifiants : les agriculteurs exposés présentaient de 100 à 1000 fois plus de cellules transloquées que le groupe non exposé. Les cellules transloquées sont le produit d’une anomalie génétique provoquée par un échange de fragments d’ADN. Il s’agit-là d’un marqueur biologique propre au processus de cancérisation. Cette étude confirme des dizaines d’autres études internationales sur le sujet.En lieu et place du modèle agro-industriel, vous êtes pour la mise en place du modèle agro-écologique. A quoi ressemble-t-il ?
C’est un modèle relativement simple : réintroduction de la biodiversité, faire tourner les cultures, mettre des animaux dans les champs pour leur apport en fumier, revenir à une production et à une consommation locales. C’est repenser la complémentarité de l’écosystème en s’appuyant sur des savoir-faire anciens mais sans renier les connaissances nouvelles comme la microbiologie par exemple. En agissant ainsi, l’image du paysan serait revalorisée. On ne le verrait plus comme un pollueur mais comme celui qui nourrit correctement le sol et chacun d’entre nous.Est-ce qu’un tel modèle n’entrainerait pas une baisse des rendements et nuirait à l’équilibre alimentaire mondial ?
Je suis totalement convaincu que le modèle agro-écologique est performant pour nourrir correctement tous les habitants de cette planète. Mais il est évident que les multinationales n’ont pas intérêt à voir se développer ce modèle-là puisqu’elles ne pourraient plus vendre leurs produits chimiques. Alors elles inventent des chiffres, comme ceux que le président de l’Association nationale des industries alimentaires, Jean-René Buisson, a sorti lors d’un débat télévisé en 2011. Selon lui, cultiver sans pesticides provoquerait une baisse de 40% de la production agricole et une augmentation de 50% des coûts de production. J’ai mené des recherches pour savoir d’où sortaient ces chiffres. Ils proviennent de deux études isolées parmi beaucoup d’autres qui disent le contraire. C’est en réalité de la pure propagande.Mais vous, comment pouvez-vous garantir que les rendements ne baisseraient pas et que ce modèle ne provoquerait pas des pénuries ?
Le modèle agro-écologique est basé sur des productions en lien avec les besoins locaux. Moins de kilomètres parcourus, moins de déchets, moins de pertes. C’est également redonner à la terre sa pleine capacité de production en privilégiant la polyculture, la biodiversité et, plus largement, le vrai travail du paysan. A lui d’appliquer le bon couvert végétal, le bon mariage des plantes et des fleurs, de bien savoir nourrir la terre. Récemment, j’ai rencontré un ancien agronome de l’Institut national de recherche agronomique (Inra) qui travaille avec des huiles essentielles sans aucun intrant chimique. Sur une parcelle de blé, il a obtenu un rendement de 200 quintaux à l’hectare, ce qui est remarquable. Le potentiel de l’agro-écologie est exceptionnel.Se pose la question de sa mise en œuvre. Les paysans ont-ils encore les connaissances pour maîtriser toute la complexité du végétal ?
Il faut tout désapprendre pour mieux réapprendre. Dans les années 60, il y a eu la révolution en faveur des produits chimiques. Formons désormais nos paysans à l’agro-écologie, à la connaissance des sols, au fonctionnement du végétal. Je sais que ce n’est pas évident. Mon frère, âgé de 50 ans, a repris la ferme familiale dans le département des Deux-Sèvres et il doit absolument tout apprendre pour assurer la conversion à l’agriculture biologique. Ces formations doivent êtres assurées avec des techniciens spécialisés et entre les paysans eux-mêmes. C’est un défi, certes, mais cette transition peut se faire s’il y a une véritable volonté politique.Est-ce que des moyens financiers sont dégagés pour assurer cette transition ?
Quasiment rien. Il y a bien quelques chercheurs de l’Inra qui travaillent sur le sujet mais c’est marginal. Lors d’un colloque sur l’agro-écologie que je coordonnais au Sénat en avril 2013, le ministre de l’Agriculture Stéphane Le Foll expliquait qu’il voulait que la France devienne le leader européen en la matière. Le discours était très beau. Plus d’un an après, on attend toujours de voir les premières décisions concrètes. C’est toujours pareil, il y a les paroles et les actes. Et il faut ajouter le lobbying, notamment celui des organisations syndicales, qui pèsent dans la balance.Quelles sont les positions des organisations syndicales, notamment celle de la FNSEA ?
La FNSEA a un nouveau mot d’ordre : l’écologiquement intensif. Ca laisse rêveur. Il suffit de regarder qui dirige cette organisation pour comprendre que ce n’est pas elle qui va privilégier un discours en faveur de l’agro-écologie. Xavier Beulin, son président, fait de l’agrobusiness, pas de l’agriculture. Le lobbying de son organisation en faveur du milieu industriel, que ce soit auprès de l’Etat français ou des institutions européennes, est énorme. Ils sont très loin de toute idée de changement réel en faveur de l’agro-écologie.La filière « bio » n’est pas exempte de paradoxe. Que ce soit au niveau des conditions de travail des salariés agricoles dans certains pays, la mise sur le marché de tomates espagnoles en hiver ou de produits en provenance de l’autre bout de la planète. La filière ne perd-elle pas de son intérêt face à de tels faits ?
Vous avez entièrement raison. Et c’est bien pour cela que je distingue l’agriculture écologique et l’agro-écologie. Je ne veux pas de ces produits « bio » produits au mépris du territoire ou du respect des gens. Je défends autre chose qui repose sur la synergie et l’harmonie des moyens de production, la complémentarité des cultures et le respect des travailleurs. Il s’agit-là d’un modèle qui ne produit pas de gaz à effet de serre et qui ne trompe personne. Reste au consommateur d’avoir l’intelligence de comprendre le message et de ne pas acheter de tomates en plein hiver.Dans vos documentaires, vous évoquez le sujet de la privatisation des semences. Qu’est-ce que cela veut dire ?
Le paysan ne peut acheter que des semences qui sont inscrites au catalogue. Or ces semences appartiennent à de grands groupes comme Monsanto, Dupont ou Limagrain. La semence, c’est le premier maillon de la chaîne alimentaire, le plus important. Et la situation s’aggrave avec une loi récente qui a été votée au en première lecture au Sénat en France dans l’indifférence générale. Si cette loi venait à passer, les paysans seraient taxés de contrefaçon s’ils conservent des semences d’une année sur l’autre. Autrement dit, on les oblige à en racheter chaque année. Pour prouver que l’enjeu financier est énorme, la société Monsanto a dépensé plus de huit milliards de dollars entre 1996 et 1997 pour acquérir différentes entreprises semencières. Aujourd’hui, le paysan est pieds et mains liés.En d’autres termes, on oblige les agriculteurs à acheter ce que la nature donnait. Et cela va même plus loin avec le phénomène plus large de la privatisation du vivant ?
En 1980, la Cour suprême des Etats-Unis a déclaré brevetable un micro-organisme transgénique. Puis, en 1982, l’Office européen des brevets de Munich a accordé un brevet également à un micro-organisme, puis sur des plantes (en 1985) et même des animaux (en 1988) et des embryons humains (en 2000). Désormais, il est possible de breveter des plantes dont on découvre des vertus médicinales dans un laboratoire occidental, mais pourtant connues et reconnues depuis des siècles ailleurs. Entre 1983 et 2005, Monsanto a ainsi obtenu 647 brevets liés à des plantes. Cette dérive est extrêmement dangereuse car elle va beaucoup plus loin que les organismes génétiquement modifiés (OGM).Concernant les OGM, la multinationale Monsanto a annoncé en juillet 2013 qu’elle suspendait toutes ses demandes d’autorisations de culture en Europe. Récemment, elle semble changer son discours sur les OGM en expliquant qu’il y a également de véritables avantages pour le consommateur final. Qu’en pensez-vous ?
En Europe, Monsanto a clairement perdu la bataille. Aux Etats-Unis, mais également en Amérique du Sud, la situation est catastrophique pour de nombreux agriculteurs qui ont utilisé des OGM. Les mauvaises herbes sont devenues résistantes à l’herbicide roundup – commercialisé par Monsanto -, des milliers d’hectares sont carrément abandonnés à cause de l’amarante qui résiste à tout, des insectes sont également devenus résistants, etc. De nombreux céréaliers ne savent tout simplement plus comment s’en sortir : les OGM coûtent cher, les rendements ne sont pas au rendez-vous, l’eau est polluée et ils ont peur pour leur santé. Le pire scenario est là, sous nos yeux. Quant à parler de bénéfice pour le consommateur final, c’est du marketing pur.Mais n’existe-t-il pas de bons OGM, à même de fournir un vrai progrès pour les agriculteurs et les consommateurs ?
Cela fait 30 ans que l’on promet des OGM bons pour la santé. C’est le cas du fameux riz doré, riche en vitamine A. Mais ça ne fonctionne pas. Monsanto promet également un maïs résistant à la sécheresse, mais là encore c’est un échec. En réalité, la résistance à la sécheresse ne repose pas sur un gène, mais sur une combinaison de gènes, ce qui rend la manipulation génétique très complexe. Surtout, il y a des plantes qui existent à l’état naturel à même de répondre à toutes les conditions climatiques. A Mexico, il existe l’International Maize and Wheat Improvment Center (CIMMYT). Ce centre possède 165 000 variétés de blés. Il y en a pour tous les territoires, tous les climats. Puisons là-dedans. Il ne faut jamais oublier que la nature a tout prévu. Sauf que l’homme est en train de tout dérégler et que l’on va dans le mur.C’est-à-dire ?
Je vais vous prendre un exemple précis avec la plus grande réserve aquifère du Mid-Ouest américain, Ogallala, qui s’étend sur plusieurs États. A cause du réchauffement climatique et de son usage intensif pour arroser les plantations de maïs, elle est en train de disparaître. D’après les experts, cela veut dire que cette immense région des Etats-Unis va se transformer en vaste désert. Les externalités du modèle agro-industriel sont catastrophiques : réchauffement climatique, explosion des maladies chroniques, destruction des écosystèmes, érosion des sols. Non seulement cela coûte très cher, mais nous sommes incapables de prendre tous ces problèmes à bras le corps.Pourquoi sommes-nous incapables de réagir si nous filons droit à la catastrophe ?
Les raisons sont multiples. L’homme politique est incapable de voir au-delà de sa réélection et le système politique est basé sur la courte vue et est donc incapable de s’inscrire dans une vision à long terme. Le lobbying aveugle des industriels n’aident pas non plus à prendre des décisions qui sortent de la logique capitaliste, c’est-à-dire des profits à court-terme.Mais on a l’impression que la résistance humaine va au-delà de l’aveuglement politique ou financier. N’y-a-t-il pas tout simplement une incapacité de l’homme à concevoir les futures catastrophes ?
L’espèce humaine ne sait pas voir à long terme. Le biologiste William Rees m’expliquait que ce qui a le moins changé chez l’homme depuis la nuit des temps, ce sont ses gènes. A l’époque, celui-ci n’avait qu’une préoccupation : assurer sa subsistance au jour le jour, par exemple, en chassant. D’un point de vue génétique, l’homme n’est pas constitué pour avoir une vision à long terme. Selon ce même biologiste, qui est l’inventeur du concept d’empreinte écologique, nous avons consommé l’an dernier l’équivalent de 1,5 fois notre planète en termes de ressources. En 2030, si nous suivons ce même rythme, il faudra l’équivalent de quatre planètes. Les conséquences sont évidentes : déplacements des populations, risques accrus de conflits armés, catastrophes naturelles, maladies…Si je comprends bien, nos principales matières premières ne se renouvellent plus ?
D’après les experts indépendants, entre 2020 et 2040, les gisements d’énergies fossiles facilement exploitables seront épuisés. Il n’y aura plus de minerais exception faite de la bauxite, la biodiversité sera extrêmement dégradée – nous serions en train de vivre la sixième extinction des espèces – et le système financier se sera probablement écroulé. En entendant cela, nous avons tous envie de résister et de ne pas croire à ce scenario catastrophe. Sauf que lorsqu’on lit tous les rapports, les expertises et que l’on parcourt le monde comme je le fais depuis des années, tout cela est difficilement contestable. Et soyons très clairs : Nous sommes dans une situation d’urgence. Nous parlons là de la survie de l’humanité.Il faut en plus ajouter la question du climat et du réchauffement climatique…
Nous avons sous-estimé les effets du réchauffement climatique. Je vais prendre l’exemple du Népal où j’ai récemment filmé un colloque sur le réchauffement climatique et les énergies renouvelables. Tous les intervenants ont constaté l’incroyable recul des glaciers dans le pays. Dans 20 ans, le Népal risque d’être un désert car il n’y aura plus d’eau. Où vont partir les 30 millions de Népalais ? Ce sont des réfugiés climatiques en puissance ! Ils ne vont pas être les seuls. J’ai récemment rencontré le responsable de Métropolis, l’association mondiale des villes de plus d’un million d’habitants. Il m’a expliqué que ces villes étaient face à une situation catastrophique : d’ici une quinzaine d’années, la plupart des grandes villes côtières vont tout simplement disparaître à cause de la montée des eaux. Où iront les réfugiés climatiques ? Personne n’a la réponse.Est-il trop tard pour changer l’arrivée de ces phénomènes prévus dans les toutes prochaines années ?
Concernant le climat, il est évident que même si nous arrivions aujourd’hui à ne plus produire de gaz à effets de serre, l’inertie est telle que les catastrophes énoncées ci-dessus semblent inéluctables. Il faut désormais travailler sur la résilience, c’est-à-dire sur notre capacité à encaisser les chocs. La disparition des énergies fossiles va bouleverser l’approvisionnement des villes à travers le monde. Il faut savoir qu’une grande ville dispose en moyenne d’une autonomie alimentaire de deux jours. Quand on sait qu’un terrien sur deux vit en ville, c’est très inquiètant.Quelles sont les solutions pour atténuer les chocs à venir ?
Il y en a au moins trois. Il y a d’abord la transition énergétique qui va contrebalancer la fin annoncée des énergies fossiles et des minerais. Ensuite, il y a le développement des monnaies locales. C’est un mouvement déjà en route, partout sur la planète. Rien qu’en France, ce ne sont pas moins de 22 monnaies qui sont en circulation ou en cours de création, dans de grandes villes comme Toulouse, Nantes… Enfin, il y a l’agriculture urbaine qui va jouer un rôle crucial. Là aussi, le mouvement est mondial.Quel est l’intérêt de disposer de monnaies locales ?
Près de 95% des transactions mondiales ne sont que de la spéculation, totalement détachées de l’économie réelle. La monnaie locale, c’est l’inverse : elle ne fonctionne que sur du réel. Cela encourage la consommation de proximité. Et aucun intérêt à thésauriser ces monnaies, elles se déprécient avec le temps pour que, justement, elles ne fassent pas l’objet de spéculation. L’engouement est mondial, du Brésil à l’Allemagne.Et quels sont les avantages réels de l’agriculture urbaine ?
Le fait d’introduire des espaces de productions agricoles dans l’univers urbain constitue un changement fondamental. Cela contribue à améliorer l’autonomie alimentaire des villes, à privilégier le locavorisme, à revaloriser l’image de celui qui travaille la terre, à recréer du lien et à mieux résister aux phénomènes climatiques. Les espaces de production peuvent ainsi mieux absorber les pluies et contrebalancer la bétonisation extrême du milieu urbain.Et pour nourrir la population urbaine, quel va être l’impact de cette agriculture en pleine ville ?
Bien évidemment, cette agriculture ne nourrira pas tout le monde. Mais il ne faudrait pas croire qu’elle soit insignifiante. Correctement développée, elle pourrait nourrir 40% d’une grande ville en fruits, légumes et petits animaux (volailles) selon une étude de l’Université de Toronto. À New York et Chicago, l’élevage de poulets est autorisé depuis quelques années, c’est un signe.Monnaies locales et agriculture urbaine incarnent en quelque sorte l’idée d’une société post-croissance où les notions de bonheur et de richesses prennent un sens différent ?
Il suffit de discuter avec ces acteurs de l’agriculture urbaine pour comprendre que le changement est possible. Je pense notamment à cet ancien trader de la bourse de New York, qui a maintenant les mains dans la terre toute la journée à Toronto. Il gagne dix fois moins mais il est trois plus heureux. Alors oui, ces initiatives doivent nous faire réfléchir sur les notions de croissance, de richesse et de bonheur. L’indice de développement humain (IDH) a été créé il y a maintenant plus de 20 ans et les Nations Unies mènent des réflexions sur de nouveaux indicateurs, notamment sous l’impulsion du Bouthan qui a dirigé des réunions à l’ONU sur le thème : « Le bonheur et le bien-être : définir un nouveau paradigme économique ». Pourtant, quand on analyse les médias, tout le monde répète que la croissance et la consommation sont les solutions pour nous tirer de la crise. Tout indique, au contraire, que la croissance n’est pas la solution, mais le problème !Selon vous, il faut changer de thermomètre pour prendre la mesure de la situation ?
A longueur de journée, les médias ou les responsables politiques nous encouragent à consommer davantage, comme si c’était un acte patriotique ! Mais personne n’est capable de dire tout haut qu’il faut changer totalement de cap si l’on ne veut pas offrir un cadre de vie encore plus dégradé à nos enfants et tuer définitivement notre planète. Il faut désormais être capable de présenter un autre modèle basé sur la coopération, le partage et la solidarité. Ce discours n’est pas utopique, il est vital.Coopération, partage, solidarité, cela veut dire quoi concrètement ?
Il faut penser une société où l’on travaillerait moins pour disposer de plus de temps pour mener des actions de proximité qui visent l’autosuffisance : potager, entretien des équipements, éducation des enfants, aide aux personnes âgées, etc. En termes d’empreinte écologique, cela équivaut à revenir à l’équilibre qui régnait dans les années 60. Aujourd’hui, un pays sert d’exemple pour les experts de l’ONU, il s’agit de Cuba. Après la crise soviétique, le pays a mené, à partir de 2000, une véritable révolution agro-écologique. En moins de dix ans, le pays a mis en place son autosuffisance alimentaire. Cela veut dire que lorsqu’il existe une vraie volonté politique, le changement est possible.http://www.atabula.com/bio-ogm-agro-ecologie-dereglement-climatique-il-est-ici-question-de-la-survie-de-lhumanite/
 Propos recueillis par Franck Pinay-Rabaroust / © A.Pavlov
Propos recueillis par Franck Pinay-Rabaroust / © A.Pavlov

