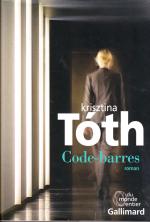
« Code-barres »
TOTH Krisztina
(Gallimard)
Existerait-il des frontières distinctes entre prosatrice et poétesse ? Dans son roman, Krisztina Toth démontre que non. Via une écriture dont la fluidité émerveilla le Lecteur. Via des « climats » qui agissent comme des révélateurs de ce que fut et de ce que devient la Hongrie. Des brumes grisâtres du temps du communisme et de sa violence latente jusqu’aux incertitudes actuelles nimbées elles aussi d’une autre violence, si peu différente de la précédente. Des vies de femmes ou la vie d’une seule et même femme, le livre refermé, le Lecteur ne tranchera pas. Reste ce regard sur un monde qui pour peu que l’on se défît des ses préjugés ressemble étrangement au nôtre. Des souffrances de l’enfant corseté au sein d’une société sclérosée, des maladies qui ravagent des corps qui ne renoncent pas à survivre, jusqu’aux instants de l’indignation et de la rébellion, tous les moments de vies s’additionnent et atteignent à unité qui confère toute sa force au roman.
Le Lecteur laisse à Krisztina Toth le soin d’expliciter son œuvre (interview parue dans Libération en avril 2014).
Pourquoi avez-vous étudié la sculpture plutôt que la littérature ?
Parce que j’étais intéressée par la forme. D’ailleurs, c’est ce qui m’intéresse le plus dans la littérature aussi : la structure. J’aimais la matière. Lorsqu’on crée des objets physiques de ses propres mains, un contact direct, ancestral s’établit avec le monde. Puis j’ai fini par faire des études de lettres.
Est-il exact que vous gagnez votre vie en fabriquant des vitraux ?
Non, pas depuis un bon moment, pourtant j’ai beaucoup aimé cette période-là. Depuis près de dix ans, je vis de la littérature, des droits d’auteur. Néanmoins, il est vrai que, pendant une bonne dizaine d’années, j’ai vécu de la production des vitraux. Les vitraux, j’ai appris à les créer après l’âge de 30 ans, car j’étais éblouie par le verre et je voulais apprendre un nouveau métier. Mais les études de lettres m’étaient tout aussi importantes.
Y a-t-il une équivalence entre le travail du verre et celui des mots ?
S’il y en a une, c’est entre le travail manuel et l’écriture. Dans les deux cas, on regarde vers l’intérieur, et on tâche de créer une structure qui fonctionne. On cherche les proportions justes, le point où le matériel - texte ou surface - supporte encore la tension, l’asymétrie.
Pourquoi être passée de la prose à la poésie ?
La prose, pour moi, est un genre d’un tempo différent, une structure d’une logique différente, il faut réfléchir en unités plus grandes. En poésie, une mélodie de base, une ligne suggestive suffit pour faire jaillir le texte. La prose est à construire minutieusement. Comme nous savons, il ne s’agit pas tant de l’histoire, c’est plutôt l’art de la concentration et des points focaux. L’important se trouve dans le choix de l’objet représenté : quelle est l’histoire qui en cache une autre, plus lointaine.
Qui dit «je» dans Code-barres ? Vous ? Pourquoi la nouvelle parisienne, «Take five (ligne de fracture)», est-elle écrite à la troisième personne ?
L’autobiographie ne m’a jamais attirée, contrairement à l’illusion de la crédibilité. Et celle-ci ne dépend pas du protagoniste, mais du texte, qui doit transmettre quelque chose du monde où nous avons tous vécu ici, en Hongrie. Toutes les histoires typiques de l’époque sont les miennes, et tout m’est arrivé à moi, car quelle que soit la personne qui les raconte, je suis celle qui est capable de les écrire, de les verbaliser. Je suis la voix. Et le canon des Moi divers donne place à la musique que le lecteur devrait entendre. L’histoire parisienne est un contrepoint musical, une histoire distanciée, mais elle fait partie de l’unisson.
Il y a des moments de terreur dans votre livre. Est-ce lié à l’enfance ? Au régime politique ?
En tant que prosateur, toutes les formes sublimées de l’agression et de la tension m’intéressent. Nous vivions dans un monde horrible et mensonger, et je voulais savoir quelles traces il a laissées en nous, ce qui se transmet à la génération suivante. Il n’y a pas de place pour la nostalgie, il faut se souvenir. A l’époque, nous avons grandi avec la culpabilité et avec la présomption que l’autorité, ceux qui sont au-dessus de nous, ont toujours raison. Et que la famille ne peut nous protéger car elle a tout aussi peur. Partout se cachent des secrets, des histoires enterrées. Et elles nous travaillent de l’intérieur, elles font partie de notre corps. Je me souviens du moment, encore enfant, où, d’un seul coup, les événements à l’école me sont devenus indifférents. Je ne voulais plus avoir peur et j’ai décidé de ne plus obéir. Nous devions porter un uniforme et j’avais oublié le mien à la maison. L’institutrice m’a forcée à en porter un qui pourrissait depuis des années au fond d’un placard, car personne ne pouvait assister à la classe sans uniforme. Et j’ai refusé. Moi, non, un point c’est tout. Parce qu’il puait. Donc, on m’a envoyée chez le directeur, et j’ai résisté, tout en répétant que l’uniforme puait. J’ai vu la terreur se dessiner sur son visage. Il m’a fixée d’un regard implorant. Et j’y ai vécu un sentiment de liberté, que l’on ne peut rien faire de moi. Ce sentiment m’accompagne depuis. Et je sais que je ne porterai pas cet uniforme de merde si je ne veux pas.
Pourquoi la maladie et la douleur sont-elles si présentes ?
Vous voyez, le corps reflète le monde, le corps raconte des histoires. Il témoigne des lésions, des expériences personnelles et plus lointaines, disons historiques, à travers la maladie. Dernièrement, on parle beaucoup de la modification du corps, nous brodons et perçons notre corps de motifs barbares, mais nous ne louons pas assez le Seigneur, le temps, qui est le plus grand modificateur du corps. A part la maladie, comme une sorte de contrepoint, l’humour est tout aussi important. Y compris l’humour absurde d’Europe de l’Est, sans lequel la respiration même est impossible dans cette région. Je pense ici à l’héritage de Kafka, d’Orkény, de Mrozek.
Quels poètes français avez-vous préféré traduire ? Lisez-vous des romanciers contemporains ?
J’ai traduit plus d’une cinquantaine d’auteurs français. Chez nous, la traduction littéraire a d’autres traditions, ce sont surtout les poètes qui traduisent la poésie. Les œuvres d’Yves Bonnefoy, de Lionel Ray et de Guy Goffette m’étaient les plus chères à traduire. J’ai aussi traduit Anna Gavalda. Je lis de la prose contemporaine, Jean Echenoz est un de mes favoris, par exemple, et j’ai eu l’occasion de rencontrer Gwenaëlle Aubry. Je pourrais mentionner bien d’autres noms, de registres très divers, comme Jean Rouaud, avec son humour mélancolique, embué, ou encore Eric Holder, dont j’apprécie le côté délicatement absurde.
Pouvez-vous traduire pour nous les titres de tous vos livres ?
Peut-être pas tous, mais quelques-uns certainement : Battement d’un manteau, l’Homme d’ombre, Neige poudreuse, Je t’emmène à la maison, d’accord ?, Pixel,Aquarium, Balle haute.
