Avec une centaine de publications et de rééditions, on aurait pu penser que la commémoration de Mai 68 serait un véritable filon pour le monde de l’édition. Pour autant, il ne semble pas que les lecteurs, confrontés à un choix difficile et lassés des campagnes de promotion médiatique de certains titres (parmi les plus médiocres, d’ailleurs), se soient massivement précipités à l’assaut de la barricade éditoriale dressée sur les tables des librairies.
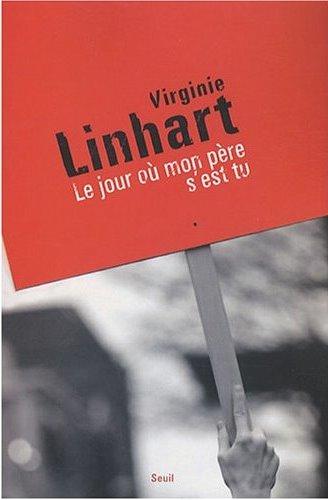
Cependant, parmi tous ces livres, il en est un qui se distingue, tant par le fond que par la forme, Le jour où mon père s’est tu, de Virginie Linhart (Le Seuil, 174 pages, 16€). Documentariste reconnue pour la qualité de ses travaux, l’auteur est aussi la fille de Robert Linhart, « fondateur du mouvement prochinois en France, initiateur du mouvement d’établissement dans les usines. » Linhart est, d’une certaine manière, un homme de paradoxe. Engagé pleinement dans son combat politique, il ne voit pas arriver Mai 68 ; hospitalisé lorsque les événements éclatent, il n’y participe pas. Et, lorsqu’en 1981, François Mitterrand s’installe à l’Elysée, plutôt que de se précipiter, comme tant d’autres, dans les antichambres du pouvoir, il tente de se suicider. S’en suit un long silence, un silence de demi-mort. Virginie Linhart tente de comprendre les raisons du mutisme paternel, mais interroger les compagnons de route ne suffit pas ; elle se tourne alors vers leurs enfants – ses semblables. L’originalité de son livre tient à cette double démarche, la quête et l’enquête : une quête du père et des racines familiales, très personnelle, éprouvante, émouvante et non dénuée de qualités littéraires, à laquelle s’ajoute une enquête auprès des fils et filles des figures marquantes de ces années-là, où l’on reconnait le travail rigoureux de la documentariste.
Furent-ils heureux, ces enfants de l’utopie ? Pas vraiment, pas toujours. Leurs premières souffrances, ils la doivent à une absence des parents et de toute vie familiale ; la plupart 
Autre doléance récurrente, qui pourrait davantage surprendre : « cette difficulté pour un enfant de supporter la liberté des mœurs dont nous étions les témoins involontaires, ce spectacle offert de la liberté des adultes. » Ce sentiment est lourd de signification sur la place réservée au corps dans la société de l’époque et le poids que la religion – assimilant le corps à la honte sous l’influence de Clément d’Alexandrie et Augustin d’Hippone – pouvait exercer, même chez ceux qui l’avaient rejetée. S’en suivait une réaction prévisible : une « obsession de la normalité ». Julie Faguer le souligne : « A l’école, je n’avais qu’une angoisse : c’était qu’on se rende compte combien ça déconnait à la maison ! J’avais le sentiment qu’à mon entrée dans la cour tout le monde allait deviner que mes parents se baladaient à poil chez moi ou avaient des histoires de cul… Par conséquent, je donnais absolument tous les signes de normalité, j’étais une élève irréprochable. »
D’autres constats peuvent sembler plus anecdotiques, mais s’inscrivent toujours dans le malaise que provoquait un mode de vie atypique : absence d’entretien des appartements, dérives du féminisme, discussions politiques sans fin, éducation très (trop ?) libre par certains côtés et très rigide par d’autres. Sans oublier la liberté sexuelle des années 70 qui s’était substituée au mouvement dont elle était issue, une fois le calme revenu. De tous ces témoignages, l’humour n’est pas absent et se fait parfois cruel, comme cette remarque de Claudia Senik concernant la vie communautaire : « Moi, ce que j’ai remarqué, c’est que c’était comme une communauté de singes : il y avait un mâle dominant, dont toutes les femmes étaient amoureuses et qui couchait avec toutes, et les autres mâles qui se faisaient arnaquer. »

Parmi les enfants interrogés, Virginie Linhart s’aperçoit vite que beaucoup sont d’origine juive et s’interroge sur les raisons de l’engagement parental ; cette question donne lieu à un intéressant développement sur la relation qu’elle établit entre Mai 68 et la judéité, qui pourrait se résumer par cette phrase : « 68 comme façon pour les enfants des Juifs rescapés de sortir du statut de survivants, pour affirmer leur appartenance au monde des vivants… »
Ce monde des vivants duquel Robert Linhart s’est volontairement mis en marge. A l’occasion d’une courte rémission au cours de laquelle il fut pris d’une véritable logorrhée verbale, et surtout à force d’observation, Virginie Linhart pense avoir compris le silence de son père. Elle s’en explique dans un chapitre dense où amour et tragédie se mêlent, qu’il faut laisser au lecteur l’émotion de lire.
On peut, ou non, trouver Robert Linhart sympathique ; sa personnalité peut agacer : sa propre fille, qui le définit au fil des pages comme « le grand intellectuel, l’orateur le plus fascinant de sa génération, le stratège politique, le génial écrivain », ne cherche pas à cacher des traits plus sombres de sa personnalité que lui livrent ses camarades de lutte : autoritaire, pas très attentif à l’autre, intransigeant, arrogant, élitiste, méchant. Le lecteur qui ne le connait que de réputation peut s’interroger sur le fait qu’un intellectuel aussi brillant se soit laissé fasciner par une idéologie parmi les plus criminelles du XXe siècle, qu’il ait abdiqué tout esprit critique devant le Petit livre rouge (publié en 1967), véritable florilège de niaiseries (les « tigres de papier », entre autres), de platitudes, de répétitions et de contradictions, sans parler des dangers soulevés par les chapitres traitant de l’autocritique, des enquêtes à mener sur les individus et de la définition du « centralisme démocratique ». Trois citations suffisent à nous édifier : veine bucolique, « Seuls l’idéologie et le régime social du communisme se répandent dans le monde entier avec l’impétuosité de l’avalanche et la force de la foudre ; ils feront fleurir leur merveilleux printemps », lapalissade « La révolution démocratique est la préparation nécessaire de la révolution socialiste, et la révolution socialiste est l’aboutissement logique de la révolution démocratique », enfin, cette dernière perle : « Nous devons soutenir tout ce que notre ennemi combat et combattre tout ce qu’il soutient »… Pierre Dac n’a plus qu’à aller se rhabiller.
Autre sujet d’interrogation : le voyage accompli en Chine par Robert Linhart à l’invitation de Mao ne l’a-t-il pas alerté sur les dérives de l’idéologie ? De son hôtel, il écrit à sa femme : « Hier, nous avons visité une commune populaire ; j’attendais cela depuis 1964 ; c’est aussi bien que nous l’imaginions. C’est la voie lumineuse que prendront tous les affamés du monde, tous les paysans de la zone des ténèbres et des tempêtes. » 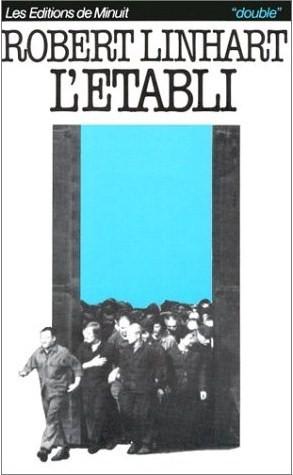
Depuis son enfance, Virginie Linhart s’est toujours vue classée par les autres comme la « fille de… ». Un nom célèbre est toujours lourd à porter ; on n’existe que par référence. Le livre qu’elle vient de publier, et dans lequel son père voit une déclaration d’amour, témoigne qu’elle a réussi le plus difficile dans ce contexte : se faire un prénom.
Illustrations : Affiche de Mao à l’Odéon - Portrait de Robert Linhart.

