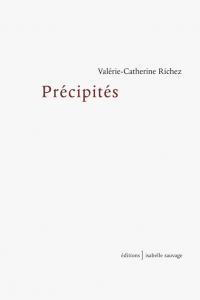 À qui offrir ce cri ?
À qui offrir ce cri ?
Constante.
Les textes en caractères romains précèdent une phrase en italique, brève. Précipité, au singulier, est un substantif qui désigne, en chimie, le « dépôt obtenu quand se produit la précipitation » (1). Ce corps insoluble, en fin de texte, à chaque fois (« chaque » d’ailleurs est disséminé dans les poèmes initiaux).
À l’entrée, mise en abyme : un « miroir zébré de griffures », il révèle des rêveries troubles, des « poissons carnassiers ». Une narration au passé, les temps du récit (plus-que-parfait, imparfait…) l’attestent comme les personnages (inquiétants) liés directement à la narratrice.
« Ce n’était qu’une masse de passé et tu te la racontais en te prenant pour toi. »
Projection consciente, intérieur et extérieur en frontière de réverbération et des pronoms, « on », « nous », « je » si imbriqués qu’ils produisent une confusion entre le dedans et ce qui se reflète. Cette concaténation rebrousse le réel. Nous passons du miroir à la mer par les « poissons carnassiers » pour rester, « incréés », dans la nuit :
« Quelqu’un qu’on ne verra jamais. »
Nouvelle acception du titre : dans le langage courant, « précipité(s) » employé comme participe passé passif désigne un résultat impromptu, subi. Or ces phrases courtes scellent et concluent chacun des textes plus longs, clausule autant donnée qu’incontournable. Les textes courts sont écrits sans alinéas. Parfois un tiret coupe le flux. Les phrases nominales, nombreuses, entérinent un processus, qu’on enregistre comme se déroule un monologue intérieur, « [u]ne voix montée du ventre ». Le flux rapporté dans un lexique maritime récurrent, de « flot » en « ondes ». Ce qui attend, c’est un corps, celui de la narratrice, soumise à ce qui entoure et peut changer. Rien ne se passe que le jeu de persistantes petites lumières et « flocons » sur les « lèvres froides ».
« [M]er », « nuit » : topiques croisés se déversent, les mots abondent et saturent le sens, « [n]ous pouvions encercler de nos bras les boulevards de ceinture ». Autant de pistes, répétées, dispersées, à l’abord des phrases ou en leur clôture, « [d]eux fois plus vaste ». Impossible de cerner, d’établir un chemin clair et confiant. Au milieu, neige et givre, balises éphémères et des interrogations car la certitude abolie engendre des structures de doute :
« À force de verser de la nuit dans la nuit, nous réveillerons-nous ? »
Il faudrait démêler « les branchages enchevêtrés », comment « sans comprendre » ? Là où alternent les verbes à l’infinitif hors le temps, « saluer », « signer », « creuser », « aimer », et les formes d’imparfait qui recalent, à la suite, dans une perspective passée dont le présent est exclu (« Tu savais que tu devais te tenir là »).
Brouillage, constamment, l’affirmation est sapée par la syntaxe, les modes et les temps. Pourtant des éléments quotidiens qui pourraient offrir la sécurité se jouxtent : la ville, les arbustes, un quai, le fleuve… relancés d’un texte à l’autre comme « le film » en début de livre, rappelé par les « images affolantes » plus loin ; mais un adjectif le déstabilise. En cette perception fine du narrateur vit une altération. Est-ce la conscience ou le monde lui-même qui est touché ? Les réseaux lexicaux croisés, démantelés par une qualification qui les menace, produisent une vision inquiétante, aux limites du fantastique, dans laquelle le lecteur se perd. Forcément.
Quelque chose s’est perdu, une langue, son sens :
« Signes effacés en ce moment de mots imprononçables. »
Car un effondrement a signé les blessures et les « cicatrices », altéré la ville (la vie) et celui ou celle qui la perçoit.
« Tu savais que tu devais te tenir là sans comprendre. Plantée dans la terre froide. Sous la voûte épaisse et mouvante. Saluer. Signer. Dire oui à cette affreuse absence. Creuser à nu dans le silence. Aimer, aimer cette lumière noire en attendant que peut-être là-bas une voix se mette à chanter. »
En ce livre, en ce linceul, la peau mordue se souvient, par bribes, au milieu des saccades de « films publicitaires » ou d’ampoules étranges, des « oracles » et des signes. Aux vibrations du cœur ils se mêlent, garants de mémoire et d’oubli dans un morcellement porté par la voix engloutie « [e]n un constant frôlement d’adieu ».
[Isabelle Lévesque]
1Dictionnaire de la langue française Le Robert, deuxième édition dirigée par Alain Rey, 1985
Valérie-Catherine Richez, Précipités, Éditions Isabelle Sauvage, 2014 – 86 pages, 14 €

