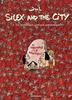Broadway, la scintillante avenue, siège des théâtres et des comédies musicales où se sont créées et jouées certains des shows les plus connus au monde. C’est dans l’un de ces théâtres que va bientôt se jouer la première de Parlez-moi d’amour (What We Talk About When We Talk About Love), adaptée et montée par Riggan Thomson. Autrefois acteur célèbre, il tente désespérément de se prouver qu’il n’est pas encore fini, et décide de reconquérir sa gloire disparue. Autour de lui s’enchaînent les disputes et les imprévus catastrophique, dans un tourbillon de panique fiévreuse qui ne saura qu’aller crescendo jusqu’au soir de la première.
Difficile de décrire vraiment l’histoire de Birdman. S’agit-il de l’odyssée d’une pièce et des difficultés de la monter, des relations écorchées d’une bande d’artistes à fleur de peau, incapables de ne pas se déchirer, ou bien est-ce simplement le délire d’un homme follement égocentrique que les doutes et l’angoisse font lentement sombrer dans la folie ? Il y a un peu de tout ça dans Birdman, et ces nombreux éléments s’entremêlent pour former un récit nerveux et grinçant dont les personnages et leurs sentiments semblent tour à tour extrêmement poignants et étrangement feints, à l’image des rôles qu’ils incarnent sur la scène.
La confusion est entretenue dans la façon dont le monde théâtral se mêle étroitement à la vie réelle, la narration sautant de l’un à l’autre sans à-coup, laissant à peine au spectateur le temps de reprendre ses esprits pour le changer de contexte. S’autorisant à l’occasion une petite incursion dans la réalité fantasmée que se représente Riggan, celle où il ne se distingue pas vraiment du personnage de Birdman qui est en lui.
Birdman lui-même est un membre à part entière de l’histoire. Héros tout puissant et adoré des foules, il semble être tout ce que Riggan Thomson voudrait incarner de nouveau : quelqu’un d’aimé, et capable d’accomplir quelque chose de grand, quelque chose qui a du sens, ce qu’il espère obtenir en menant à bien son projet. Dans sa réalité pourtant, Birdman est devenu une incarnation grotesque de ses incertitudes et de sa peur de ne plus être aimé, de ne plus être à sa place.
Voici le fil conducteur du film : les errances de cet anti-héros à la fois pathétique et poignant, se battant farouchement pour ne pas laisser la petite voix schizophrénique de Birdman l’engloutir dans son sentiment de perdition, l’histoire d’un homme rongé par le doute et la crainte terrible et écrasante, d’être dépassé, d’avoir été abandonné sur le bord de la route tandis que le monde continue de tourner autour de lui. Dépassé par ce monde moderne où l’on ne parle plus que de Facebook et Twitter, où il faut à tout prix faire le buzz pour négocier quelques jours de célébrité, dépassé par ce monde dans lequel il n’est qu’un vieil acteur condamné à regarder les plus jeunes essayer de se faire une place au soleil. Un monde où ses proches se sont peu à peu éloignés pour ne plus dépendre de lui, et incapable pour autant de reporter son attention sur quelqu’un d’autre que sa propre personne, ses propres projets et ses propres déboires.
Les transitions d’une perception à l’autre se font d’autant plus simplement que les scènes sont filmées en longs plans séquence, rendant plus flou encore la frontière entre les différents univers, les différents personnages et leurs points de vue. Le procédé n’est pas si surprenant lorsque l’on considère que le réalisateur, Alejandro González Iñárritu, nous livre ici son troisième film, après 21 grammes et Babel, où il avait déjà pu faire preuve de son goût pour les histoires fragmentées et les liens complexes entre les personnes. Avec Birdman, il nous offre une réflexion profonde sur la nature humaine et la précarité de la gloire, dans un film d’une rare richesse scénaristique et technique.