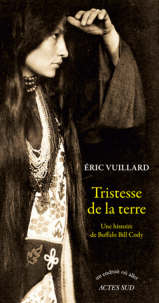 Qu’est-ce que la version officielle de l’Histoire ? Une
manière de la raconter pour faire croire aux hommes, comme à des enfants, qu’on
leur dit la vérité et que la vérité est bonne. Pour démonter ce mécanisme, Eric
Vuillard devient horloger, fouillant d’un regard précis les entrailles d’une
montre, ajustant ici des rouages qui tournaient n’importe comment, là un
ressort à la détente lâche, constatant à la fin, quand tout est en place, que
l’instrument ne donne pas tout à fait la même heure qu’avant.
Congo appliquait la méthode qu’on retrouve dans Tristesse de la terre. Le sous-titre, Une histoire de Buffalo Bill Cody, désigne la clef avec laquelle
l’auteur va ouvrir la montre et exhiber son fonctionnement erratique. Ou, si
l’on préfère, avec laquelle il va prouver pourquoi l’Histoire officielle est un
récit biaisé : « Le spectacle
est l’origine du monde », écrit-il en ouverture…
Avant la première phrase, on se sera arrêté, comme on le
fera à l’entrée de chaque chapitre, sur une image. L’Indien emplumé qui posait
pour la photo ouvre une collection de chromos destinée autant à l’édification
des masses qu’à leur divertissement. Le Wild
West Show, avec Buffalo Bill en tête d’affiche et Sitting Bull en vedette
qu’on ose à peine dire américaine, participe de cette double démarche. Et
attire les foules : quarante mille spectateurs assistent quotidiennement
aux deux représentations, le spectacle se transporte jusqu’en Europe où son
succès est comparable.
La troupe est monstrueuse : plusieurs bateaux ont été
nécessaires pour faire traverser l’océan à ses huit cents personnes, aux
chevaux, aux bisons, aux éléments des chapiteaux, aux décors, etc. Elle se
trouve en France au moment où Buffalo Bill, ce héros qui avait inventé et
laissé répandre sa légende, apprend que s’est produit, en décembre 1890 à
Wounded Knee, un massacre qui deviendra une bataille dans l’imagerie populaire.
Le passage d’un mot à un autre n’a rien d’anodin : Eric Vuillard les
utilise dans deux chapitres distincts. D’un côté, la réalité. De l’autre, sa
transformation après passage dans la moulinette de l’Histoire officielle.
Tristesse
de la terre est
un livre bref et brillant, là où on aurait pu attendre un gros essai.
L’écrivain décrit, relate, glisse une incise, termine sur un chapitre consacré
à Wilson Alwyn Bentley, qui consacra sa vie à photographier des flocons de
neige, le givre, la rosée, sujets très éloignés de l’agitation du Wild West Show, avec ses coups de
fusils, ses attaques, le sang qui coule. C’est la même terre, en moins triste.
Qu’est-ce que la version officielle de l’Histoire ? Une
manière de la raconter pour faire croire aux hommes, comme à des enfants, qu’on
leur dit la vérité et que la vérité est bonne. Pour démonter ce mécanisme, Eric
Vuillard devient horloger, fouillant d’un regard précis les entrailles d’une
montre, ajustant ici des rouages qui tournaient n’importe comment, là un
ressort à la détente lâche, constatant à la fin, quand tout est en place, que
l’instrument ne donne pas tout à fait la même heure qu’avant.
Congo appliquait la méthode qu’on retrouve dans Tristesse de la terre. Le sous-titre, Une histoire de Buffalo Bill Cody, désigne la clef avec laquelle
l’auteur va ouvrir la montre et exhiber son fonctionnement erratique. Ou, si
l’on préfère, avec laquelle il va prouver pourquoi l’Histoire officielle est un
récit biaisé : « Le spectacle
est l’origine du monde », écrit-il en ouverture…
Avant la première phrase, on se sera arrêté, comme on le
fera à l’entrée de chaque chapitre, sur une image. L’Indien emplumé qui posait
pour la photo ouvre une collection de chromos destinée autant à l’édification
des masses qu’à leur divertissement. Le Wild
West Show, avec Buffalo Bill en tête d’affiche et Sitting Bull en vedette
qu’on ose à peine dire américaine, participe de cette double démarche. Et
attire les foules : quarante mille spectateurs assistent quotidiennement
aux deux représentations, le spectacle se transporte jusqu’en Europe où son
succès est comparable.
La troupe est monstrueuse : plusieurs bateaux ont été
nécessaires pour faire traverser l’océan à ses huit cents personnes, aux
chevaux, aux bisons, aux éléments des chapiteaux, aux décors, etc. Elle se
trouve en France au moment où Buffalo Bill, ce héros qui avait inventé et
laissé répandre sa légende, apprend que s’est produit, en décembre 1890 à
Wounded Knee, un massacre qui deviendra une bataille dans l’imagerie populaire.
Le passage d’un mot à un autre n’a rien d’anodin : Eric Vuillard les
utilise dans deux chapitres distincts. D’un côté, la réalité. De l’autre, sa
transformation après passage dans la moulinette de l’Histoire officielle.
Tristesse
de la terre est
un livre bref et brillant, là où on aurait pu attendre un gros essai.
L’écrivain décrit, relate, glisse une incise, termine sur un chapitre consacré
à Wilson Alwyn Bentley, qui consacra sa vie à photographier des flocons de
neige, le givre, la rosée, sujets très éloignés de l’agitation du Wild West Show, avec ses coups de
fusils, ses attaques, le sang qui coule. C’est la même terre, en moins triste.
Magazine Culture
Quatre pages. C'est la belle évocation du Festival Etonnants Voyageurs aujourd'hui dans Libération, par Claire Devarrieux. (Après que Grégoire Leménager, de L'Obs, a expliqué comment il est devenu le plus gros festival littéraire du monde.) On lit ces pages à peu près à l'heure à laquelle la plupart des festivaliers doivent être occupés à se préparer pour prendre le train qui les conduira de Paris à Saint-Malo - et trois jours de rencontres d'une infinie richesse. J'ai dû le dire déjà, Etonnants Voyageurs est la seule manifestation littéraire qui me manque vraiment dans mon île lointaine. Mais je mesure la chance d'avoir l'essentiel, les livres de celles et ceux qui sont là-bas pendant le week-end de Pentecôte. Je leur souhaite du beau temps (il y a trois ans, la dernière fois que j'y suis allé, un froid soudain accompagné d'une pluie de la même température s'était abattu sur la ville le samedi soir, avant de disparaître le lendemain).
Aujourd'hui, premier jour d'Etonnants Voyageurs, on salue Eric Vuillard qui y recevra, demain, le prix Joseph Kessel pour Tristesse de la terre.
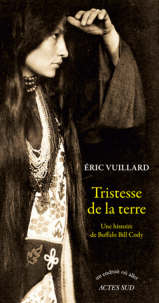 Qu’est-ce que la version officielle de l’Histoire ? Une
manière de la raconter pour faire croire aux hommes, comme à des enfants, qu’on
leur dit la vérité et que la vérité est bonne. Pour démonter ce mécanisme, Eric
Vuillard devient horloger, fouillant d’un regard précis les entrailles d’une
montre, ajustant ici des rouages qui tournaient n’importe comment, là un
ressort à la détente lâche, constatant à la fin, quand tout est en place, que
l’instrument ne donne pas tout à fait la même heure qu’avant.
Congo appliquait la méthode qu’on retrouve dans Tristesse de la terre. Le sous-titre, Une histoire de Buffalo Bill Cody, désigne la clef avec laquelle
l’auteur va ouvrir la montre et exhiber son fonctionnement erratique. Ou, si
l’on préfère, avec laquelle il va prouver pourquoi l’Histoire officielle est un
récit biaisé : « Le spectacle
est l’origine du monde », écrit-il en ouverture…
Avant la première phrase, on se sera arrêté, comme on le
fera à l’entrée de chaque chapitre, sur une image. L’Indien emplumé qui posait
pour la photo ouvre une collection de chromos destinée autant à l’édification
des masses qu’à leur divertissement. Le Wild
West Show, avec Buffalo Bill en tête d’affiche et Sitting Bull en vedette
qu’on ose à peine dire américaine, participe de cette double démarche. Et
attire les foules : quarante mille spectateurs assistent quotidiennement
aux deux représentations, le spectacle se transporte jusqu’en Europe où son
succès est comparable.
La troupe est monstrueuse : plusieurs bateaux ont été
nécessaires pour faire traverser l’océan à ses huit cents personnes, aux
chevaux, aux bisons, aux éléments des chapiteaux, aux décors, etc. Elle se
trouve en France au moment où Buffalo Bill, ce héros qui avait inventé et
laissé répandre sa légende, apprend que s’est produit, en décembre 1890 à
Wounded Knee, un massacre qui deviendra une bataille dans l’imagerie populaire.
Le passage d’un mot à un autre n’a rien d’anodin : Eric Vuillard les
utilise dans deux chapitres distincts. D’un côté, la réalité. De l’autre, sa
transformation après passage dans la moulinette de l’Histoire officielle.
Tristesse
de la terre est
un livre bref et brillant, là où on aurait pu attendre un gros essai.
L’écrivain décrit, relate, glisse une incise, termine sur un chapitre consacré
à Wilson Alwyn Bentley, qui consacra sa vie à photographier des flocons de
neige, le givre, la rosée, sujets très éloignés de l’agitation du Wild West Show, avec ses coups de
fusils, ses attaques, le sang qui coule. C’est la même terre, en moins triste.
Qu’est-ce que la version officielle de l’Histoire ? Une
manière de la raconter pour faire croire aux hommes, comme à des enfants, qu’on
leur dit la vérité et que la vérité est bonne. Pour démonter ce mécanisme, Eric
Vuillard devient horloger, fouillant d’un regard précis les entrailles d’une
montre, ajustant ici des rouages qui tournaient n’importe comment, là un
ressort à la détente lâche, constatant à la fin, quand tout est en place, que
l’instrument ne donne pas tout à fait la même heure qu’avant.
Congo appliquait la méthode qu’on retrouve dans Tristesse de la terre. Le sous-titre, Une histoire de Buffalo Bill Cody, désigne la clef avec laquelle
l’auteur va ouvrir la montre et exhiber son fonctionnement erratique. Ou, si
l’on préfère, avec laquelle il va prouver pourquoi l’Histoire officielle est un
récit biaisé : « Le spectacle
est l’origine du monde », écrit-il en ouverture…
Avant la première phrase, on se sera arrêté, comme on le
fera à l’entrée de chaque chapitre, sur une image. L’Indien emplumé qui posait
pour la photo ouvre une collection de chromos destinée autant à l’édification
des masses qu’à leur divertissement. Le Wild
West Show, avec Buffalo Bill en tête d’affiche et Sitting Bull en vedette
qu’on ose à peine dire américaine, participe de cette double démarche. Et
attire les foules : quarante mille spectateurs assistent quotidiennement
aux deux représentations, le spectacle se transporte jusqu’en Europe où son
succès est comparable.
La troupe est monstrueuse : plusieurs bateaux ont été
nécessaires pour faire traverser l’océan à ses huit cents personnes, aux
chevaux, aux bisons, aux éléments des chapiteaux, aux décors, etc. Elle se
trouve en France au moment où Buffalo Bill, ce héros qui avait inventé et
laissé répandre sa légende, apprend que s’est produit, en décembre 1890 à
Wounded Knee, un massacre qui deviendra une bataille dans l’imagerie populaire.
Le passage d’un mot à un autre n’a rien d’anodin : Eric Vuillard les
utilise dans deux chapitres distincts. D’un côté, la réalité. De l’autre, sa
transformation après passage dans la moulinette de l’Histoire officielle.
Tristesse
de la terre est
un livre bref et brillant, là où on aurait pu attendre un gros essai.
L’écrivain décrit, relate, glisse une incise, termine sur un chapitre consacré
à Wilson Alwyn Bentley, qui consacra sa vie à photographier des flocons de
neige, le givre, la rosée, sujets très éloignés de l’agitation du Wild West Show, avec ses coups de
fusils, ses attaques, le sang qui coule. C’est la même terre, en moins triste.
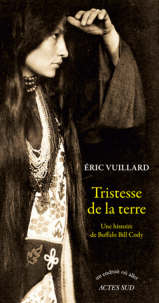 Qu’est-ce que la version officielle de l’Histoire ? Une
manière de la raconter pour faire croire aux hommes, comme à des enfants, qu’on
leur dit la vérité et que la vérité est bonne. Pour démonter ce mécanisme, Eric
Vuillard devient horloger, fouillant d’un regard précis les entrailles d’une
montre, ajustant ici des rouages qui tournaient n’importe comment, là un
ressort à la détente lâche, constatant à la fin, quand tout est en place, que
l’instrument ne donne pas tout à fait la même heure qu’avant.
Congo appliquait la méthode qu’on retrouve dans Tristesse de la terre. Le sous-titre, Une histoire de Buffalo Bill Cody, désigne la clef avec laquelle
l’auteur va ouvrir la montre et exhiber son fonctionnement erratique. Ou, si
l’on préfère, avec laquelle il va prouver pourquoi l’Histoire officielle est un
récit biaisé : « Le spectacle
est l’origine du monde », écrit-il en ouverture…
Avant la première phrase, on se sera arrêté, comme on le
fera à l’entrée de chaque chapitre, sur une image. L’Indien emplumé qui posait
pour la photo ouvre une collection de chromos destinée autant à l’édification
des masses qu’à leur divertissement. Le Wild
West Show, avec Buffalo Bill en tête d’affiche et Sitting Bull en vedette
qu’on ose à peine dire américaine, participe de cette double démarche. Et
attire les foules : quarante mille spectateurs assistent quotidiennement
aux deux représentations, le spectacle se transporte jusqu’en Europe où son
succès est comparable.
La troupe est monstrueuse : plusieurs bateaux ont été
nécessaires pour faire traverser l’océan à ses huit cents personnes, aux
chevaux, aux bisons, aux éléments des chapiteaux, aux décors, etc. Elle se
trouve en France au moment où Buffalo Bill, ce héros qui avait inventé et
laissé répandre sa légende, apprend que s’est produit, en décembre 1890 à
Wounded Knee, un massacre qui deviendra une bataille dans l’imagerie populaire.
Le passage d’un mot à un autre n’a rien d’anodin : Eric Vuillard les
utilise dans deux chapitres distincts. D’un côté, la réalité. De l’autre, sa
transformation après passage dans la moulinette de l’Histoire officielle.
Tristesse
de la terre est
un livre bref et brillant, là où on aurait pu attendre un gros essai.
L’écrivain décrit, relate, glisse une incise, termine sur un chapitre consacré
à Wilson Alwyn Bentley, qui consacra sa vie à photographier des flocons de
neige, le givre, la rosée, sujets très éloignés de l’agitation du Wild West Show, avec ses coups de
fusils, ses attaques, le sang qui coule. C’est la même terre, en moins triste.
Qu’est-ce que la version officielle de l’Histoire ? Une
manière de la raconter pour faire croire aux hommes, comme à des enfants, qu’on
leur dit la vérité et que la vérité est bonne. Pour démonter ce mécanisme, Eric
Vuillard devient horloger, fouillant d’un regard précis les entrailles d’une
montre, ajustant ici des rouages qui tournaient n’importe comment, là un
ressort à la détente lâche, constatant à la fin, quand tout est en place, que
l’instrument ne donne pas tout à fait la même heure qu’avant.
Congo appliquait la méthode qu’on retrouve dans Tristesse de la terre. Le sous-titre, Une histoire de Buffalo Bill Cody, désigne la clef avec laquelle
l’auteur va ouvrir la montre et exhiber son fonctionnement erratique. Ou, si
l’on préfère, avec laquelle il va prouver pourquoi l’Histoire officielle est un
récit biaisé : « Le spectacle
est l’origine du monde », écrit-il en ouverture…
Avant la première phrase, on se sera arrêté, comme on le
fera à l’entrée de chaque chapitre, sur une image. L’Indien emplumé qui posait
pour la photo ouvre une collection de chromos destinée autant à l’édification
des masses qu’à leur divertissement. Le Wild
West Show, avec Buffalo Bill en tête d’affiche et Sitting Bull en vedette
qu’on ose à peine dire américaine, participe de cette double démarche. Et
attire les foules : quarante mille spectateurs assistent quotidiennement
aux deux représentations, le spectacle se transporte jusqu’en Europe où son
succès est comparable.
La troupe est monstrueuse : plusieurs bateaux ont été
nécessaires pour faire traverser l’océan à ses huit cents personnes, aux
chevaux, aux bisons, aux éléments des chapiteaux, aux décors, etc. Elle se
trouve en France au moment où Buffalo Bill, ce héros qui avait inventé et
laissé répandre sa légende, apprend que s’est produit, en décembre 1890 à
Wounded Knee, un massacre qui deviendra une bataille dans l’imagerie populaire.
Le passage d’un mot à un autre n’a rien d’anodin : Eric Vuillard les
utilise dans deux chapitres distincts. D’un côté, la réalité. De l’autre, sa
transformation après passage dans la moulinette de l’Histoire officielle.
Tristesse
de la terre est
un livre bref et brillant, là où on aurait pu attendre un gros essai.
L’écrivain décrit, relate, glisse une incise, termine sur un chapitre consacré
à Wilson Alwyn Bentley, qui consacra sa vie à photographier des flocons de
neige, le givre, la rosée, sujets très éloignés de l’agitation du Wild West Show, avec ses coups de
fusils, ses attaques, le sang qui coule. C’est la même terre, en moins triste.
