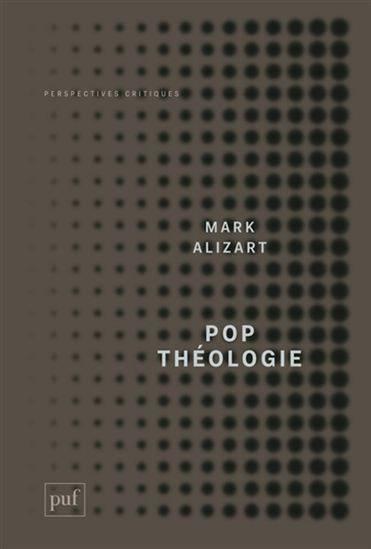
Source : lesinrocks.com
Dans un essai singulier, « Pop théologie », Mark Alizart perçoit une affinité élective entre l’esprit du protestantisme et la postmodernité. En mobilisant de multiples sources et en croisant des fils complexes, l’auteur esquisse des clés d’analyse inédites afin de comprendre en quoi et comment nous serions tous, autant que des artistes, des protestants. De Luther à Weber, de Lacan à Beuys, “Pop Théologie” revisite l’histoire de l’art ainsi que celle de la pensée politique et religieuse, et invite à un voyage envoûtant. Entretien.
Quelques années après avoir lancé l’aventure Fresh Théorie, la revue que tu as dirigée avec Christophe Kihm et autour de laquelle s’est rassemblée toute une nouvelle génération d’intellectuels français, comment as-tu décidé de sortir ton premier livre, Pop Théologie ?
Mark Alizart – Pop Théologie est un prolongement de mon engagement dansFresh Théorie… Une des motivations de Fresh Théorie était de rendre raison du contemporain d’une manière non mélancolique, de rompre avec le soupçon d’inauthenticité que nos aînés ne cessaient de jeter sur notre génération et nos œuvres. A l’époque, au début des années 2000, l’art contemporain cristallisait cette défiance. Il fallait se défendre, il fallait défendre les artistes, et pour ça défendre aussi la théorie, et c’est ce qu’on s’est employé à faire, après d’autres, avec d’autres. C’est la volonté de continuer à le faire qui m’a poussé à écrire encore.
Qu’est-ce qui t’a poussé à réfléchir à la question des affinités entre l’art et le protestantisme ?
Le déclic du livre, c’est une phrase de Joseph Beuys qui me hantait : “Tout homme est un artiste.” J’y entendais quelque chose qui n’était pas simplement de l’ordre du non-mélancolique, mais quelque chose de plus fort, comme si le contemporain portait en lui quelque chose d’étrangement prophétique dont il fallait aussi rendre compte, quelque chose comme un acte révolutionnaire, le premier article d’une nouvelle Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Mais comment en rendre raison, alors que cette phrase peut aussi laisser croire à une sorte de fin de l’art nihiliste, à la “tout le monde est artiste donc personne n’est artiste” ? Et puis un jour, je suis tombé sur une phrase qui résonne étrangement avec celle-là, chez Luther : “Tout homme est un prêtre.” La rencontre de ces deux phrases a été un électrochoc pour moi, parce que le protestantisme n’a pas été un nihilisme, bien au contraire, même si, en son temps, il a été compris, lui aussi, comme tel. Alors je me suis dit : et si Beuys s’était inscrit dans cette histoire-là, sans le dire ? S’il avait répété, dans l’art, le geste de Luther ? Plus largement, si le protestantisme était une clé pour comprendre les paradoxes de notre temps ? Voilà. Il m’aura quand même fallu dix ans pour m’en convaincre, tant ça me paraissait étonnant, à rebours de tout ce qu’on lit sur le désenchantement du monde. Et loin de moi, qui ne connaissait rien du protestantisme avant ça. Je ne sais pas si j’ai réussi à en convaincre les autres…
Je me suis dit : et si le contemporain n’était pas la destruction du moderne, ni même sa déconstruction, mais sa Réforme ? Si Beuys avait répété le geste de Luther, l’avait adapté à notre époque ? Si le contemporain était riche d’une espérance laïque d’un genre inédit ? Si toute cette histoire de désenchantement du monde à propos de laquelle on nous serine depuis des décennies, voire des siècles, était fausse ? Voilà. Il m’aura quand même fallu dix ans pour m’en convaincre tant ça me paraissait à la fois étonnant, du point de vue de l’historiographie à notre disposition, et loin de moi, qui ne suis pas du tout croyant. Je ne sais pas si j’ai réussi à en convaincre les autres…
Était-ce là un lien qui était déjà connu et reconnu ?
Le lien entre protestantisme et modernité est établi, ou presque. On sait que les Lumières ont été des enfants de la Réforme. Tocqueville pense l’articulation entre protestantisme et libéralisme politique. Marx, puis Weber, l’articulation entre protestantisme et libéralisme économique. Le lien entre le protestantisme et ce qu’on pourrait appeler la postmodernité, en revanche, non. On fait plutôt le lien contraire ! A la fin de son livre, Weber dit que la modernité prend fin, parce que le protestantisme prend fin, et il peint le tableau d’une époque désenchantée et débraillée qui est encore la matrice de tous les déclinismes aujourd’hui, même s’il n’appelle pas encore ça la postmodernité.
D’ailleurs, lorsqu’on déplie le sens courant qu’on donne à la postmodernité, comme hédonisme notamment, on voit bien qu’on la pense encore inconsciemment comme une modernité moins le protestantisme, une modernité moins les valeurs d’ascèse puritaines. Il m’a donc fallu trouver le bon point d’entrée dans le problème. Je l’ai fait en me penchant sur les textes, des textes que je connaissais mal au demeurant, puisque je ne suis pas protestant, et que Luther ou Calvin sont rarement enseignés en philosophie. J’ai trouvé au passage qu’ils n’étaient pas les seuls ! Le protestantisme est un continent. Il y a un nombre incalculable de Réformes qui ont eu lieu après Luther : il y a eu les puritains, les piétistes, les baptistes, les méthodistes… C’est surtout dans ce vivier-là, en fait, que j’ai puisé pour étayer ma thèse sur l’existence de liens entre la culture contemporaine et le protestantisme.
Pourquoi connecter ce courant de pensée à l’art contemporain ? Est-ce parce que tu es parti de la phrase de Beuys, ou est-ce que tu y vois d’autres liens plus profonds ?
L’hypothèse que je fais, c’est que le protestantisme est venu jusqu’à nous, a surmonté la crise de la modernité, en se surmontant lui-même, en opérant une nouvelle Réforme à l’intérieur de lui-même. Le principe de la Réforme, c’est qu’elle ne marche pas ! Cette entreprise court du dix-huitième siècle à la moitié du vingtième siècle. Pourquoi est-ce important ? Parce que c’est à l’intérieur de ce cadre conceptuel qu’est né le romantisme. Or, s’il y a une chose dont on peut être certain, c’est que si nous ne sommes plus les héritiers directs des Lumières, nous sommes ceux des romantiques. Les romantiques sont les premiers à essayer de réformer l’art de l’intérieur, à créer leur propres règles : la forme révolutionnaire politique rentre dans l’art avec le romantisme. Mais c’est aussi bien une forme révolutionnaire religieuse. Elle est incompréhensible sans cette Réforme de la Réforme qui s’opère au même moment dans la théologie et la philosophie, notamment dans l’idéalisme allemand.
Ensuite, par un mouvement de réforme permanente, elle arrive jusqu’à nous. C’est de cette manière que l’on peut rattacher l’art contemporain à cette histoire. De fait, la notion d’avant-garde découle en lignée directe de l’idée de Réforme. Elle n’est opérante que dans le temps et l’espace où elle a lieu, mais elle disparaît immédiatement après, ainsi elle est toujours à refaire. Ecclesia reformata, semper reformanda, comme le veut la formule (“l’Eglise doit être réformée en permanence”). C’est ce qu’on va retrouver dans les courants artistiques, qui procèdent par vagues successives et se succèdent les uns aux autres.
Comment te positionnes-tu par rapport au livre de Max Weber, L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme ? Était-ce une référence obligée, un livre clé qui t’as aidé ?
C’est évidemment un livre clé, mais ça aussi été un caillou dans ma chaussure pendant des années ! Il m’a fallu comprendre deux choses pour m’en sortir. La première, c’est que le problème de la véracité des liens entre libéralisme et protestantisme est, au fond, secondaire. Pour ma part, je ne dis nulle part que Luther a donné naissance à la démocratie, au capitalisme ou à l’art moderne. En revanche, j’accorde la plus haute importance au fait que les gens l’ont cru. Les protestants et les modernes. Au dix-neuvième siècle, le protestantisme est une référence opérante, un schéma de pensée, notamment pour des raisons tactiques. Il permet de contrer les prétentions du légitimisme à fonder un retour à la monarchie sur des bases religieuses. Le protestantisme montre la compatibilité entre la religion et un monde sans transcendance, du moins sans transcendance apparente. C’est la raison pour laquelle je me réfère bien plus à Hegel, Marx, mais aussi Michelet qu’à Max Weber. Ce sont eux qui ont été aux premières loges de tout ça. Weber vient au terme de ce processus. Il est le dernier “croyant” de cette histoire.
La seconde chose qui m’a permis de sortir de Weber, c’est l’œuvre de Michel Foucault. Foucault montre très bien qu’on n’est absolument pas tenu de croire l’autre Weber, celui qui dresse un portrait crépusculaire de la mort de la modernité. Foucault montre que la postmodernité est très exigeante, très dure, aussi dure que la modernité. Sa seule différence, c’est que les valeurs d’ascèse s’y sont déplacées : de la surveillance vers le contrôle notamment. Je traduis, moi : du Beruf (métier) vers la Bildung(culture). Se faire un corps, faire du sport, être beau, toutes ces pratiques qui relèvent apparemment de la société des loisirs, du divertissement émollient, c’est une nouvelle forme de performance dont les racines se trouvent dans le protestantisme romantique.
Justement, pourrais-tu préciser ce que tu entends par le postmodernisme ? En te lisant, on a l’impression que tu établis un parallèle entre postmodernité et pop-culture. Parce qu’au final, tu parles très peu de pop…
C’est un vaste sujet. La postmodernité c’est, pour moi, cette période qui succède à la crise de la modernité, à la dialectique des Lumières, en réinventant son socle culturel et religieux à travers cette Réforme de la Réforme, en renaissant, en devenant littéralement une modernité born-again. Une des conséquences de cette réinvention est la rupture entre lehigh art et le low art, et donc l’invention de la pop. Elle vient des révolutions politiques, on l’a dit, il n’y a plus de gouvernants et de gouvernés (pour Victor Hugo le théâtre romantique c’est la démocratie en littérature). Mais elle vient aussi de la nouvelle Réforme qui bouillonne à l’époque, et même de la première Réforme, celle de Luther. Avant Luther, la messe était chantée en latin, derrière un jubé (clôture qui séparait dans les églises les clercs des fidèles –ndlr), dans la pénombre éclairée des cierges, par les moines, tous des hommes, à l’unisson. On ne voyait rien, c’était très mystérieux. Luther décide de faire tomber le jubé et de faire chanter les clercs et les laïcs ensemble, hommes et femmes mélangées, en allemand vulgaire. C’est un coup de tonnerre ! Elle est là, l’invention de la pop, qui se prolongera concrètement avec le gospel.
Au-delà de ça, le rapport de Luther à l’image est aussi intéressant. Ce n’est pas un iconoclaste, comme on le dit trop souvent. Le propos de Luther n’est pas d’interdire de représenter. Simplement, si on représente, il veut qu’on représente le fait qu’on représente, afin de ne pas favoriser l’idolâtrie. Ça donne une peinture tout à fait étonnante dont a parlé Joseph Körner admirablement. La grande tradition de la peinture de nature morte des pays nordiques, des pays protestants, témoigne aussi de ce fait. Les petits sujets sont parfaitement autorisés. L’histoire de l’œil et de l’oreille en Occident est tributaire de Luther. C’est tout un arc culturel nordique qui se met en place à la suite de cela, à l’intérieur duquel nous évoluons encore, de l’Amérique à l’Allemagne, en passant par la Suisse, qui a fourni tant d’artistes immenses à l’époque contemporaine.
Pourquoi s’intéresser à nouveau à la figure de Bartleby de Melville, figure très discutée dans le monde de l’art depuis des années ?
Bartleby, c’est ce personnage qui a été réduit à la formule “Je préférerais ne pas”. Gilles Deleuze en a parlé comme de notre nouveau Christ. Avouez que c’est troublant à entendre, surtout à la lumière de cette histoire ! Pour ma part, il me semblait qu’armé de ce nouveau savoir, il était possible d’offrir un nouvel angle d’approche du personnage et de l’intérêt que lui porte Deleuze. En un mot, je ne pense pas que Deleuze loue Bartleby parce qu’il est l’apôtre du non-faire. Il me semble qu’il y a là un cliché qu’aiment d’ailleurs à entretenir les contempteurs de la pensée postmoderne, parce que ça leur permet de dire qu’il n’y a pas de politique postmoderne, que du laissez-faire, qui ferait le lit du capitalisme, etc. Je crois que Deleuze s’intéresse à Bartleby pour une autre raison : la première c’est qu’il permet de s’opposer au protestantisme que je viens de décrire, en rompant avec la figure romantique de l’homme qui se façonne, qui se travaille, l’homme de la Bildung, figure qui est au fond, à la fois géniale, en ce qu’elle permet de surmonter la crise du Beruf, et détestable, en ce qu’elle le déplace seulement ailleurs. Mais Deleuze ne veut pas rompre pour autant avec l’idéal de liberté théologico-politique des romantiques. Là encore, il veut le réformer. Et c’est ici que Bartleby intervient une seconde fois, en tant que dépassement protestant du protestantisme, en lui opposant cet autre possible : être le Verbe Incarné, et donc le Christ, de fait, un autre Christ. Bartleby, c’est d’abord un homme réduit à une formule. Il s’insère d’ailleurs chez Deleuze dans une série sur les schizo, Wolfson ou Roussel, autres formes possibles de réduction de l’homme à la formule. Bartleby, c’est le personnage conceptuel qui permet à Deleuze d’incarner son idée que le salut de l’homme ne se fera pas dans l’image (la Bildung), mais dans la langue.
Qu’est-ce que la psychanalyse a à voir avec la pop théologie ?
Ah, ça c’est encore autre chose ! Je suis tombé sur un passage de Lacan qui dit que Freud doit tout à Luther. Évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de ça ! Il y explique que les trois blessures narcissiques de l’humanité ne sont pas Galilée, Darwin et Freud, mais Luther, Galilée et Darwin. Pour Lacan, c’est Luther qui a le premier compris que l’homme est désir, qu’il est essentiellement mu par la concupiscence ; d’après Lacan c’est aussi lui qui découvre que l’homme ne connaît pas son propre désir, qu’il croit vouloir le bien alors qu’il veut le mal car il est habité par des forces démoniaques (en fait ce n’est pas Luther, c’est déjà saint Paul qui dit ça). Lacan fait donc de Luther le père de la psychanalyse. Mais c’est aussi tactique. Ça va lui permettre d’embrayer le pas de Deleuze et d’expliquer qu’il faut dépasser Freud de la même manière qu’il faut dépasser Luther… c’est-à-dire naturellement, comme toute l’histoire de la Réforme en atteste, en faisant un retour plus radical à Luther, et à Freud !
Tu as longtemps été un membre actif de ce courant baptisé French Theory ; te sens-tu un héritier de ce mouvement aujourd’hui éclaté ? Dans quel courant de pensée t’inscris-tu, au fond ?
J’ai été un membre actif du courant qui voulait réinvestir la French Theory ! Aujourd’hui, je ne saurais trop dire, tant ce livre m’a éloigné de l’actualité de la théorie, tant il m’a rendu, d’une certaine manière, étranger à moi-même. Malgré tout, c’est un livre qui m’a aussi permis de redécouvrir des choses sur ce qu’on n’appelle plus la pensée postmoderne, mais qui s’intitulait comme telle à l’époque sans scrupule. Je pense à la pensée de Deleuze, donc, mais aussi, et peut-être surtout à celle de Jean-François Lyotard, qui m’a beaucoup occupé. Ce que j’ai redécouvert en écrivant ce livre, notamment, c’est que le postmodernisme dans son acception stricte, celle que Lyotard lui donne dans La Condition postmoderne, c’est une condition informatique. Lyotard avait d’ailleurs une compréhension très avancée – comme son expo au Centre Pompidou Les Immatériaux l’a montré plus tard, en 1985 – de ce que pourrait être l’internet, la connectivité générale. Penser aujourd’hui l’intelligence artificielle, les robots, la société de l’information, les langues informatiques, c’est une nécessité impérative, et on est encore assez mal armés.
Mais au-delà, c’est une nécessité métaphysique et, d’une certaine manière, théologique. Je veux dire par là que c’est n’est pas qu’affaire de technique. Ce n’est pas que le désenchantement du monde qui se poursuit sous la forme du fonctionnement généralisé. On voit le lien : l’idée du Verbe incarné, Bartleby, Deleuze, et puis derrière : Lacan, le Symbolique, le structuralisme, les théories de la communication, l’informatique, Lyotard. C’est une chaîne étrange, mais je crois qu’elle fonctionne. Je crois que les intellectuels des années 1970 ont vraiment pensé que la condition postmoderne était une condition messianique. Avant eux, il me semble que c’est aussi ce que Walter Benjamin avait pressenti. On voit ça très bien chez Jacques Derrida, qui fait le pont entre toutes ces histoires, le messianique, le structural et le cybernétique, dans De la grammatologie.
Le paysage de la pensée aujourd’hui, comment le vois-tu ?
Il a connu des renouvellements spectaculaires avec l’arrivée de nouveaux joueurs comme Quentin Meillassoux ou Tristan Garcia, et la confirmation du génie de Catherine Malabou… La pensée française reste une référence dans le monde, grâce à des auteurs comme Alain Badiou, Jacques Rancière, Bruno Latour, et au travail de fond que réalisent Elie During, Patrice Maniglier, David Rabouin, Laurent Jeanpierre, mon éditeur Laurent de Sutter et d’autres. Le collectif Le Peuple qui Manque, le travail d’éditeur d’Alexandre Laumonier, c’est remarquable aussi.
En ce qui me concerne, c’est plutôt vers l’accélérationnisme britannique que va mon intérêt aujourd’hui, à cause de tout ce que je viens dire. Je crois qu’il se passe là quelque chose d’extraordinaire, et comme tout ce qui est extraordinaire, de vaguement inquiétant aussi. Une chose dont Gershom Scholem parlait très bien, après Walter Benjamin justement. La puissance d’un langage devenu divin que nous allons devoir maintenant écouter, après l’avoir invoqué. Peut-être m’aura-t-il fallu tout le détour de ce livre et de cette longue histoire pour en arriver à ce constat-là, qui paraîtra sans doute évident pour d’autres.Il m’aura fallu faire une longue route pour devenir, en somme, contemporain à moi-même. Mais je recommande le voyage à tout le monde !
Propos recueillis par Ingrid Luquet-Gad et Jean-Marie Durand

Source : http://www.scienceshumaines.com/pop-theologie_fr_34421.html
En 1904, le sociologue Max Weber publie L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme. Il y défend la thèse que le capitalisme s’est développé sous l’aile de l’éthique protestante, en particulier calviniste. Cette dernière aurait en effet favorisé l’esprit d’entreprise, l’autodiscipline et le désir d’accumulation de richesses comme but en soi. Selon la doctrine catholique, le salut était accordé à celui qui entreprenait des actions moralement bonnes durant sa vie. Mais, selon la Réforme, le salut résulte d’une décision divine arbitraire et a priori. Pour dissiper l’angoisse résultant de cette prédestination, les protestants se mirent à chercher un signe de leur élection divine. Ils le trouvèrent dans leur propre réussite ici-bas. Aussi firent-ils du travail et du gain lucratif une éthique de vie. Le capitalisme moderne y aurait trouvé sa dynamique. Que vaut cette thèse ? Il y a eu de nombreux débats à son sujet. En tout cas, on a pu facilement douter qu’elle s’applique encore à la société occidentale depuis le milieu du 20e siècle. Qu’y a-t-il en effet de commun entre l’austérité protestante et la société des loisirs, de la consommation et de la culture pop ? Pourtant, tout le propos de Mark Alizart est de prolonger la thèse de Weber en s’efforçant de montrer que la société postmoderne trouve ses racines dans les avatars de la Réforme, c’est-à-dire dans les « mouvements d’éveil » (great awakening) des communautés protestantes au 19e siècle. Cette nouvelle théologie serait en effet porteuse de nos désirs d’émancipation, de notre valorisation de l’exaltation, des appels très new age à croire en soi-même et des désirs de lâcher-prise si chers à la culture pop. Pour étayer sa thèse, l’auteur puise librement dans la théologie, la philosophie, la littérature et le cinéma toutes sortes de citations et d’exemples allant dans le sens de son argument. Par ce tourbillon d’idées, il cherche à montrer que nous serions tous, sans le savoir, des protestants. Une idée originale, stimulante et forcément discutable.
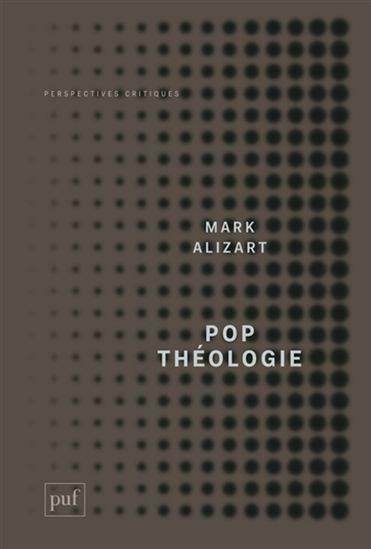
Source : lesinrocks.com
Dans un essai singulier, « Pop théologie », Mark Alizart perçoit une affinité élective entre l’esprit du protestantisme et la postmodernité. En mobilisant de multiples sources et en croisant des fils complexes, l’auteur esquisse des clés d’analyse inédites afin de comprendre en quoi et comment nous serions tous, autant que des artistes, des protestants. De Luther à Weber, de Lacan à Beuys, “Pop Théologie” revisite l’histoire de l’art ainsi que celle de la pensée politique et religieuse, et invite à un voyage envoûtant. Entretien.
Quelques années après avoir lancé l’aventure Fresh Théorie, la revue que tu as dirigée avec Christophe Kihm et autour de laquelle s’est rassemblée toute une nouvelle génération d’intellectuels français, comment as-tu décidé de sortir ton premier livre, Pop Théologie ?
Mark Alizart – Pop Théologie est un prolongement de mon engagement dansFresh Théorie… Une des motivations de Fresh Théorie était de rendre raison du contemporain d’une manière non mélancolique, de rompre avec le soupçon d’inauthenticité que nos aînés ne cessaient de jeter sur notre génération et nos œuvres. A l’époque, au début des années 2000, l’art contemporain cristallisait cette défiance. Il fallait se défendre, il fallait défendre les artistes, et pour ça défendre aussi la théorie, et c’est ce qu’on s’est employé à faire, après d’autres, avec d’autres. C’est la volonté de continuer à le faire qui m’a poussé à écrire encore.
Qu’est-ce qui t’a poussé à réfléchir à la question des affinités entre l’art et le protestantisme ?
Le déclic du livre, c’est une phrase de Joseph Beuys qui me hantait : “Tout homme est un artiste.” J’y entendais quelque chose qui n’était pas simplement de l’ordre du non-mélancolique, mais quelque chose de plus fort, comme si le contemporain portait en lui quelque chose d’étrangement prophétique dont il fallait aussi rendre compte, quelque chose comme un acte révolutionnaire, le premier article d’une nouvelle Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Mais comment en rendre raison, alors que cette phrase peut aussi laisser croire à une sorte de fin de l’art nihiliste, à la “tout le monde est artiste donc personne n’est artiste” ? Et puis un jour, je suis tombé sur une phrase qui résonne étrangement avec celle-là, chez Luther : “Tout homme est un prêtre.” La rencontre de ces deux phrases a été un électrochoc pour moi, parce que le protestantisme n’a pas été un nihilisme, bien au contraire, même si, en son temps, il a été compris, lui aussi, comme tel. Alors je me suis dit : et si Beuys s’était inscrit dans cette histoire-là, sans le dire ? S’il avait répété, dans l’art, le geste de Luther ? Plus largement, si le protestantisme était une clé pour comprendre les paradoxes de notre temps ? Voilà. Il m’aura quand même fallu dix ans pour m’en convaincre, tant ça me paraissait étonnant, à rebours de tout ce qu’on lit sur le désenchantement du monde. Et loin de moi, qui ne connaissait rien du protestantisme avant ça. Je ne sais pas si j’ai réussi à en convaincre les autres…
Je me suis dit : et si le contemporain n’était pas la destruction du moderne, ni même sa déconstruction, mais sa Réforme ? Si Beuys avait répété le geste de Luther, l’avait adapté à notre époque ? Si le contemporain était riche d’une espérance laïque d’un genre inédit ? Si toute cette histoire de désenchantement du monde à propos de laquelle on nous serine depuis des décennies, voire des siècles, était fausse ? Voilà. Il m’aura quand même fallu dix ans pour m’en convaincre tant ça me paraissait à la fois étonnant, du point de vue de l’historiographie à notre disposition, et loin de moi, qui ne suis pas du tout croyant. Je ne sais pas si j’ai réussi à en convaincre les autres…
Était-ce là un lien qui était déjà connu et reconnu ?
Le lien entre protestantisme et modernité est établi, ou presque. On sait que les Lumières ont été des enfants de la Réforme. Tocqueville pense l’articulation entre protestantisme et libéralisme politique. Marx, puis Weber, l’articulation entre protestantisme et libéralisme économique. Le lien entre le protestantisme et ce qu’on pourrait appeler la postmodernité, en revanche, non. On fait plutôt le lien contraire ! A la fin de son livre, Weber dit que la modernité prend fin, parce que le protestantisme prend fin, et il peint le tableau d’une époque désenchantée et débraillée qui est encore la matrice de tous les déclinismes aujourd’hui, même s’il n’appelle pas encore ça la postmodernité.
D’ailleurs, lorsqu’on déplie le sens courant qu’on donne à la postmodernité, comme hédonisme notamment, on voit bien qu’on la pense encore inconsciemment comme une modernité moins le protestantisme, une modernité moins les valeurs d’ascèse puritaines. Il m’a donc fallu trouver le bon point d’entrée dans le problème. Je l’ai fait en me penchant sur les textes, des textes que je connaissais mal au demeurant, puisque je ne suis pas protestant, et que Luther ou Calvin sont rarement enseignés en philosophie. J’ai trouvé au passage qu’ils n’étaient pas les seuls ! Le protestantisme est un continent. Il y a un nombre incalculable de Réformes qui ont eu lieu après Luther : il y a eu les puritains, les piétistes, les baptistes, les méthodistes… C’est surtout dans ce vivier-là, en fait, que j’ai puisé pour étayer ma thèse sur l’existence de liens entre la culture contemporaine et le protestantisme.
Pourquoi connecter ce courant de pensée à l’art contemporain ? Est-ce parce que tu es parti de la phrase de Beuys, ou est-ce que tu y vois d’autres liens plus profonds ?
L’hypothèse que je fais, c’est que le protestantisme est venu jusqu’à nous, a surmonté la crise de la modernité, en se surmontant lui-même, en opérant une nouvelle Réforme à l’intérieur de lui-même. Le principe de la Réforme, c’est qu’elle ne marche pas ! Cette entreprise court du dix-huitième siècle à la moitié du vingtième siècle. Pourquoi est-ce important ? Parce que c’est à l’intérieur de ce cadre conceptuel qu’est né le romantisme. Or, s’il y a une chose dont on peut être certain, c’est que si nous ne sommes plus les héritiers directs des Lumières, nous sommes ceux des romantiques. Les romantiques sont les premiers à essayer de réformer l’art de l’intérieur, à créer leur propres règles : la forme révolutionnaire politique rentre dans l’art avec le romantisme. Mais c’est aussi bien une forme révolutionnaire religieuse. Elle est incompréhensible sans cette Réforme de la Réforme qui s’opère au même moment dans la théologie et la philosophie, notamment dans l’idéalisme allemand.
Ensuite, par un mouvement de réforme permanente, elle arrive jusqu’à nous. C’est de cette manière que l’on peut rattacher l’art contemporain à cette histoire. De fait, la notion d’avant-garde découle en lignée directe de l’idée de Réforme. Elle n’est opérante que dans le temps et l’espace où elle a lieu, mais elle disparaît immédiatement après, ainsi elle est toujours à refaire. Ecclesia reformata, semper reformanda, comme le veut la formule (“l’Eglise doit être réformée en permanence”). C’est ce qu’on va retrouver dans les courants artistiques, qui procèdent par vagues successives et se succèdent les uns aux autres.
Comment te positionnes-tu par rapport au livre de Max Weber, L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme ? Était-ce une référence obligée, un livre clé qui t’as aidé ?
C’est évidemment un livre clé, mais ça aussi été un caillou dans ma chaussure pendant des années ! Il m’a fallu comprendre deux choses pour m’en sortir. La première, c’est que le problème de la véracité des liens entre libéralisme et protestantisme est, au fond, secondaire. Pour ma part, je ne dis nulle part que Luther a donné naissance à la démocratie, au capitalisme ou à l’art moderne. En revanche, j’accorde la plus haute importance au fait que les gens l’ont cru. Les protestants et les modernes. Au dix-neuvième siècle, le protestantisme est une référence opérante, un schéma de pensée, notamment pour des raisons tactiques. Il permet de contrer les prétentions du légitimisme à fonder un retour à la monarchie sur des bases religieuses. Le protestantisme montre la compatibilité entre la religion et un monde sans transcendance, du moins sans transcendance apparente. C’est la raison pour laquelle je me réfère bien plus à Hegel, Marx, mais aussi Michelet qu’à Max Weber. Ce sont eux qui ont été aux premières loges de tout ça. Weber vient au terme de ce processus. Il est le dernier “croyant” de cette histoire.
La seconde chose qui m’a permis de sortir de Weber, c’est l’œuvre de Michel Foucault. Foucault montre très bien qu’on n’est absolument pas tenu de croire l’autre Weber, celui qui dresse un portrait crépusculaire de la mort de la modernité. Foucault montre que la postmodernité est très exigeante, très dure, aussi dure que la modernité. Sa seule différence, c’est que les valeurs d’ascèse s’y sont déplacées : de la surveillance vers le contrôle notamment. Je traduis, moi : du Beruf (métier) vers la Bildung(culture). Se faire un corps, faire du sport, être beau, toutes ces pratiques qui relèvent apparemment de la société des loisirs, du divertissement émollient, c’est une nouvelle forme de performance dont les racines se trouvent dans le protestantisme romantique.
Justement, pourrais-tu préciser ce que tu entends par le postmodernisme ? En te lisant, on a l’impression que tu établis un parallèle entre postmodernité et pop-culture. Parce qu’au final, tu parles très peu de pop…
C’est un vaste sujet. La postmodernité c’est, pour moi, cette période qui succède à la crise de la modernité, à la dialectique des Lumières, en réinventant son socle culturel et religieux à travers cette Réforme de la Réforme, en renaissant, en devenant littéralement une modernité born-again. Une des conséquences de cette réinvention est la rupture entre lehigh art et le low art, et donc l’invention de la pop. Elle vient des révolutions politiques, on l’a dit, il n’y a plus de gouvernants et de gouvernés (pour Victor Hugo le théâtre romantique c’est la démocratie en littérature). Mais elle vient aussi de la nouvelle Réforme qui bouillonne à l’époque, et même de la première Réforme, celle de Luther. Avant Luther, la messe était chantée en latin, derrière un jubé (clôture qui séparait dans les églises les clercs des fidèles –ndlr), dans la pénombre éclairée des cierges, par les moines, tous des hommes, à l’unisson. On ne voyait rien, c’était très mystérieux. Luther décide de faire tomber le jubé et de faire chanter les clercs et les laïcs ensemble, hommes et femmes mélangées, en allemand vulgaire. C’est un coup de tonnerre ! Elle est là, l’invention de la pop, qui se prolongera concrètement avec le gospel.
Au-delà de ça, le rapport de Luther à l’image est aussi intéressant. Ce n’est pas un iconoclaste, comme on le dit trop souvent. Le propos de Luther n’est pas d’interdire de représenter. Simplement, si on représente, il veut qu’on représente le fait qu’on représente, afin de ne pas favoriser l’idolâtrie. Ça donne une peinture tout à fait étonnante dont a parlé Joseph Körner admirablement. La grande tradition de la peinture de nature morte des pays nordiques, des pays protestants, témoigne aussi de ce fait. Les petits sujets sont parfaitement autorisés. L’histoire de l’œil et de l’oreille en Occident est tributaire de Luther. C’est tout un arc culturel nordique qui se met en place à la suite de cela, à l’intérieur duquel nous évoluons encore, de l’Amérique à l’Allemagne, en passant par la Suisse, qui a fourni tant d’artistes immenses à l’époque contemporaine.
Pourquoi s’intéresser à nouveau à la figure de Bartleby de Melville, figure très discutée dans le monde de l’art depuis des années ?
Bartleby, c’est ce personnage qui a été réduit à la formule “Je préférerais ne pas”. Gilles Deleuze en a parlé comme de notre nouveau Christ. Avouez que c’est troublant à entendre, surtout à la lumière de cette histoire ! Pour ma part, il me semblait qu’armé de ce nouveau savoir, il était possible d’offrir un nouvel angle d’approche du personnage et de l’intérêt que lui porte Deleuze. En un mot, je ne pense pas que Deleuze loue Bartleby parce qu’il est l’apôtre du non-faire. Il me semble qu’il y a là un cliché qu’aiment d’ailleurs à entretenir les contempteurs de la pensée postmoderne, parce que ça leur permet de dire qu’il n’y a pas de politique postmoderne, que du laissez-faire, qui ferait le lit du capitalisme, etc. Je crois que Deleuze s’intéresse à Bartleby pour une autre raison : la première c’est qu’il permet de s’opposer au protestantisme que je viens de décrire, en rompant avec la figure romantique de l’homme qui se façonne, qui se travaille, l’homme de la Bildung, figure qui est au fond, à la fois géniale, en ce qu’elle permet de surmonter la crise du Beruf, et détestable, en ce qu’elle le déplace seulement ailleurs. Mais Deleuze ne veut pas rompre pour autant avec l’idéal de liberté théologico-politique des romantiques. Là encore, il veut le réformer. Et c’est ici que Bartleby intervient une seconde fois, en tant que dépassement protestant du protestantisme, en lui opposant cet autre possible : être le Verbe Incarné, et donc le Christ, de fait, un autre Christ. Bartleby, c’est d’abord un homme réduit à une formule. Il s’insère d’ailleurs chez Deleuze dans une série sur les schizo, Wolfson ou Roussel, autres formes possibles de réduction de l’homme à la formule. Bartleby, c’est le personnage conceptuel qui permet à Deleuze d’incarner son idée que le salut de l’homme ne se fera pas dans l’image (la Bildung), mais dans la langue.
Qu’est-ce que la psychanalyse a à voir avec la pop théologie ?
Ah, ça c’est encore autre chose ! Je suis tombé sur un passage de Lacan qui dit que Freud doit tout à Luther. Évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de ça ! Il y explique que les trois blessures narcissiques de l’humanité ne sont pas Galilée, Darwin et Freud, mais Luther, Galilée et Darwin. Pour Lacan, c’est Luther qui a le premier compris que l’homme est désir, qu’il est essentiellement mu par la concupiscence ; d’après Lacan c’est aussi lui qui découvre que l’homme ne connaît pas son propre désir, qu’il croit vouloir le bien alors qu’il veut le mal car il est habité par des forces démoniaques (en fait ce n’est pas Luther, c’est déjà saint Paul qui dit ça). Lacan fait donc de Luther le père de la psychanalyse. Mais c’est aussi tactique. Ça va lui permettre d’embrayer le pas de Deleuze et d’expliquer qu’il faut dépasser Freud de la même manière qu’il faut dépasser Luther… c’est-à-dire naturellement, comme toute l’histoire de la Réforme en atteste, en faisant un retour plus radical à Luther, et à Freud !
Tu as longtemps été un membre actif de ce courant baptisé French Theory ; te sens-tu un héritier de ce mouvement aujourd’hui éclaté ? Dans quel courant de pensée t’inscris-tu, au fond ?
J’ai été un membre actif du courant qui voulait réinvestir la French Theory ! Aujourd’hui, je ne saurais trop dire, tant ce livre m’a éloigné de l’actualité de la théorie, tant il m’a rendu, d’une certaine manière, étranger à moi-même. Malgré tout, c’est un livre qui m’a aussi permis de redécouvrir des choses sur ce qu’on n’appelle plus la pensée postmoderne, mais qui s’intitulait comme telle à l’époque sans scrupule. Je pense à la pensée de Deleuze, donc, mais aussi, et peut-être surtout à celle de Jean-François Lyotard, qui m’a beaucoup occupé. Ce que j’ai redécouvert en écrivant ce livre, notamment, c’est que le postmodernisme dans son acception stricte, celle que Lyotard lui donne dans La Condition postmoderne, c’est une condition informatique. Lyotard avait d’ailleurs une compréhension très avancée – comme son expo au Centre Pompidou Les Immatériaux l’a montré plus tard, en 1985 – de ce que pourrait être l’internet, la connectivité générale. Penser aujourd’hui l’intelligence artificielle, les robots, la société de l’information, les langues informatiques, c’est une nécessité impérative, et on est encore assez mal armés.
Mais au-delà, c’est une nécessité métaphysique et, d’une certaine manière, théologique. Je veux dire par là que c’est n’est pas qu’affaire de technique. Ce n’est pas que le désenchantement du monde qui se poursuit sous la forme du fonctionnement généralisé. On voit le lien : l’idée du Verbe incarné, Bartleby, Deleuze, et puis derrière : Lacan, le Symbolique, le structuralisme, les théories de la communication, l’informatique, Lyotard. C’est une chaîne étrange, mais je crois qu’elle fonctionne. Je crois que les intellectuels des années 1970 ont vraiment pensé que la condition postmoderne était une condition messianique. Avant eux, il me semble que c’est aussi ce que Walter Benjamin avait pressenti. On voit ça très bien chez Jacques Derrida, qui fait le pont entre toutes ces histoires, le messianique, le structural et le cybernétique, dans De la grammatologie.
Le paysage de la pensée aujourd’hui, comment le vois-tu ?
Il a connu des renouvellements spectaculaires avec l’arrivée de nouveaux joueurs comme Quentin Meillassoux ou Tristan Garcia, et la confirmation du génie de Catherine Malabou… La pensée française reste une référence dans le monde, grâce à des auteurs comme Alain Badiou, Jacques Rancière, Bruno Latour, et au travail de fond que réalisent Elie During, Patrice Maniglier, David Rabouin, Laurent Jeanpierre, mon éditeur Laurent de Sutter et d’autres. Le collectif Le Peuple qui Manque, le travail d’éditeur d’Alexandre Laumonier, c’est remarquable aussi.
En ce qui me concerne, c’est plutôt vers l’accélérationnisme britannique que va mon intérêt aujourd’hui, à cause de tout ce que je viens dire. Je crois qu’il se passe là quelque chose d’extraordinaire, et comme tout ce qui est extraordinaire, de vaguement inquiétant aussi. Une chose dont Gershom Scholem parlait très bien, après Walter Benjamin justement. La puissance d’un langage devenu divin que nous allons devoir maintenant écouter, après l’avoir invoqué. Peut-être m’aura-t-il fallu tout le détour de ce livre et de cette longue histoire pour en arriver à ce constat-là, qui paraîtra sans doute évident pour d’autres.Il m’aura fallu faire une longue route pour devenir, en somme, contemporain à moi-même. Mais je recommande le voyage à tout le monde !
Propos recueillis par Ingrid Luquet-Gad et Jean-Marie Durand

Source : http://www.scienceshumaines.com/pop-theologie_fr_34421.html
En 1904, le sociologue Max Weber publie L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme. Il y défend la thèse que le capitalisme s’est développé sous l’aile de l’éthique protestante, en particulier calviniste. Cette dernière aurait en effet favorisé l’esprit d’entreprise, l’autodiscipline et le désir d’accumulation de richesses comme but en soi. Selon la doctrine catholique, le salut était accordé à celui qui entreprenait des actions moralement bonnes durant sa vie. Mais, selon la Réforme, le salut résulte d’une décision divine arbitraire et a priori. Pour dissiper l’angoisse résultant de cette prédestination, les protestants se mirent à chercher un signe de leur élection divine. Ils le trouvèrent dans leur propre réussite ici-bas. Aussi firent-ils du travail et du gain lucratif une éthique de vie. Le capitalisme moderne y aurait trouvé sa dynamique. Que vaut cette thèse ? Il y a eu de nombreux débats à son sujet. En tout cas, on a pu facilement douter qu’elle s’applique encore à la société occidentale depuis le milieu du 20e siècle. Qu’y a-t-il en effet de commun entre l’austérité protestante et la société des loisirs, de la consommation et de la culture pop ? Pourtant, tout le propos de Mark Alizart est de prolonger la thèse de Weber en s’efforçant de montrer que la société postmoderne trouve ses racines dans les avatars de la Réforme, c’est-à-dire dans les « mouvements d’éveil » (great awakening) des communautés protestantes au 19e siècle. Cette nouvelle théologie serait en effet porteuse de nos désirs d’émancipation, de notre valorisation de l’exaltation, des appels très new age à croire en soi-même et des désirs de lâcher-prise si chers à la culture pop. Pour étayer sa thèse, l’auteur puise librement dans la théologie, la philosophie, la littérature et le cinéma toutes sortes de citations et d’exemples allant dans le sens de son argument. Par ce tourbillon d’idées, il cherche à montrer que nous serions tous, sans le savoir, des protestants. Une idée originale, stimulante et forcément discutable.

