Les identités baroques
***
Felipe Becerra Calderón - Chiens féraux [Anne Carrière 2011 - Trad. Sandy Martin & Brigitte Jensen]
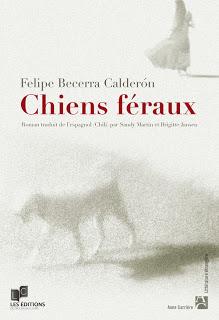
Une voix plurielle et mystérieuse, semblable à celle d’un incertain chœur de tragédie antique, nous conte les affres de la jeune Rocio, une ex étudiante en médecine de Valparaiso, à l’esprit quelque peu tourneboulé. Suite à un épisode tragico-grotesque dans les sous-sols de la faculté impliquant les têtes coupées de corps livrés en pâtures à l’étude et des bains collectifs dans de grandes piscines de formol, elle s’en va vivre avec son mari le carabinier Molina à Huara, un bled paumé dans le désert du nord chilien. Nous sommes au début des années 80 et la dictature bat son plein. Chien Féraux, pourtant, n’est pas l’habituel roman for export latino sur la dictature, et c’est heureux. Le Chili de Pinochet est d’abord un climat, et de fait la dictature en tant que telle n’y est jamais vraiment mentionnée, si ce n’est sous la forme d’un effet global sur le réel. Il s’agit d’observer comment certaines conditions politiques et « philosophiques », si l’on veut, filtrent les perceptions.
Il y a quelque chose de plombé dans l’ambiance de ce livre, ce qui ne l’empêche pas de travailler un certain lyrisme baroque dans sa langue étrange et belle, profondément chilienne (l’ayant lu en v.o., je ne sais ce qu’il en reste dans la version française, mais on me glisse à l’oreillette que la traduction est très bien). L’ennui règne à Huara, il ne saurait en être autrement. Le carabinier Molina n’a rien à faire, et pour le tromper cet ennui, il décrit au détail près son quotidien fait de vide et de contemplation abrutie du désert dans les colonnes du cahier où il doit rendre compte de ses tours de garde. Le temps dans ce désert semble ne pas exister, à moins qu’il n’existe que trop, ce qui revient sans doute au même. Au loin, à l’horizon, une grande tache de poussière mobile et immobile à la fois ressemble à une gigantesque araignée, à un scarabée ou à n’importe quelle bestiole du genre. Le carabinier est persuadé qu’elle avance lentement mais sûrement vers lui. À la maison, c’est au tour de Rocio, insomniaque, d’être persuadé que d’autres araignées - plus réelles (ou pas) – envahissent son lieu de vie. Dans les rues trainent les chiens errants et des pauvres crasseux - indiens probablement - fouillent dans les ordures pour y pêcher de quoi survivre.
Le premier roman du jeune et fort doué Felipe Becerra Calderón (Valdivia, 1985) travaille ainsi, métaphoriquement, l’identité nationale. Ceux qui selon le pouvoir central et la classe dominante en font parti (les « blancs ») et ceux qui en sont exclus (la population du village, indiens, « natifs » - Aymaras s’il faut en croire une des postfaces de l’édition chilienne du livre). Rocio et son mari représentent ainsi, malgré eux, cette classe dominante, l’appareil bureaucratique et militaire de la dictature. Pour tout dire, ils semblent surtout perdu, incapables de ne pas se demander ce qu’ils font là. Le carabinier Molina observe les choses avec une naïveté inquiète, tandis que sa femme se perd dans les labyrinthe d’une folie qui semble toujours aux aguets (représentée par la voix multiple de ce « chœur antique » qui prend régulièrement la parole). Folie qui occupe de plus en plus de place, jusqu’à envahir tout l’espace narratif. Le récit dérive ainsi vers un univers onirique tout en basculements dont le symbolisme reste biaisé. Le texte semble refuser de se fermer d’une manière trop décidée sur lui-même. Une incertitude baroque s'impose peu à peu (qui parle ? on est dans la tête de qui ? etc).
Deux scènes définissent bien les enjeux du roman. Dans l’une, Rocio, après avoir demandé à son mari de lui apprendre à conduire histoire de tromper l’ennui, manque de renverser un gamin du village. Celui-ci (ou un autre, dans un univers métaphorique ce genre de précisions n’ont pas cours) apparaît ensuite dans les délires que nous racontent les voix plurielles. La lecture politique se donne d’elle-même (les personnages, eux, ne font que la subir) : l’état totalitaire, sûr de sa domination, n’a que faire des minorités indésirables (l’enfant du village, indien donc). Mais cette indifférence va dans les deux sens, comme le montre l’autre scène : dans celle-ci, naïvement, le carabinier Molina décide pour changer les idées de sa femme d’organiser quelque chose dans le village le jour de la fête nationale. Or, c’est un bide retentissant (ce qu’il aurait dû prévoir s’il avait disposé d’une distance qui lui est niée). Hormis les militaires, aucun des autochtones ne danse les cuecas traditionnelles ni ne participe à la fête autrement qu’en observant tout ça de loin d’un air neutre voire absent. Les symboles nationaux ne font pas sens pour les habitants du village, qui ne se sentent ni concernés ni interpelés.
Becerra Calderón travaille donc l’identité, mais aussi – dans ce qui pourrait être la trace bien digérée de l’influence de Roberto Bolaño – une certaine idée du mal qui semble ramper derrière. La dictature n’y est présente qu’en creux (un creux plus profond, plus sombre, plus glissant que celui d’un roman comme le Nocturne du Chili de Bolaño) et de ce creux émergent des figures aussi fascinantes qu’inquiétantes, comme celle du Professeur Destin, sorte de charlatan de haute volée, animateur d’émissions de radio et auteur de livres de développement personnel qui pratique l’hypnose au service de la torture d’état. Celui-ci semble fasciner le carabinier Molina, quand bien même, lorsque ce dernier cherche de vrais réponses auprès de lui, il ne fera que les esquiver.
Chiens Féraux est un récit qui flotte en permanence entre plusieurs eaux et plusieurs couches narratives, toutes assez troubles, et se construit ainsi, comme une grande machine à ambiguïtés. Des ambiguïtés qui sont celles d’un pays dont l’identité – déjà complexe en soi, de par son histoire – le devient encore plus lorsqu’un système oppresseur décide d’en faire un outil de manipulation. C’est aussi un tour de force stylistique d’une grande fluidité malgré la densité d’images et de métaphores. Une belle façon de renouveler la grande tradition baroque des lettres hispanophones.
