Je sors de chacun des romans de John le Carré abasourdie par le talent de cet homme. Tout y est maîtrisé : le style, les personnages, l’intrigue, la construction du récit.
Celui-ci nous entraîne une fois de plus dans les obscurs souterrains des services secrets britanniques et américains.
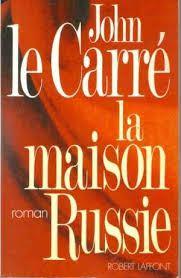
Tout le reste du roman est une tentative pour répondre à cette question. Transformé tant bien que mal en espion, Barley, cet insoumis, est renvoyé en Russie avec une mission : authentifier la sincérité de la source. Pour l’atteindre, il devra passer par Katia. Dont il tombera amoureux, ce qui rendra encore plus hasardeuse la confiance que ses patrons et leurs homologues américains ont placée en lui. Amoureux, mais pas à la manière cavalière d’un James Bond. D’un sentiment altruiste qui lui fera mettre la sécurité de Katia et de ses enfants au-dessus de tout.
Ce qui est fascinant dans ce roman, c’est l’habileté de le Carré à nous faire ressentir l’angoisse de ne plus savoir où se trouve la vérité. Tout n’est que mensonges, fausses identités, stratégies tordues. Si bien que la plupart des protagonistes en perdent leurs repères et font des erreurs de jugement. À l’exception de Ned, un des « patrons » de Barley, tous sont aveugles aux indices permettant de comprendre que la mission de Barley est en train de déraper. Lorsqu’ils ouvriront les yeux, il sera trop tard et quelqu’un devra payer.
La maison Russie est une passionnante histoire d’espionnage, sans coup de feu, sans hémoglobine, entièrement construite sur la psychologie des personnages et sur les rouages infernaux des services secrets. Du grand art.
John le Carré, La maison Russie, Robert Laffont, 1989, 382 pages
