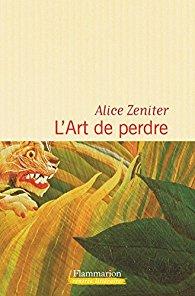
Quatrième de couverture :
L’Algérie dont est originaire sa famille n’a longtemps été pour Naïma qu’une toile de fond sans grand intérêt. Pourtant, dans une société française traversée par les questions identitaires, tout semble vouloir la renvoyer à ses origines. Mais quel lien pourrait-elle avoir avec une histoirefamiliale qui jamais ne lui a été racontée ?
Son grand-père Ali, un montagnard kabyle, est mort avant qu’elle ait pu lui demander pourquoi l’Histoire avait fait de lui un « harki ». Yema, sa grand-mère, pourrait peut-être répondre mais pas dans une langue que Naïma comprenne. Quant à Hamid, son père, arrivé en France à l’été 1962 dans les camps de transit hâtivement mis en place, il ne parle plus de l’Algérie de son enfance. Comment faire ressurgir un pays du silence ?
Dans une fresque romanesque puissante et audacieuse, Alice Zeniter raconte le destin, entre la France et l’Algérie, des générations successives d’une famille prisonnière d’un passé tenace. Mais ce livre est aussi un grand roman sur la liberté d’être soi, au-delà des héritages et des injonctions intimes ou sociales.
L’Art de perdre est un roman ambitieux, audacieux et généreux.
Ambitieux parce qu’il raconte sur trois générations l’histoire d’une famille algérienne d’abord sous domination française, ensuite en pleine tourmente de guerre civile et d’exil forcé, puis du point de vue des deuxième et troisième générations écartelées entre pays d’origine et pays de vie, enfin par un retour apaisé en Algérie. Ali, Hamid, Naïma : trois figures de cette famille, trois manières de se construire (et parfois de tout perdre) sur fond de cette guerre d’indépendance dans laquelle Ali, riche propriétaire terrien sur une crête de Kabylie, s’est retrouvé sans vraiment avoir choisi ni compris du côté français, de ceux que l’on a appelés du terme trop général « les harkis ». Arrivé en métropole, ballotté de camp en camp puis dans une barre de HLM normande et une usine qui accueillent les déracinés, les non-qualifiés, le patriarche a enfoui ses émotions, ses incompréhensions, sa honte dans le silence. Son fils aîné Hamid, né en Algérie, arrivé en France vers l’âge de dix ans, a lui aussi choisi le silence, il a refoulé dans l’oubli volontaire le pays d’origine et s’est émancipé par les études et le mariage avec une Française (quoique lui aussi est Français puisque les ex-colonisés qui ont « choisi » le camp de la France n’ont jamais été que des Français… même si pas grand-monde ne les a considérés ainsi). Naïma, la troisième fille de Hamid, ploie sous le poids des non-dits et prend de plein fouet la vague islamiste et les attentats qui frappent l’Algérie dans les années 90 et le sol européen depuis les années 2000. A l’occasion d’une mission professionnelle, elle « retourne » en Algérie, elle qui n’y avait jamais mis les pieds, et découvre le village sur la crête.
Audacieux parce qu’encore aujourd’hui, le sujet des harkis semble hyper-sensible des deux côtés de la Méditerranée. Alice Zeniter raconte cette histoire familiale avec vivacité, dans des chapitres courts où elle glisse sans lourdeur de multiples informations historiques et sociologiques (c’est autrement plus vivant et passionnant que le roman de Brigitte Giraud, Un loup pour ‘homme, paru lui aussi à la Rentrée 2017 chez le même éditeur). J’ai retrouvé l’ambiance lourde des tortures, des exécutions sommaires, de la stratégie de la terreur de Où j’ai laissé mon âme de Jérôme Ferrari et j’ai découvert bouche bée les conditions dans lesquelles les harkis ont été « accueillis » en France à l’été 1962 : parqués dans les camps qui avaient servi au regroupement des Juifs en 40-45 et aux prisonniers allemands à la Libération, pris pour des débiles et employés dans des postes peu ou pas qualifiés, parqués à nouveau dans des cités HLM construites exprès pour eux (et on s’offusquera encore de la violence qui gangrène ces banlieues ?). L’auteur sait montrer que rien n’est simple, rien n’est manichéen finalement dans cette histoire douloureuse. J’ai aimé cette vision de l’Histoire par le petit bout de la lorgnette, par le biais de vrais gens (ou du moins de personnages très réalistes).
Généreux parce qu’Alice Zeniter rend ses personnages tellement attachants dans leurs silences, leurs doutes, leurs hontes, leurs désirs de liberté, d’indépendance (par rapport à l’Histoire, à la famille, aux racines). Elle raconte avec une grande finesse psychologique le désastre de la guerre civile, le désarroi de l’exil, la survie et le désir de vie, d’intégration, l’écartèlement entre le pays d’où l’on vient et celui où l’on vit, pour déboucher sur une fin dynamique : la romancière ne boucle pas une boucle, mais elle laisse à son troisième personnage principal la liberté d’avancer dans la vie en connaissant mieux, en intégrant son histoire, l’Histoire et sa famille. Inutile de préciser que l’art de la construction n’est pas la moindre des qualités d’Alice Zeniter, de même que son style vif, précis, élégant. J’ai été touchée aussi par la justesse des voix masculines et féminines dans ce roman, à travers les rôles traditionnels dévolus à la femme dans la génération d’Ali et de sa femme Yema ou les revendications féministes des femmes dans l’Algérie actuelle.
Oui, le roman d’Alice Zeniter est ambitieux, audacieux et généreux. Un beau coup de coeur en ce début d’année.
« Le camp Joffre – appelé aussi camp de Rivesaltes – où, après les longs jours d’un voyage sans sommeil, arrivent Ali, Yema et leurs trois enfants est un enclos plein de fantômes : ceux des républicains espagnols qui ont fui Franco pour se retrouver parqués ici, ceux des Juifs et des Tziganes que Vichy a raflés dans la zone libre, ceux de quelques prisonniers de guerre d’origine diverse que la dysenterie ou le typhus ont fauchés loin de la ligne de front. C’est, depuis sa création trente ans plus tôt, un lieu où l’on enferme ceux dont on ne sait que faire en attendant, officiellement, de trouver une solution, en espérant, officieusement, pouvoir les oublier jusqu’à ce qu’ils disparaissent d’eux-mêmes. C’est un lieu pour les hommes qui n’ont pas d’Histoire car aucune des nations qui pourraient leur en offrir une ne veut les y intégrer. «
« – Dis-moi quelque chose, toi. Moi je m’ennuie…
Ali hésite et puis, il lâche, tout à trac :
— Je suis devenu jayah.
C’est la première fois qu’il avoue ce sentiment. Il sait que, même si Mohand n’est pas un ami, il peut le comprendre. C’est comme cela qu’on désigne l’animal qui s’est éloigné du troupeau et l’émigré qui a coupé les liens avec la communauté. Jayah, c’est la brebis galeuse. Celui qui n’a plus rien à apporter au groupe, qu’il s’agisse de la famille, du clan ou du village. Jayah, c’est un statut honteux, une déchéance, une catastrophe. C’est ce que ressent Ali. La France est un monde-piège dans lequel il s’est perdu. »
« Mais peut-être qu’Ali n’est pas fou, se dit Naïma…Peut-être que la douleur lui donne le droit de crier, ce droit qu’il n’a jamais pris auparavant. Peut-être que, parce qu’il a mal à son corps pourrissant, il trouve enfin la liberté de hurler qu’il ne supporte rien, ni ce qui lui est arrivé ni cet endroit où il est arrivé. Peut-être qu’Ali n’a jamais été aussi lucide que lorsqu’il insulte ceux qui ouvrent sa porte. Peut-être que ces cris ont été étouffés quarante ans parce qu’il se sentait obligé de justifier le voyage, l’installation en France, obligé de masquer sa honte, obligé d’être fort et fier face à sa famille, obligé d’être le patriarche de ceux qui pourtant comprenaient mieux que lui le français. Maintenant qu’il n’a plus rien à perdre, il peut gueuler. »
Alice ZENITER, L’Art de perdre, Flammarion, 2017
Le titre du roman vient d’un poème d’Elizabeth Bishop que je vous proposerai dimanche prochain.
Catégorie Art pour le Petit Bac 2018 (même si cela n’a rien à voir ou si peu avec le monde artistique)

