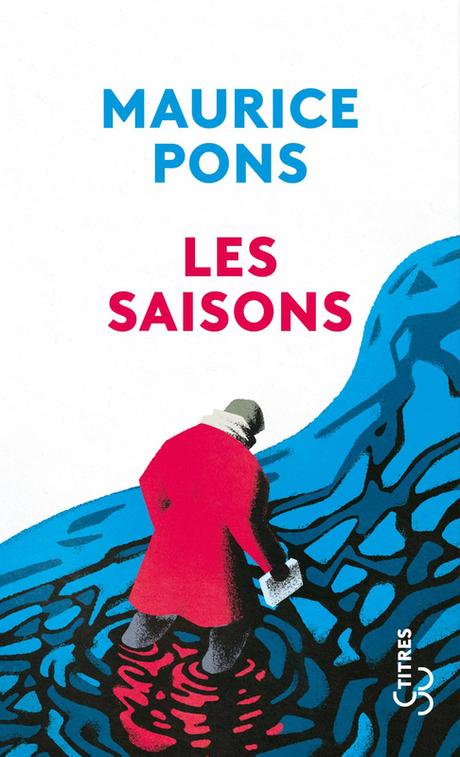
Dans son sac, Siméon transporte des papiers d’une blancheur de neige dont le filigrane représente une tête de bélier. Il veut y écrire un livre, car il se dit écrivain. Ce livre prendra son origine dans la mort de sa soeur, Enina (évidemment l’anagramme d’Annie, même si je ne sais pas qui est cette Annie). Une mort épouvantable dans un désert de sable brûlant où les os des jeunes filles tombent en poudre. Et c’est dans une vallée tout aussi épouvantable de misère et de puanteur qu’il vient se réfugier pour écrire un roman. Il en a déjà en tête les premiers mots, sortes de jurons proférés par les bourreaux de sa soeur : « Alleluia ! Crucifixus ! ». Mais le village où il arrive n’a jamais vu d’étranger. Louana, une petite fille, l’a vu la première : elle voit tout. À sa façon, elle va l’accueillir, tout en gardant sa liberté et son franc parler. L’organisation du village est assez minimaliste : une maison commune, un hôtel sans chambre, deux douaniers, des maisons réparties de bas en haut d’une pente boueuse et dangereuse. L’incompréhension est totale entre les villageois et l’arrivant qui découvrira qu’il n’y a ici que deux saisons : l’une faite de pluies permanentes, l’autre dite du « gel bleu ». Opposition complète avec le désert brûlant d’avant. Mais feu, pluies ou froid, c’est toujours l’enfer. Écrira-t-il, celui qui se dit écrivain ? Oui, quelques pages d’un journal. Mais ce roman, trouvera-t-il les bonnes conditions de l’écriture ? Et comment fera-t-il quand il devra occuper son rôle social et entretenir le pluviomètre ? Trouvera-t-il enfin un autre village au climat plus accueillant laissant derrière lui celle qui a pris soin de lui, cette enfant, Louana, le regardant partir depuis le seul monument du village, la Croix de Sépia, avec « un sourire hiératique ».
Lecture éprouvante mais ce texte (publié pour la première fois en 1965) dont le désespoir se teinte parfois d’humour emporte son lecteur. J’y ai pensé à ces auteurs « post-exotiques » de Volodine, tant l’obscurité y est présente et l’humanité y baigne dans ses horreurs. Il y a Louana, qu’on pourrait comparer à Zazie (le livre de Raymond Queneau est sorti quelques années plus tôt) : elle vit dans la puanteur qui n’est pas celle de la ville, du métro, elle sait tout de l’humanité, et n’en a « rien à foutre du latin ». Et il me semble aussi qu’Alain Damasio a pensé à ce livre de Maurice Pons quand il a écrit certains passages de La horde du Contrevent.
