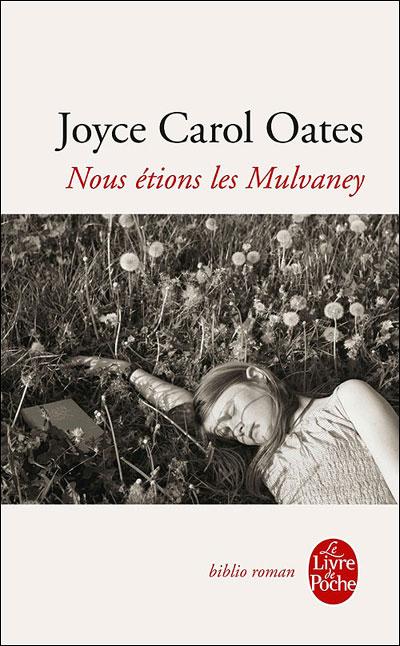
Quatrième de couverture :
À Mont-Ephraim, une petite ville des États-Unis située dans l’Etat de New York, vit une famille pas comme les autres : les Mulvaney. Au milieu des animaux et du désordre ambiant, ils cohabitent dans une ferme qui respire le bonheur, où les corvées elles-mêmes sont vécues de manière cocasse, offrant ainsi aux autres l’image d’une famille parfaite, comme chacun rêverait d’en avoir. Jusqu’à cette nuit de 1976 où le rêve vire au cauchemar… Une soirée de Saint-Valentin arrosée. Un cavalier douteux. Des souvenirs flous et contradictoires. Le regard des autres qui change. La honte et le rejet. Un drame personnel qui devient un drame familial. Joyce Carol Oates épingle l’hypocrisie d’une société où le paraître règne en maître ; où un sourire chaleureux cache souvent un secret malheureux ; où il faut se taire, au risque de briser l’éclat du rêve américain.
Dans ma série « A la ferme » voici aussi un pavé d’été et un bon gros roman de Joyce Carol Oates. Une histoire de famille inextricablement liée à un lieu, à une maison : High Point Farm. Ici il n’est pas vraiment question de travail à la ferme puisque Michael Mulvaney, le père, dirige une entreprise de couverture de toits et que la mère, Corinne, gagne un peu d’argent en vendant des objets de brocante ; mais il s’agit bien d’une ferme dont les dépendances abritent des chevaux, des animaux de basse-cour, de nombreux chiens et chats dont certains reçoivent un prénom et sont quasiment des membres de la famille, et les enfants Mulvaney doivent prendre soin des animaux en plus de leur travail scolaire et de leurs diverses activités sportives et sociales. Une vraie famille américaine, née du coup de foudre entre Michael et Corinne en 1955, une famille soudée, avec l’aîné Michael Junior, le sportif, Patrick, l’intellectuel, Marianne, la seule fille, lumineuse et généreuse, et Judd, le benjamin et narrateur.
Cette famille à la fois traditionnelle et originale (tous ses membres se donnent des surnoms pittoresques qui témoignent de leurs liens profonds), cette famille enviée va voir son unité voler en éclats le jour où, en 1976, Marianne subit une agression qui va changer à jamais le destin des Mulvaney. Le mot « viol » ne sera jamais prononcé et l’agresseur de Marianne ne sera jamais inquiété officiellement, même sa propre mère ne parvient pas à aider sa propre fille, qui restera longtemps persuadée que tout est de sa faute. Quant au père, sa propre culpabilité de n’avoir pas su protéger sa fille va le faire lentement dégringoler, socialement et physiquement. Corinne se range de son côté – toujours implicitement -, la fille est écartée de la famille et envoyée chez une lointaine cousine et les garçons sont livrés à eux-mêmes. Tout en faisant semblant de préserver les apparences, chacun va devoir tracer son chemin pour simplement vivre et se réaliser. Le silence est d’une violence insoutenable.
Avec pour toile de fond l’histoire de l’Amérique, de John Kennedy à Ronald Reagan en passant par la guerre du Vietnam et la prise d’otages à Téhéran sous Jimmy Carter, Joyce Carol Oates suit chacun des membres de cette famille avec attention, leurs portraits, leurs chemin de vie, leur psychologie, sont fouillés, elle aime ses personnages, même si chacun (sauf Judd) peut sembler au lecteur tantôt éminemment sympathique, tantôt parfaitement détestable dans sa fuite des responsabilités ou sa naïveté aveugle. C’est ce que signifie sans doute la scène annoncée par plusieurs effets de prolepse : que les bons et les méchants (ou catalogués comme tels) peuvent tous être couverts de la même boue noire et que le chemin de la résilience frôle sans cesse le précipice.
La lecture de ce roman à l’époque du #metoo et du #balance ton porc secoue, interpelle sur le traitement réservé aux victimes d’agressions sexuelles mais c’est aussi l’inoubliable portrait d’une famille, d’une maison au charme fou, de personnages dont je me souviendrai longtemps.
« Je ne sais pas ce que maman a dit à Sable sur papa. Sur notre famille. J’ai tendance à penser qu’elle lui en a dit très peu. Car quels mots peuvent résumer une vie entière, un bonheur brouillon et foisonnant se terminant par une souffrance aussi profonde et prolongée ? » (p. 666)
Joyce Carol OATES, Nous étions les Mulvaney, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Claude Seban, Le Livre de poche, 2011 (Stock, 1998)
#alassautdespaves
Challenge Pavé de l’été chez Brize
Le Mois américain : journée féminine
