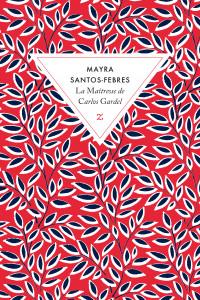
Présentation de l’éditeur :
Micaela n’a rien oublié de ces quelques jours avec lui. Elle se revoit jeune fille, élève infirmière silencieuse et appliquée, nourrissant patiemment son rêve d’entrer à l’École de médecine tropicale. Elle se revoit aux côtés de sa chère Mano Santa, sa grand-mère meilleure qu’une mère, la plus grande guérisseuse de l’île. Elle se revoit, passionnée de botanique, en héritière du secret du cœur-de-vent, ce remède aux vertus exceptionnelles. Elle se revoit dans ses bras à lui.
Lui, c’est Carlos Gardel, l’icône du tango au sommet de sa gloire, qui, le temps d’une tournée – ou d’une chanson – a donné à Micaela le goût de saisir la vie à bras-le-corps. De ces quelques jours grisants comme une fugue enchantée, Mayra Santos-Febres a fait le roman superbe, ensorcelant, d’un grand destin de femme. Où l’on passe des bas quartiers aux hôtels de luxe, où les plantes font vivre ou mourir, où le tango prend corps et voix, où le désir est partout.
Nous sommes en 1935, à Porto Rico, une île pauvre parmi les pauvres des Caraïbes, sous administration américaine. A cette époque, les naissances ne sont évidemment pas contrôlées, les femmes pauvres mettent au monde de nombreux enfants qui finissent le ventre gonflé de vers (comme leurs mères) et les médecins formés aux Etats-Unis voient cette population grouillante comme « un nid de mouches ». De retour de New York, Carlos Gardel, qui mourra bientôt en juin 1935 dans un accident d’avion à Medellin en Colombie, a entrepris une grande tournée en Amérique latine et passe par Porto Rico. C’est là que vivent Micaela Thorné et sa grand-mère Mano Santa, une jeune étudiante infirmière et une guérisseuse, la meilleure de l’île, celle qui connaît le secret du coeur-de-vent, une plante « miraculeuse », mais qui a aussi fait de nombreux sacrifices pour que sa petite-fille fasse des études et sorte de son milieu. C’est à Mano Santa que va faire appel l’entourage de Gardel, incapable de chanter à cause de la syphilis qui le ronge.
Et c’est ainsi que Micaela, qui a accompagné sa grand-mère pour soigner Gardel, va être en quelque sorte réquisitionnée par le chanteur pour l’accompagner dans sa tournée portoricaine. Vingt-sept jours d’évasion, de désir brûlant, pendant lesquels Gardel va raconter sa vie à Micaela et où, surtout, la jeune femme va se demander ce qu’est être une femme à Porto Rico en 1935 : doit-elle répondre à l’exigence de procréer de son milieu pauvre, noir ? Peut-elle s’en affranchir et a-t-elle le droit de faire des études, d’intégrer l’univers de l’Ecole de médecine tropicale et de l’Office d’hygiène maternelle et de salubrité publique ? Comment se situer entre le docteur Romeu, forte de son savoir mais attirée par le savoir des plantes médicinales, et Mano Santa, gardienne du secret du coeur-de-vent ? Toutes ces questions, Micaela se les pose encore au soir de sa vie, quand elle est revenue vivre seule dans la maison de sa grand-mère.
Les pages sensuelles de ce roman rempli de plantes, de soleil et de tango se tournent toutes seules. Je ne sais pas si Carlos Gardel, le « Zorzal Criollo » (la grive chanteuse créole), le « Morocho de l’Abasto » (le brun de l’Abasto, le quartier de Buenos Aires où les tangueros se produisaient), si Gardel donc a vraiment eu la syphilis, en tout cas, après avoir triomphé à Paris et à New York, il a vraiment fait une tournée latino-américaine en 1935, qui devait le ramener en Argentine, pays auquel il était si attaché et qu’il ne reverra jamais. Ce prétexte pour une rencontre entre lui et Micaela donne un roman où deux thématiques, celle du tango et celle du féminin, celle de la tradition et celle de la modernité, se croisent et s’entrecroisent, non sans douleur ni trahison. Mayra Santos-Febres, poète et romancière née à Porto Rico en 1966, est l’image de l’émancipation de ces femmes dont elle conte si bien l’histoire.
« Les musiciens ont achevé d’accorder leurs guitares sur scène. Alors Gardel a chanté.
Miel épais. Densité du muscle. Les ondes de sa voix m’ont enveloppée, comme un bain d’onguents, la caresse d’un baume. Ce n’était pas l’égratignure lointaine qui faisait grésiller les disques sur les gramophones de Campo Alegre. Ce n’était pas non plus la voix radiophonique qui nous obligeait à nous concentrer sur les messages et les mélodies. Cette nuit-là au Paramount, la voix de Gardel était vivante. La réverbération de sa voix était robuste, mais claire, armée de dents et de griffes qui ne cherchaient ni à déchirer ni à dévorer, mais invitaient à poser le pied, tout le corps sur l’air, pour voyager très loin au fond de nous. Elle donnait envie de se laisser emporter jusqu’en ce lieu sombre et protégé, d’où on est sorti il y a des années et dont on se souvient à peine. Et cette voix était aussi le regret qui efface tout chemin dans la mémoire. On doit retourner à cet endroit vrai, à soi. On doit en revenir, brisé, en lambeaux, mais être de retour. Tel était le sens de sa voix. » (p. 98)
« La tristesse est cette note qui s’étire comme un bandonéon. Elle fait grandir l’appel quand la distance se relâche, grandir la voix quand l’objet du désir est loin. C’est de là que viennent ce soupir et cette cassure dans la voix. C’est vers ce lieu-là qu’il faut tendre, faire battre le cœur, pour que la nostalgie atteigne ce qu’on a perdu et le fasse revive dans la poitrine. » (p. 168)
« C’était bien cela, le repos de moi-même s’était achevé. Ces jours de fête avec Gardel m’avaient permis cela. Cesser d’avoir continuellement à me protéger du monde, de ma grand-mère qui ne comprenait pas ce que signifiait être la petite-fille de la plus célèbre sorcière de l’île, de Mercedes et de ses tentatives de se faire de l’argent a détriment de ma grand-mère, de dona Martha et ses grands ambitions médicales, qui dépendaient du secret de ma grand-mère, de l’Ecole où je n’avais pas ma place, où j’étais une fille, certes avec du potentiel, mais pauvre, noire et donc incapable de vraiment s’intégrer dans le monde de la science, de la médecine, et la vérité, du progrès. Entre les draps des hôtels où il fouillait en moi, Gardel m’avait un moment donné des vacances de ce monde, fait oublier qui était Micaela Thorné et qui elle prétendait devenir. » (p. 256-257)
Mayra SANTOS-FEBRES, La Maîtresse de Carlos Gardel, traduit de l’espagnol (Porto Rico) par François-Michel Durazzo, Zulma, 2019
Un Zulma par mois (petit bémol, j’ai tiqué sur la traduction à au moins trois endroits du roman)
Petit Bac 2021 – Prénom
Un mois en Amérique latine avec Ingammnic et Goran (c’est rare de pouvoir lire de la littérature de Porto Rico)
