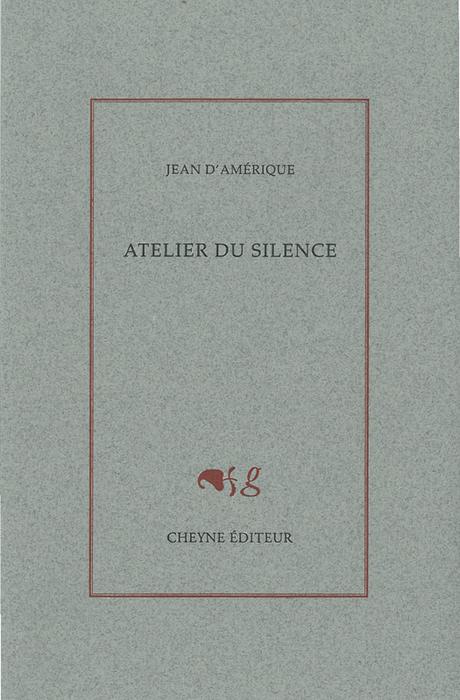
Le poète cherche sa langue. C’est d’abord ce « deal mal tourné avec la langue », tous ces empêchements à dire : la « chimie haute en douleur » des « villes en fumée » —Gaza, Alep—, l’Union européenne à qui il demande : « quand est-ce que vos récifs / écouteront le large » ? Le silence règnera-t-il sur ce monde ou est-ce que le poème saura faire que « l’atelier du silence (rende) les armes » ?
Trop peu nombreux les festivals musicaux qui « invitent les vagues en concert », et trop bruyantes les cloches qui « rêvent d’annonce / projet d’alarme sorti tout droit / d’une mesquine usine ». Le monde, tel qu’il est, n’est pas vêtement à porter, « mieux vaut être nu ». Comme à la naissance peut-être. Ou à la mort. Non pas la mort du poète mais celle de sa mère : « ma mère a coupé la canne à sucre / nulle récolte pour l’Histoire / foutue muette dans le conte scolaire ».
Le poème serait alors « musique enterrée », quête des mots : « mère embrasse la mort / que devient la langue maternelle ». L’absence de ponctuation, ici, fait planer un doute : la question pourrait être : - que devient la langue maternelle ? ou : - la langue maternelle devient-elle la mort ?
Jean d’Amérique prend place dans le concert des poètes qu’on a privés de parole, ici, ailleurs, et « avec l’autre (prenant) langue » demande « une minute de silence » pour la liberté d’expression.
Vous trouverez ici, dans ce blog, un article à propos du premier recueil de Jean d'Amérique publié par Cheyne.
