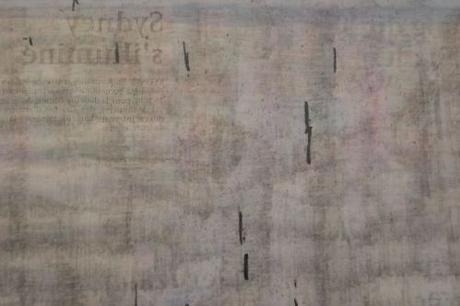Fil narratif tissant : souvenirs d’œuvres de Caroline Achaintre – Catherine Malabou, Le plaisir effacé. Clitoris et pensée, Rivages 2020 – gelée de coing – Ola Tokarczuk, Sur les ossements des morts, Libretto 2020 – Philippe Jaccottet, Truinas, le 21 avril 2001 – Œuvres de Joao Freitas, Marc Bluchy, Serena Fineschi, Elise Peroi, Roger Remacle…

Le vieil ordinateur a bien voulu, encore une fois, s’allumer, malgré son obsolescence avancée. Vrombissant, chauffant. Dans la fraîche clarté laiteuse et cristalline du printemps que forent les trajectoires précoces et erratiques de bourdons, il y parcourt les milliers de photos prises « face aux œuvres » au cours des trente dernières années. Son attention est flottante, autant balayant le paysage que butinant les images qui défilent, dans un sens puis dans l’autre, lentement ou en accéléré, à la manière dont on cherche des indices de « quelque chose » dans un ensemble de prises de vues qui pourraient avoir capté, de façon fortuite, des informations sur « ce qui s’est passé ». La plupart du temps, il est devenu incapable d’attribuer les œuvres photographiées à des noms d’artistes. Tout s’est transformé en motifs abstraits. Mais il reconnaît, parfois après un effort de mémoire conséquent, que toutes ces images renvoient à des expériences esthétiques qu’il a réellement vécues et lui tapissent l’intérieur. Humus. Dans le déroulé automatique – un peu machinal, lié au moment de la journée où l’organisme peine à se réveiller pour de bon, à rassembler ses esprits et, avec l’âge, chaque jour il lui devient difficile de revenir entier à l’état de veille, chaque fois, un petit bout est abandonnée à la nuit, à la petite mort -, un certain motif hirsute, sauvage, retient peu à peu son attention. Des créations qu’il a croisées plusieurs fois, à plusieurs années d’intervalles, en des géographies différentes, Montpellier, Paris, Bruxelles – le logiciel archive les photos avec dates et localisations et lui rappelle ainsi ces multiples occurrences – mais évoquant tout autant des formes croisées en-dehors du monde de l’art, dans les champs avec ses pailles, ses foins et ses épouvantails, dans les forêts habitées de silhouettes suggestives, dans les fièvres amoureuses, charnelles et spirituelles.
Des ruissellements de laine, à même les murs de la galerie, presque incongrus, presque insurrections contre l’espace rituel mondain de l’art contemporain, un affleurement de peaux et pilosités sauvages emmêlées, comme un clapotement d’eau d’écume et algues dans certains trous de roche, lors des marées montantes. Cela ressemble aussi à des trophées, des fourrures non identifiées, dont il est impossible d’identifier l’appartenance à un corps, à une espèce, à un vivant, et pourtant là, manifestant la force de silhouettes animales. De ces ombres que l’on voit courir au loin entre les arbres, au clair de lune, qui font frémir, « ais-je bien vu ? ». Des dépouilles d’abominables et sympathiques créatures des cavernes, d’ermites des bois profonds. Défroques étalées au mur, comme dans cuir et fourrures dans un atelier de tanneur, toujours animées des êtres qui s’en couvraient pour, semblables à nous, mais dans des cosmologies parallèles, continuer à danser autour de grands feux inextinguibles, au fond de clairières inatteignables, leurs ombres continuant à tourner furtivement dans nos imaginaires. De vastes encoignures de mousses et lichens, des flaques d’émulsions végétales et minérales. Des traits, des découpes, des trous laissent deviner, tapies dans les touffes, l’existence d’un visage, une identité qui observe d’entre les fils et les touffes. De la même manière que les arbres, les branches, les roches, les talus s’animent, certaines heures, de traits anthropomorphes. Cela évoque les tapis épais de ses lointaines maisons de famille où il jouait, se roulait, trouvant enfouis parmi les motifs géométriques des portes dérobées vers des mondes où s’échapper, se soustraire au réel, disparaître du contrôle des adultes, sol mousseux où il enfouissait le visage. Cela convoque ensuite, par rebonds, les souvenirs des manières dont se lover, s’enrouler, se disperser entre les bras de son amante, contre sa nudité, se frotter de toutes parts à ses formes fermes et liquides, là et l’emportant ailleurs – le décentrant -, se dérobant et le dérobant à son réel, non pas pour la stricte excitation corporelle, frontière soudaine érigée aux limites extrêmes de son corps avec la possibilité de migrer en d’autres entités, mais parce que le principe vivant de cette femme – son métabolisme, le fait qu’elle était ce brassage de tout ce qui entretenait son souffle de vie, ses interdépendances hétérogènes très riches – engendrait sans discontinuer un imaginaire de métamorphoses dynamiques entre animaux, humains, plantes, cailloux, terre, objets, traces accumulées de la vie sur terre, via ce qu’en saisissent l’oralité sans début ni fin, les encyclopédies et leurs stratégies narratives systématiques, les livres de contes au fil des siècles. Un imaginaire qu’elle racontait, dessinait, écrivait, exportait en lui. Son corps laineux aussi, lianes de cheveux sans racines ni pointes, ondes souples du milieu, filant, vif argent et serpents, sur les yeux, la bouche, le nez, les oreilles, recouvrant l’abîme brillant où il souhaitait choir, vers l’inconnu précédé des broussailles entretenues des aisselles et du bas-ventre, rases et drues, florales animales. Les vastes sculptures tissées, à la fois très élaborée et très sommaires, évidentes et fuyantes, fortes et inconsistantes, fabriquées autant que trouvées, lui parlent comme autant de doudous dont s’envelopper pour sentir palpiter tout ce qui échappe, rassembler le poids de l’épars, la force de l’enfoui. Ce qui file. A tel point que dans ces anatomies laineuses – quand il s’en approche, il voit plus qu’une profondeur turbulente de crinière – il renoue avec le point de surprise originaire – en plus diffus, « laineux » précisément – quand, au plus près de «l’origine du monde » que lui révélait sa première amoureuse à la manière d’un livre inépuisable, conditionné par des siècles de discours masculins sur le manque et l’absence caractérisant le sexe féminin, il était, en quelque sorte surpris par la consistance ramifiée, complexe, déroutante, pleine de personnalité charnelle, pas du tout un trou standard ! Un entrejambe paysage plutôt que troué, comme l’écrivit lamentablement un fameux philosophe existentiel, un paysage infini où, si il y a manque et absence, c’est de ne pas correspondre aux description et assignations patriarcales, culture et tradition qui empêchèrent la pensée du plaisir, et les cheminements y conduisant, de seulement prendre en compte la jouissance féminine et ce qu’elle déclenche comme pensée de soi et d’autres, se trouvant alors face à cette étendue s’imaginant que devait s’y produire un désir en miroir du sien et sentant, immédiatement, que quelque chose clochait, sans pouvoir discerner de quoi il retournait (sans « être équipé pour » dirait-on de façon pédante, mais intéressante). De manière non voulue, inconsciente, se trouvant l’héritier d’un savoir sur le sexe et le plaisir ayant occulté les liaisons entre organes sexuels féminins, capacités cognitives et production du symbolique, savoir incorporé à son insu, incluant les mécanismes et stéréotypes qui servent à nier chez la femme la possibilité d’une identité spécifique du plaisir, déterminé par ses expériences et ses organes. Jean-Paul Sartre, évoqué par Catherine Malabou dans son ouvrage « Le plaisir effacé. Clitoris et pensée » : « L’obscénité du sexe féminin est celle de toute chose béante : c’est un appel d’être, comme d’ailleurs tous les trous, affirme Sartre ; en soi la femme appelle une chair étrangère qui doive la transformer en plénitude d’être par pénétration et dilution. Et inversement la femme sent sa condition comme un appel, précisément parce qu’elle est « trouée ». » Et puis Lacan, noyant le poisson dans son phallus, et donnant ses consignes à Dolto chargée de s’exprimer, lors d’un congrès psy, sur la sexualité féminine : « Pas de deuxième sexe, pas de parole spécifiquement féminine, rien à dire du clitoris et du vagin, suprématie du phallus : tel est le carcan dans lequel, d’emblée, Dolto est prises. » (p.58)) Discours masculin dont les cellules se propagent spontanément dans tous les organismes mâles, programmés dès lors à reproduire ces affabulations dans leur métabolisme et perpétuer les privilèges d’une position avantageuse.
Les vastes masques pubiens, à la fois informes et individualisés (ils portent tous un prénom), tantôt bienveillants, tantôt inquiétants, moquent en un carnaval goguenard tous les préjugés et théories brutales conduisant à croire et faire croire que : « L’obscénité du sexe féminin est celle de toute chose béante ». Ces choses bien fournies, denses, consistantes, avec leur part indéfinissable et incurablement énigmatique, se réapproprient l’obscène et la béance.
Cela mais aussi, au-delà, ces silhouettes laineuses, résurgentes, sorcières ruisselantes, parures de deuil dont se couvrir pour rejoindre ses morts, que peigne le chagrin définitif avec certaine grâce, voire un réconfort paradoxal, du genre que l’on peut éprouver, lors de certaines funérailles du fait des mouvements et déplacements, autour de la tombe, de ce qui frémit à la surface du groupe (à peine, juste là, groggy) rassemblé pour l’ultime adieu, pareil à une brise ridant une eau d’étang, recueillant ce qui ne s’éteindra pas du défunt, le dernier souffle continuant à inspirer et à vivre dans ceux et celles qui l’aimaient. Ainsi ce qu’il relut, le soir où il apprit la mort de Philippe Jaccottet, une description de l’enterrement du poète André du Bouchet à Truinas, dans une « absence totale de cérémonial », ce qui, écrit-il, fait « même apparaître du désordre, du désarroi, un sorte de gaucherie devant la mort. » Quelque chose de « sauvage » en définissant ainsi le sauvage : «ce qui est tout au fond, le sans apprêt, l’assise retrouvée, le sol sur lequel on ne vacille pas ». Il se souvint que, ce soir-là, le peu de temps entre les retrouvailles avec les créatures de Caroline Achaintre et la relecture de ce passage de Jaccottet suscita et cristallisa un jeu de correspondances très denses, cruciales.C’est bien ce sauvage là qu’il sentait tapi dans les esprits laineux l’invitant à se laisser désarmer, s’abandonner aux plaisirs cachés, à rebrousse-poil, du désordre, du désarroi, de la gaucherie. Cette gaucherie propre aux rêvasseries enfantines sur tapis. Il se souvient qu’aux funérailles de son père, elles-aussi sans cérémonial dans le cimetière villageois, sans pierre tombale spécifiquement assignée, dans l’effort pour ne pas désespérer et rester digne de celui qui croyait avant tout au vivant, grâce aux échanges informels avec les proches et à l’intensité des souvenirs heureux qui remontait dans les larmes, il avait aussi exactement ressenti ceci, comme un dernier don du défunt : « Tout était avivé, ce matin-là : la sensation de la réalité du monde, de la merveilleuse réalité du monde dans un moment de rencontre des contraires ; et le sentiment de la chaleur humaine, d’une, oui, je le répète , d’une « noblesse d’âme » qui rayonnait dedans et dehors, sous le ciel de neige comme sous le toit de la maison. » Ce sentiment d’un réel éclairé et avivé, préparé par un « ballet » silencieux et informel autour du cercueil, reliant la couleur du ciel, un bout de nature, les corps en présence, leur côté « interdit », ces mouvements spécifiques des humains au cimetière, les pas alentis et précautionneux, le besoin de sentir ce qui relie toutes ces présences. « Le froid, la boue, les rochers éboulés, le verger en fleurs ; mais aussi ces deux chevaux couleur de bois, immobiles ; et les gens qui marchaient là, et ce sentiment naïf qu’ils étaient tous des amis, ou auraient dû l’être, à cause d’une aimantation commune qui les orientait vers la fosse, et vers la maison. Et cet autre sentiment, en moi du moins, encore plus étrange, qu’il n’y avait pas de vide, pas d’absence, que le cercueil seul était vide, en quelque sorte. Je vais même risquer ceci qu’il n’y avait pas exactement de tristesse, en moi du moins ; une émotion à la fois très calme et très intense, mais pas de déchirement, pas de révolte. (Je suis bien obligé de dire, comme j’ai toujours essayé de le faire, ce que moi j’ai ressenti : rien d’autre.) » (p.1297)
Les images défilent toujours sur l’ordinateur, aléatoirement. L’appétit s’est déclaré – signe que tout son organisme est enfin pleinement revenu à l’état de veille -, il s’est tranché une épaisse tartine et a déniché au fond d’un frigo, un ultime pot de gelée, mordorée, souvenir d’un arbre totem de son ancien jardin, quitté depuis. Sans doute le nouveau propriétaire l’a-t-il abattu pour ranger plus de voitures. Pincement au cœur. C’est un gros bocal rempli d’ambre souple. Il s’étonne de la découvrir aussi bien conservée, intacte, jeune, évoquant une part échappée de lui-même et transformée en une substance immortelle, immatérielle. Sa couleur, sa luminosité mélancolique, ses parfums discrets et subtils conservent le temps long des échanges avec l’arbre, au long des cycles saisonniers, la contemplation des bourgeons, feuilles, fleurs, esquisses de fruits, coings lourds, peaux jaunes et duveteuses, les tailles, le ramassage des feuilles mortes ; la première apparition d’un cognassier, dans son enfance, superbe, immense, cachant le mystère des fruits parfaits et incomestibles au fond d’un verger abandonné, sauvage ; l’explication venue bien plus tard en lisant la description de l’arbre fleuri dans la posée de Jaccottet ; le film de Victor Erice, El Sol Del Membrillo, l’achat et la plantation de « son » cognassier , sa croissance ; la préparation annuelle de la gelée, fruits découpés, marmite, cuisson, macération, les mains pressant le linge d’où suinte le jus, la pulpe récoltée pour la pâte de fruits, la cuillère en bois creusant un vortex dans le liquide où fond le sucre, les fumigations lors de l’ébullition agitant d’innombrables besoins inassouvis de quiétudes odorantes, la louche pour remplir les bocaux ébouillantés, la joie quand la gelée tombée sur le plan de travail « prend » instantanément… La liste de ce qu’évoquent l’arôme et la couleur de la gelée pourrait être interminable, à la manière des descriptions de territoire selon l’approche de Bruno Latour. Tous ces gestes répétés au fil des ans, chaque automne, toutes les images et sensations accompagnant ce temps des confitures de coings, pris dans l’ambre redécouverte. Plus exactement, quelque chose hors du temps, le « penser à rien » que rendaient possible la compagnie de l’arbre (et ses visiteurs réguliers, les oiseaux, les insectes, les parasites), la transformation des fruits immangeables en nectar à tartiner grâce aux gestes jamais assurés, endossés maladroitement, imitant manières de faire observées quand sa mère s’activait aux fourneaux, sa grand-mère ou sa tante…L’ambre matérialise dans le bocal tous ces « hors du temps », moments d’échappatoires, apnée de l’imaginaire, immersion en un vide régénérateur immanent, substantifique moelle de sa vie intérieure. « Pour les gens de mon âge, les lieux qu’ils ont aimé, auxquels ils ont appartenu, n’existent plus. Les endroits préférés de leur enfance et de leur jeunesse, les villages où ils passaient leurs vacances, les parcs aux bancs inconfortables où fleurissaient leurs premières amours, les villes d’antan, les cafés, les maisons… Tout cela n’existe plus. (…) Je n’ai plus d’endroit où retourner. » (O.Tokarcyuk, « Sur les ossements des morts ») D’où le replis sur sa terrasse-radeau surfant sur la canopée de ses vies car, enfin, ce n’est jamais « une » vie, c’est d’emblée un flux de vies multiples dont soi-même on se trouve être un brin.
Tandis qu’il mord dans le pain couvert de gelée et trempé dans le café, il revient à ses pensées matinales et se dit qu’une des sensations décrites par Jaccottet dans cette scène d’enterrement, n’a cessé de l’accompagner, de vibrer au coin de toutes ses sensations, depuis au moins la réelle découverte de la mort. Moment difficile à dater. Il s’agit du « sentiment d’un réel éclairé et avivé, préparé par un « ballet » silencieux et informel » que le poète situe entre les personnes rassemblées près de la tombe, mais qu’il peut transposer entre lui et les choses environnantes, proches, son présent et les images du passé, sa chair et celle des absentes. Une légère palpitation constante correspondant aux flux du sablier, dans un sens, dans un autre, ses pensées obsessionnelles, les idées et traces sans cesse remuées, auscultées, questionnées, toujours plus vivaces. Avec toujours le sentiment de la perte, d’être en train de creuser la séparation entre lui et ce qu’il aime, d’un deuil s’exprimant dans les gestes les plus ténus, ordinaires. A quoi ça tient ? A quoi je tiens encore ? Cela le conduit à affectionner un genre d’oeuvres qui lui parlent de ça, qui lui montrent la réalité de ses tissus sensibles, intérieurs, où s’échangent et s’agrègent tout ce que charrie le vivant cellulaire qu’il est capable de capter et ce qui, de cet incorporé en lui, est transformé en chaire symbolique, matière première brute des idées, pensées, créations, rêves, croquis, poèmes à venir, dès lors en gestation indéfinie. Des tissus où toutes les traces exposent leur effritement, écaillement, mis en mémoire, en attendant d’être récupérées, fortuitement, et de resurgir dans une conversation, l’interprétation d’un songe ou d’une peinture, l’écriture d’une lettre, une réflexion distraite… Même quand la surface, macérée dans le vide, semble redevenue presque vierge, transparente. Tels les papiers récoltés et transformés de Joao Freitas, affiches, feuilles de journaux, enveloppes, emballages, linges altérés par la pluie, le soleil, les poussières. Ils ont leur histoire, leur consistance propre. Ils ont appartenus à d’autres personnes, gardent la trace des usages dont ils furent l’objet, de ce qui leur furent confié puis déçu et retiré, ont glissé dans les dimensions de l’inutile, voies de garages où s’amorcent les processus de décomposition. Puis, ils ont pris, comme des buvards l’influence des éléments, de la météo, du temps qui passe, des humeurs cosmologiques. Ils ont changé de teinte dans l’oubli, perdus leurs pigments, gagné des auréoles (discrètes, elles-aussi décolorées). Ils sont imprégnés d’une esthétique d’abandon et de « messages d’au-delà » sans origine ni destination. Revenus du néant, signes épars flottant après un naufrage inexplicable. Là. L’artiste les reprend, met en évidence les trames et dessins estompés qui s’y sont révélés (la part sensible de tout papier qui capte et réagit aux humeurs atmosphériques), gratte, déchire, découpe, ajoute l’un ou l’autre trait d’encre ou de crayon. Il s’y efface aussi, en quelque sorte, ses interventions presque imperceptibles, jeu avec l’invisible. Et ainsi, les « dégâts du temps » ont un jour commencé à se marquer à la surface de ses souvenirs. Il a d’abord paniqué. A présent, yeux mi-clos, il aspire à ce qu’intérieurement, la moindre archive de ce qu’il a traversé et vécu soit altérée de la sorte. Non pas détruite, mais devenue indéchiffrable. Il les ramassera en pensée à la manière de papiers emportés par le vent et trempés, maculés, séchés. Ce qui était consigné – mots, images, sons – n’y sera plus directement détectable. Mais toujours « ressentis » comme ces objets dans les rêves qui ne ressemblent à rien de connu et dont on sait pourtant de quoi ils parlent et qui se cache derrière l’indescriptible ainsi que le message qu’ils s’évertuent à nous faire passer. Mutiques et éloquents. Des feuillets couverts d’une granularité aux nuances infinies, des plus radieuses aux plus sombres et étouffantes, des plus solitaires aux plus envahies par toutes sortes d’autres existences. Il les examinerait comme on questionne les résidus oniriques. Sa vie n’aurait-elle été qu’un songe, n’en resterait-il qu’une accumulation d’impressions ne permettant pas de départager le réel de l’irréel ? Il jouerait avec ces tissus flottants comme cette artiste maniant avec art le métier à tisser, tramant les failles, les accidents, les oublis, les résurgences, composant le sous-bois infini de la pensée. Il se dit qu’alors, il trouverait une paix substantielle, stable et durable.
Pour se représenter le nouveau stade de sa situation biochimique et les échanges qui seraient désormais les siens avec tout ce qui l’entoure – ainsi qu’avec l’épaisseur insaisissable de son humus mémoriel -, il s’attarde aux photos retrouvées de feuilles blanches où Marc Buchy à « impressionné » – sculpté -, ses apprentissages d’une langue indigène en voie de disparition. Ne sera-t-il pas toujours occupé à cherche sa langue pour exprimer ce qu’il est, pour exister, mais de plus en plus proche de l’extinction, le seul à se comprendre (à écrire la langue de son intimité)? Et encore ces autres pages-miroir où une jeune artiste, Serena Fineschi, a gravé des morsures. Mordre la page blanche, aura-t-il fait autre chose, pour marquer ces lisières vives quoique incertaines où « il peut arriver que s’entretissent le visible et l’invisible, les choses de la nature, les bêtes, les êtres humains, vivants et morts, et leurs paroles, anciennes ou nouvelles, ainsi que le chagrin et une espèce de joie. Alors, ayant frôlé du plus intime de soi, si fragile qu’on puisse être, si débile qu’on puisse devenir, quelque chose qui ressemble tant au plus intime du mystère de l’être, comment l’oublier, comment le taire ? » (Ph. Jaccottet) Mordre la page blanche – comme quelques fois on se griffe ou se mord, sous l’effet d’une émotion trop forte, marquant l’épiderme de dessins éphémères d’où le sang s’est retiré – -aura-t-il fait autre chose ?
Pierre Hemptinne