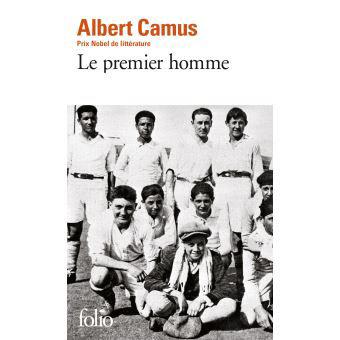
Le manuscrit de ce livre a été trouvé dans la sacoche d’Albert Camus, le 4 janvier 1960, jour de sa mort. C’est donc un texte qu’il travaillait et qui n’était pas encore prêt pour l’édition. Si ce texte a été publié, avec les quelques notes que l’auteur avait jointes aux feuillets déjà écrits, c’est parce qu’il donne des éléments de compréhension de la vie, de l’engagement, de l’écriture d’Albert Camus.
Une enfance pauvre, un père tué à la guerre 1014-1918, une Algérie dont il montre les réalités le plus justement possible, les jeux de l’enfance, les camarades de jeux et d’école, l’instituteur qui est le père dont il avait besoin à ce moment-là et qui va l’aider à accéder au lycée (et au concours pour obtenir la bourse d’étude), et surtout peut-être sa mère à qui il dédicace cet écrit de ces mots : « À toi qui ne pourras jamais lire ce livre ».
La fidélité à cette enfance, dure à vivre et pourtant riche d’amitiés, est sans doute ce qui touche d’abord. Aucune plainte, l’auteur essaie la lucidité, celle dont René Char, dont il fut l’ami, écrivait qu’elle est « la blessure la plus rapprochée du soleil ». La honte parfois d’être pauvre, par exemple de devoir écrire sur la fiche de renseignement scolaire à la question « profession des parents » ce mot, « domestique », qu’il n’avait jamais utilisé pour parler de sa mère ou de sa grand-mère. Et le regard objectif sur la colonisation et les inégalités sociales.
L’intérêt aussi de ce livre, c’est qu’il est encore un brouillon et que son auteur a indiqué ici et là le travail en cours. L’ordinateur ne nous laissera pas ces indications pour les textes d’aujourd’hui. Ce n’est pas seulement un texte nourri d’autobiographie, c’est déjà un roman qui s’appuie sur les images et les souvenirs et dont l’auteur disait : « je vais parler de ceux que j’aimais ».
