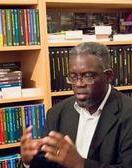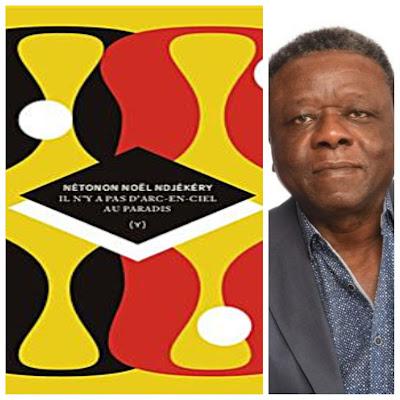
Il y a peut être tout dans ce titre. De la poésie. D’abord. Avant tout. La poésie. Il y a aussi par opposition une idée de l’enfer, de la rédemption, bref une joyeuse contradiction. Du moins dans l’entendement classique que j'ai du paradis qui serait la fin des guerres incessantes que nous nous livrons à nous-même et aux autres. Alors l’idée de l’absence d’arc-en-ciel est troublante… Mon introduction est peu longue...
J’ai terminé ce livre qui tient son rythme, sa poésie sans jamais s’épuiser, un peu comme un bon morceau de rumba zaïroise. Une fiction originale qui plonge le lecteur dans une histoire qui démarre avec deux captifs aux profils très différents. Le premier est un adolescent arraché à sa famille du jour au lendemain dans un de ces états de Baobabia qui jouxte la Grande Eau, entendez par là, le lac Tchad. Le moment que commence à raconter Nétonon Noël Ndjekery sur ces régions qui renvoient aux structures précoloniales que furent le Kanem, le Ouaddaï, le Barguimi, c’est celui de trafic d’hommes, noirs en l'occurrence, vers l’Orient. La traite arabo-musulmane bat son plein. Illustration :
Le Barguimi, le Bornou, le Kanem, et le Ouaddaï tiraient des profits colossaux de ce trafic d’humains. Mais la demande était si croissante que les quotas de livraison périodiques, qu’ils s’étaient engagés par contrat ou bakht à honorer auprès de leurs partenaires levantins, s’avéraient difficile, s'avéraient difficiles à satisfaire.p.15, éd. Hélice Hellas
Etat des lieux d’un monde brutal
Netonon Noel Ndjekery entreprend dans un premier temps de nous conter le monde chaotique autour de la Grande Eau (lac Tchad) à une période où la colonisation occidentale se met en branle en même temps que des états riverains tombent sous la coupe de puissants esclavagistes du Sahara. L’écrivain va donc s’employer à mettre en scène cette dynamique de la terreur. Il commence par Zeïtouni, un jeune captif, qui va être amené à traverser une partie du Sahara avec une entrave qu’il partage avec un autre adolescent qui ne parle pas sa langue. Pour restreindre toute connivence et projet de libération de ces jeunes avant d'arriver à un marché d'esclaves au Caire ou à Khartoum. Quand un corps s'effondre au cours de cette marche funeste et rythmée, les oreilles de ce dernier sont tranchées pour justifier la perte par les caravaniers. Ce sont des pages aussi difficiles que celles que vous aurez lu avec le personnage Nsaku Ne Vunda dans le fabuleux roman de l'écrivain congolais Wilfried N’Sondé, Un Océan, deux mers, trois continents (Actes Sud), dans Le messie du Darfour du Soudanais Abdelaziz Baraka Sakin ou Triple saut vers Melilla du Mauritanien Cheikhna Aliou Diagana. Humanité entravée, jeunesse brisée. La trajectoire de Zeïtouni est un crève-coeur par lequel l'auteur nous conte l'horreur. Le captif donc. Il arrive toutefois à s’évader. Une deuxième figure est Tomasta qui est l’esclave eunuque qui a servi durant plusieurs années dans un harem en Arabie Saoudite. L’esclave donc. C'est la condition de l'homme castré en servitude, le portrait parfait de l'eunuque. Un concours de circonstances va lui permettre de s’extraire de sa condition avec une jeune femme yéménite promise au fils de son maître. Une longue marche faite de dissimulations et d’un jeu d’acteur pour ne pas retomber sous l’emprise des chasseurs d’esclaves. L’homme se faisant passer pour un érudit musulman (ce qu’il est devenu par la force des choses). La rencontre de ces anciens captifs va constituer l’élément de moteur de quelque chose de nouveauCréation d’une utopie
Nous ne mesurons pas assez le climat de terreur qui a régné en Afrique sahélienne ou en Afrique subsaharienne pendant plusieurs siècles du fait des traites négrières et de la colonisation. Aussi Nétonon Noël Ndjekery après nous avoir décrit la barbarie qui règne dans Baobabia (un territoire qui ressemble à l'Afrique, il fait échouer ses personnages sur les rives d'un havre de paix, hors du temps, extrait des lieux de bataille, une kirta, c'est-à-dire une île flottante de la Grande Eau. Je m’arrête là pour la description afin que le lecteur à venir découvre les surprises qu'offre cette histoire bien lancée. Tomasta va bâtir les bases d’un état ou l’instruction des anciens captifs va être le maître mot, l’abolition des privilèges un impondérable et la dissuasion, un moyen construit autour des superstitions locales et le mythe de la femme blanche envoûtante et déifiée. La proposition de cette utopie, n’est pas nouvelle en littérature africaine. Déjà, Léonora Miano rappelait ces anciens villages d'anciens captifs de la traite Atlantique souvent construits sur pilotis dans son roman La saison de l’ombre (éd. Grasset). Bebeyadi était également un espace refuge chez Miano. Chez Ndjekery, le moment est différent. Mais l’idée est la même à ceci près que nous sommes au début du 20è siècle et l’île flottante va être un poste d’observation des sociétés environnantes, à partir de celles et ceux qui débarquent, souvent des fugitifs sans être forcément des brigands, qui content un monde qui évolue, les indépendances violentes, les dictatures qui s’installent avec de nouveaux parias. Qui connaît l’histoire violente du Tchad sait qu’il y a matière à discourir. C’est donc une approche originale pour raconter cette partie de l’Afrique de manière fort efficace et sur le plan de la forme, desservir au lecteur une poésie si chère, si belle nourrie des formes d'expressions du Sahara. Je retrouve chez Ndjekery, l’écriture de Tayeb Salih, d’Abdelaziz Baraka Sakin, les voisins soudanais ou encore du Mauritanien Beyrouk.Une constante : la violence
Il y a quelque chose de troublant dans ce roman : la répétition des mécanismes de la violence sur des siècles. L’exemple du marquage imposé par Rabah, l’esclavagiste repris de manière par Hissene Habré questionne sur la méconnaissance de l’histoire. Le sens même d’un des principes de Tomasta, fondateur de cette communauté qui plaçait au coeur de ce projet l’instruction. L’esclavage, les indépendances, les guerres fratricides, la guerre contre la Libye, la montée de Boko Haram, la charge est lourde, elle ne semble pas cesser. Les flashback autorisent un va-et-vient entre l’actualité de Kirta (l’île flottante). Ce que j’aime dans tout cela, c’est le fait que les discours sur la traite orientale se posent tranquillement sans répondre une injonction extérieure. La mémoire des populations soumises aux razzias, aux transactions douteuses s’exprime. J’aimerais dire que les textes se connectent. Après avoir lu le Mauritanien Cheikhna Aliou Diagana avec Triple saut vers Melilla, comment ne pas reconnaitre dans le travail des passeurs, les survivances des anciens caravaniers du désert ? Après avoir lu Coeur de Sahel de Djaïli Amal Amadou, comment ne pas voir dans la ville de Maroua, les rapports de domination hérités entre Peuls et les populations de la région environnante (incarnées par les servantes kaddo). Un peu de littérature comparée serait un bel exercice sur ce chevauchement de thèmes. La qualité de l'objet littéraire c'est par la profondeur de l'analyse proposé au lecteur de le renvoyer à des précédentes lectures, ouvrir des possibilités de relire des événements. Ce roman est comme une pièce de puzzle qui facilite une compréhension du présent.Netonon Noël Ndjekery a écrit un roman exceptionnel au niveau de l’originalité de sa construction narrative, de la qualité de son écriture chargée de poésie et sur le cours d’histoire qu’il nous impose. Contempler le présent, c’est bien mais comprendre sa construction est d’une intelligence supérieure. Merci M. Ndjekery !
Netonon Noël Ndjekery, Il n'y a pas d'arc-en-ciels au paradisEditions Hélice Hellas, 2022