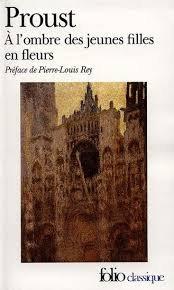
Première partie : autour de Mme Swann.
Swann, après avoir été le « fils Swann » et aussi le Swann du jockey n'était plus l'ami des parents du narrateur. C'était depuis qu'il était devenu le mari d'Odette. Il ne voulait pas imposer Odette à ses amis. Autrefois, Swann dissimulait gracieusement une invitation de Twickenham ou de Buckingham Palace. À présent, il fréquentait d’inélégants fonctionnaires et des femmes tarées. La principale raison de ce changement, laquelle est applicable à l'humanité en général, était que les vertus de Swann n'étaient pas quelque chose de libre. Les vertus finissent par s'associer étroitement dans notre esprit avec les actions à l'occasion desquelles nous nous sommes fait un devoir de les exercer. La mère du narrateur, quand il fut question d'avoir pour la première fois M. de Norpois à dîner, avait exprimé le regret que le professeur Cottard fût en voyage. Le professeur Cottard fut très bien considéré pendant quelques années. Les plus intelligents parmi les jeunes médecins voulaient être soignés par Cottard si jamais ils tombaient malades. On vantait la promptitude, la profondeur, la sûreté de son coup d'oeil et de son diagnostic. Cottard était apprécié chez les Verdurin. Chez eux, il redevenait lui-même. Ailleurs, il était volontiers silencieux, froid et impassible. C'était surtout à l'impassibilité qu'il s'efforçait et même dans son travail. Le marquis de Norpois avait été ministre plénipotentiaire avant la guerre et ambassadeur. Sa longue pratique de la diplomatie l'avait rendu imbu de cet esprit négatif et conservateur que l'on appelait « esprit de gouvernement ».
M. de Norpois passait pour très froid à la commission où il siégeait à côté du père du narrateur le père du narrateur était étonné d'avoir reçu l'amitié de M. de Norpois. En effet, il avait l'habitude de n'être pas recherché en dehors du cercle de ses intimes.
Les collègues du père du narrateur étaient surpris que de Norpois l'invite à dîner. Car le marquis n'avait de relations privées avec personne. Le père du narrateur s'intéressait beaucoup à la politique étrangère. Il appréciait donc particulièrement les conversations avec M. de Norpois. La conversation de M. de Norpois était un répertoire complet des formes surannées du langage. La mère du narrateur le trouvait un peu « vieux jeu » mais cela était loin de lui sembler déplaisant au point de vue des manières. Elle s'entraînait elle-même à admirer l'ambassadeur pour pouvoir le louer avec sincérité.
Elle ne songeait pas que l'ambassadeur avait été habitué autrefois dans la diplomatie à considérer les dîners en ville comme faisant partie de ses fonctions, et à déployer une grâce invétérée quand il venait chez les parents du narrateur. Le narrateur se souvenait très bien du premier dîner que M. de Norpois fit chez ses parents parce qu'en discutant avec lui il s'était rendu compte tout d'un coup combien les sentiments qu'il avait pour Gilberte Swann et ses parents différaient de ceux que cette une famille faisait éprouver à n'importe quelle autre personne. Le père du narrateur avait toujours désiré que son fils devienne diplomate mais le narrateur ne pouvait supporter l'idée d'être envoyé un jour comme ambassadeur dans des capitales que Gilberte n'habiterait pas. Il aurait préféré devenir écrivain mais son père avait fait une constante opposition à ce projet qu'il estimait fort inférieur à la diplomatie jusqu'au jour où Monsieur de Norpois lui avait assuré qu'on pouvait, comme écrivain, s'attirer autant de considération que dans les ambassades. Aussi le père du narrateur conseilla à son fils d'écrire quelque chose de bien à montrer à M. de Norpois qui était prêt à le faire entrer dans la Revue des Deux Mondes.
Le narrateur éprouvait un grand désir de voir la Berma qui avait décidé de rejouer un de ses anciens succès : Phèdre mais le médecin qui le soignait avait déconseillé à ses parents de le laisser aller au théâtre. Mais le narrateur attendait de ce spectacle tout autre chose qu'un plaisir. Il en attendait des vérités appartenant à un monde plus réel que celui où il vivait et desquelles l'acquisition une fois faite ne pourrait pas lui être enlevée par des incidents insignifiants. Puis ses parents avaient fini par céder. Alors le narrateur après avoir détesté leur cruauté avait peur de leur faire de la peine en risquant sa santé.
Pourtant, quand il vit la Berma jouer Phèdre, il ne parvint pas à recueillir une miette des raisons que l'actrice lui avait données de l'admirer. Il l'avait écoutée comme il aurait lu Phèdre. Il trouva sa diction monotone. Enfin éclata son premier sentiment d'admiration en entendant les applaudissements frénétiques des spectateurs. Alors, au fur et à mesure qu'il applaudissait, il lui semblait que la Berma avait mieux joué. Il partagea avec ivresse le vin grossier de cet enthousiasme populaire. Malgré tout il ressentit un désappointement que ce plaisir qu'il avait tant désiré n'eût pas été plus grand.
Le narrateur fut présenté à Monsieur de Norpois qui exerçait sur chaque nouveau venu ses facultés aiguës d'observateur afin de savoir de suite à quelle espèce d'homme il avait à faire. L'ambassadeur lui posa un certain nombre de questions sur ce qu'avait été sa vie et ses études. Quand l'ambassadeur lui parla de littérature, le narrateur comprit qu'il avait eu doublement raison de renoncer à celle-ci. Jusqu'ici, le narrateur s'était seulement rendu compte qu'il n'avait pas le don d'écrire. À présent, Monsieur de Norpois lui en ôta même le désir.
Pourtant, l'ambassadeur encouragea le narrateur à devenir écrivain. Il lui donna même sa carte pour que le narrateur s'en serve pour recueillir les conseils d'un de ses proches. L'ambassadeur discuta avec le père du narrateur des placements boursiers les plus opportuns. Il conseilla de placer les économies de son fils dans les emprunts russes.
Le père du narrateur envoya chercher un petit poème en prose que son fils avait écrit autrefois à Combray en revenant d'une promenade. L'ambassadeur lut le poème et le lui rendit sans dire une parole. Au cours du dîner, le père du narrateur demanda à son fils d'évoquer le spectacle qu'il venait de voir le jour même. Mais le narrateur n'hésita pas à dire sa déception. Son père en fut surpris. L'ambassadeur rétorqua que la Berma avait du succès car elle savait choisir ses rôles et ses costumes. Il vanta également la belle voix de l'actrice. Alors le narrateur fut convaincu de ne pas avoir été déçu par la pièce qu'il avait vue.
Au cours du dessert, Monsieur de Norpois évoqua le discours du roi Théodose II à l'Élysée. Ce discours avait été novateur car le roi avait employé le mot « affinités » pour évoquer les relations franco-allemandes. Puis l'ambassadeur évoqua Balbec et son église romane qu'il trouvait assez curieuse. Ensuite il parla du dîner qu'il avait eu la veille chez Mme Swann. La mère du narrateur réprima alors un frémissement. Toutefois curieuse de savoir quel genre de personnes les Swann pouvaient recevoir, elle demanda à Monsieur de Norpois celles qu'il y avait rencontrées. Il répondit qu'il y avait surtout des hommes mariés qui étaient venus sans leurs épouses et quelques femmes appartenant plutôt au monde républicain qu’à la société de Swann.
Il pensait que Swann n'était pas malheureux de fréquenter les connaissances de sa femme alors qu'il avait été à la mode dans les coteries les plus triées. Dans les années qui précédèrent son mariage, Swann avait subi d'assez vilaines manoeuvres de chantage de la part de sa femme qui le privait de sa fille chaque fois qu'il lui refusait quelque chose. Mais Swann n'avait pas voulu voir la réalité. Après le mariage, la femme de Swann paraissait devenue d'une douceur d'ange. Odette n'avait pas cru que Swann finirait par l'épouser. Elle n'était même pas loin de croire que Swann l'abandonnerait tout à fait. Elle avait vécu un sentiment d'humiliation et de honte. Cela l'avait aigrie. Puis, le régime matrimonial avait mis fin à son caractère infernal. Presque tout le monde s'étonna de ce mariage. Odette espérait que son mari recevrait un jour le succès pour les livres qu'il écrivait. Cela lui aurait permis à elle de se faire ce que chez les Verdurin elle avait appris à mettre au-dessus de tout : un salon. Il n'y eut pas de la part de Swann, quand il épousa Odette, renoncement aux ambitions mondaines, car de ces ambitions-là depuis longtemps Odette l'avait, au sens spirituel du mot, détaché. Il n'y avait eu dans le monde qu'une seule personne dont Swann se fut préoccupé, chaque fois qu'il avait pensé à son mariage possible avec Odette, c'était la duchesse de Guermantes. Il se jouait à lui-même la scène de la présentation de sa femme et de sa fille à la duchesse. On peut dire que si Swann avait épousé Odette, ce fut pour la présenter avec Gilberte à la duchesse de Guermantes. Mais la réalisation de cette ambition se trouva lui être interdite. Odette et Gilberte se lièrent avec la duchesse mais après la mort de Swann.
Monsieur de Norpois révéla au narrateur que Swann avait été ami avec le comte de Paris. Le comte de Paris avait même aperçu Odette et son impression envers elle était loin d'avoir été défavorable. Monsieur de Norpois, lui-même, avait une excellente impression d'Odette. Le narrateur voulait savoir si Monsieur de Norpois avait vu Bergotte avec Swann. Et c'était le cas. Mais Monsieur de Norpois n'appréciait pas l'écriture de Bergotte et il comprenait mieux l'admiration du narrateur pour cet écrivain après avoir lu les quelques lignes que le narrateur lui avait montrées. Il avait remarqué l'influence de Bergotte dans le texte que le narrateur lui avait montré. De plus Monsieur de Norpois n'appréciait pas cet écrivain qu'il jugeait vulgaire par moments. Le narrateur était atterré par ce que M. de Norpois venait de lui dire sur le texte qu'il avait écrit. Il sentit une fois de plus sa nullité intellectuelle et croyait n'être pas né pour la littérature. Monsieur de Norpois avait refusé d'inviter Bergotte à l'ambassade de France à Vienne quand il y exerçait. Aussi, il ne comprenait pas pourquoi Swann invitait Bergotte en même temps que lui-même.
Puis le narrateur parla de Gilberte à Monsieur de Norpois. Il lui avoua qu’il se promenait au bois rien que dans l'espoir de la voir passer. L'ambassadeur lui promit de parler de cet aveu à Gilberte et à sa mère car il pensait qu'elles en seraient flattées. Le narrateur en fut comblé car il espérait ainsi attirer l'attention de Gilberte comme l'ami d'un homme important. Bien des années plus tard, Monsieur de Norpois ferait allusion à ce moment au cours duquel le narrateur était sur le point de lui baiser les mains. Mais le narrateur voulait être tout à fait honnête et avoua qu'il n'avait jamais eu de relations avec la mère de Gilberte. C'est alors qu'il comprit que l'ambassadeur ne ferait jamais la commission dont il avait parlé. Il demanda cependant quelques jours plus tard un renseignement que le narrateur désirait et chargea le père du narrateur de le lui transmettre. Ce renseignement que Monsieur de Norpois avait demandé à Mme Swann, il n'avait pas cru devoir dire pour qui il le demandait.
La mère du narrateur regrettait de voir son fils renoncer à la diplomatie et encore plus de le voir s'adonner à la littérature. Mais le père du narrateur défendait son fils en disant qu'il fallait avant tout prendre du plaisir à ce que l'on faisait. Pourtant le narrateur se demandait si son désir d'écrire était quelque chose d'assez important pour que son père dépense à cause de cela tant de bonté. Après le départ de l'ambassadeur, les parents du narrateur commentèrent ce que Monsieur de Norpois leur avait raconté. Quant à Françoise, elle avait été ravie d'être traitée par l'ambassadeur de « chef de premier ordre ». La mère du narrateur avait envoyé autrefois Françoise dans certains grands restaurants pour voir comment on y faisait la cuisine.
Quand arriva le 1er janvier, le narrateur fit des visites de famille avec sa mère. Les visites finies, il courut jusqu'aux Champs-Élysées pour porter une lettre. La marchande la remettrait à la personne qui venait plusieurs fois par semaine de chez les Swann pour y chercher du pain d'épice. C'était une lettre pour le Gilberte dans laquelle il disait que leur amitié ancienne disparaissait avec l'année finie mais qu'à partir du 1er janvier c'était une amitié neuve qu'ils allaient bâtir, si solide que rien ne pourrait la détruire. Mais au fond de lui, il sentait que cette nouvelle amitié c'était la même, comme ne sont pas séparées des autres par un fossé des années nouvelles que notre désir, sans pouvoir les atteindre et les modifier, recouvre à leur insu d'un nom différent. Le narrateur ne croyait donc plus au nouvel an comme les hommes vieux. Il était pourtant jeune encore tout de même puisqu'il avait pu écrire un mot à Gilberte. La tristesse des hommes qui ont vieilli est de ne pas même songer à écrire de telles lettres dont ils ont appris l'inefficacité. Avant de se coucher, il regarda une photo de la Berma qu'il s'était offerte et il ressentit une nostalgie plus triste que le soir au fond des bois. Il pensait que dans la confusion de l'existence, il était rare qu'un bonheur vienne justement se poser sur le désir qui l'avait réclamé. Un mot de Gilberte n’eût peut-être pas été ce qu'il lui eût fallu.
Il continua de se rendre aux Champs-Élysées mais Gilberte n'y était pas. Le narrateur ne se rappelait même pas sa figure. Il ne se rappelait que son sourire. Il n'était pas loin de croire que, ne pouvant se rappeler le visage de Gilberte, il l'avait oubliée et ne l'aimait plus. Puis le narrateur revit Gilberte presque tous les jours. Elle mettait devant lui de nouvelles choses à désirer. Il se demanda si Swann avait surpris la lettre qu'il avait écrite à sa fille. Elle avait pris un air vague quand il lui avait dit combien il admirait son père et sa mère. Gilberte lui avoua que ses parents ne le gobaient pas. Pourtant le narrateur éprouvait des sentiments passionnés pour Swann et il espérait que celui-ci se repentirait de son jugement à son égard. Alors il écrivit une longue lettre pour Swann et la donna à Gilberte. Il avait écrit 16 pages ardentes et sincères mais cela ne recueillit aucun succès. Après avoir lu la lettre Swann avait dit que tout cela ne signifiait rien et ne faisait que prouver combien il avait raison. Le narrateur était désespéré. Il demanda à Gilberte s'il y avait un moyen d'avoir une explication verbale avec son père et elle avait déjà proposé cette explication à Swann qui l'avait jugée inutile. Puis elle lui rendit la lettre qu'il avait écrite à Swann. Le narrateur tomba malade au point d'avoir 40° de fièvre mais il le cacha car il avait envie de continuer à voir Gilberte aux Champs-Élysées. Au retour, Françoise déclara que le narrateur était indisposé et on fit venir le médecin. Le médecin avait préconisé de faire boire du cognac au narrateur pour soigner ses congestions pulmonaires. Cela avait inquiété sa grand-mère car elle ne voulait pas le voir devenir alcoolique. Pourtant un soir de crise, c'est sa propre grand-mère qui était allée acheter du cognac parce qu'il n'y en avait pas à la maison.
On fit venir le Dr Cottard qui prescrivit des purgatifs violents et du lait pendant plusieurs jours. La mère du narrateur protesta mais le docteur insista sans donner d'explication sur ce régime. Les parents du narrateur refusèrent d'appliquer le traitement à leur fils. Ils cherchèrent naturellement à cacher au professeur leur désobéissance. Puis, l'état du narrateur s'aggravant, on se décida à faire suivre au narrateur à la lettre les prescriptions de Cottard. Au bout de trois jours, le narrateur fut rétabli. Cottard avait décerné que le narrateur souffrait d'intoxication. La famille du narrateur comprit que cet imbécile de Cottard était un grand clinicien. Le narrateur n’eut plus le droit de retourner aux Champs-Élysées.
Il reçut une lettre de Gilberte. Celle-ci avait appris que le narrateur était souffrant. Elle lui proposait de venir chez elle pour prendre le goûter des qu'il serait rétabli. Le narrateur mis du temps à réaliser ce qu'il venait de lire puis il connut son bonheur.
Le narrateur pensait que l'amant était mal placé pour connaître la nature des obstacles que la ruse de la femme lui cachait et que son propre jugement faussé par amour l'empêchait d'apprécier exactement. Bloch était venu voir le narrateur pour lui raconter qu'il avait entendu dire que Mme Swann l'aimait beaucoup par une personne avec qui il avait dîné la veille. Cottard avait entendu cette confidence. Comme il était le médecin de Mme Swann, il parla avec celle-ci du narrateur.
Le narrateur finit par connaître l'appartement des Swann. Les parents de Gilberte, qui si longtemps avait empêché le narrateur de la voir, lui serraient la main en souriant et en lui demandant comment il allait. Les goûters de Gilberte qui lui avait paru la plus infranchissable des séparations entre elle et lui devenaient maintenant une occasion de les réunir dont elle l’avertissait par un mot sur un papier à lettres toujours différent. Il s'était imaginé que l'appartement occupé par les Swann était extraordinaire mais son père savait quel architecte avait construit ce genre de maison et il ne le trouvait pas commode. Le narrateur mangeait du gâteau sachant qu'il aurait du mal à le digérer et buvait du thé indéfiniment alors qu'une seule tasse l'empêchait de dormir pour 24 heures. Et sa mère se demandait pourquoi à chaque fois qu'il rentrait de chez les Swann il était malade. Odette, depuis qu'elle aussi avait un salon et des invités, prenait les façons de Mme Verdurin avec son ton de despotisme minaudier.
Le narrateur comprit que c'était tout ce que Gilberte avait raconté à ses parents sur Françoise qui leur avait donné de la sympathie pour lui. Aussitôt, il changea entièrement d'avis sur Françoise. Le royaume dans lequel il était accueilli était contenu lui-même dans un plus mystérieux encore dans lequel Swann et sa femme menaient leur vie surnaturelle. Bientôt, le narrateur allait pénétrer aussi au coeur du Sanctuaire. Il se rendait chez eux quand Gilberte n'était pas là. Ils lui demandaient d'user de son influence sur leur fille. Alors le narrateur se rappelait de la lettre si complète et si persuasive qu'il avait naguère écrite à Swann et à laquelle il n'avait même pas daigné répondre. La vie avait dénoué si aisément ce que la puissance de l'esprit, du raisonnement et du coeur avait été incapable de résoudre. Swann faisait entrer le narrateur dans sa bibliothèque et lui montrait des objets d'art et des livres qu'il jugeait susceptibles de l'intéresser. Mais ce n'était pas la beauté intrinsèque des choses qui le rendaient miraculeux d'être dans le cabinet de Swann. C'est l'adhérence à ces choses du sentiment particulier que le narrateur y localisait depuis tant d'années. Les Swann participaient à ce travers des gens chez qui peu de monde va ; la visite, l'invitation, une simple parole aimable de personnes marquantes étaient pour eux un événement auquel ils souhaitaient de donner de la publicité.
Il n'était pas jusqu'aux lettres, aux télégrammes flatteurs reçus par Odette que les Swann ne fussent incapables de garder pour eux.
Le salon de Swann ressemblait ainsi à ces hôtels de villes d'eaux où on affiche les dépêches.
Les personnes qui, comme le narrateur, avaient connu l'ancien Swann dans ce milieu Guermantes aurait pu s'étonner en constatant que l'ancien Swann avait cessé d'être non seulement discret quand il parlait de ses relations mais difficiles quand il s'agissait de les choisir. Comment pouvait-il déclarer Mme Bontemps agréable alors qu'elle était commune et méchante. Il y avait certes chez les Guermantes du goût mais aussi du snobisme, d'où possibilité d'une interruption momentanée dans l'exercice du goût. S'il s'agissait de quelqu'un qui n'était pas indispensable à cette coterie, le goût s'exerçait à fond contre lui. La curiosité des parents du narrateur était piquée par le nom de personnes que Mme Swann arrivait peu à peu à connaître. La mère du narrateur comparait les relations conquises par Mme Swann à une guerre coloniale. Mme Swann avait convié Mme Cottard dans son salon pour que cette dernière puisse informer les anciennes relations de Mme Swann sur ses nouvelles relations. Mais les femmes élégantes n'allaient pas chez Mme Swann. Ce n'était pas la présence de notabilités républicaines qui les avait fait fuir. Le salon le plus brillant de Paris fut celui d'un prince autrichien et ultra-catholique. Qu'au lieu de l'affaire Dreyfus il fut survenu une guerre avec l'Allemagne, le tour du kaléidoscope se fut produit dans un autre sens. Les juifs ayant, à l'étonnement général, montré qu'ils étaient patriotes, auraient gardé leur situation et personne n'aurait plus voulu aller chez le prince autrichien. La seule chose qui ne changeait pas, selon le narrateur, était qu'il semblait chaque fois qu'il y avait « quelque chose de changé en France ».
Au moment où le narrateur allait chez Mme Swann, l'affaire Dreyfus n'avait pas encore éclaté et certains grands juifs étaient fort puissants. Le plus puissant était Rufus Israels dont la femme était la tante de Swann. Mais Swann ne l'aimait pas. C'était la seule des parentes de Swann qui avait conscience de la situation mondaine de celui-ci. Aucune agence Havas n'avait renseigné les cousins de Swann sur les gens qu'il fréquentait et Swann était surnommé par ses cousins le « cousin bête » en jouant sur le titre du roman de Balzac. Lady Israels savait à merveille qui étaient ces gens qui prodiguaient à Swann une amitié dont elle était jalouse. Elle disposait d'une grande influence et elle l’avait employée à ce qu'aucune personne qu'elle connaissait ne reçût Odette. Mais la comtesse de Marsantes avait désobéi. Or, le malheur avait voulu qu'Odette étant allée rendre visite à Mme de Marsantes y rencontre lady Israels presque en même temps. Lady Israels n’adressa pas une seule fois la parole à Odette. Odette ne fut pas encouragée à pousser désormais plus loin une incursion dans un monde qui n'était nullement celui où elle eût aimé être reçue.
Swann était du reste aveugle en ce qui concernait Odette, non seulement devant les lacunes de son éducation mais aussi devant la médiocrité de son intelligence. Quand elle racontait une histoire bête, il l'écoutait avec complaisance et gaieté alors que ce qu'il pouvait raconter de fin était écouté par Odette habituellement sans intérêt. De plus Odette se permettait de contredire son mari avec sévérité. Odette ressemblait trop aux dames « brûlées » de la haute société. Des femmes chez qui on allait en toute confiance avaient été reconnues être des filles publiques ou des espionnes anglaises.
Swann était souvent intéressé par une dame déclassée parce qu'elle avait été la maîtresse de Liszt ou qu'un roman de Balzac avait été dédié à sa grand-mère. Le narrateur avait le soupçon que sa famille avait remplacé à Combray l'erreur de croire Swann hambourgeois n'allant pas dans le monde, par une autre, celle de le croire un des hommes les plus élégants de Paris. Swann chercher un divertissement assez vulgaire consistant à faire comme des bouquets sociaux en groupant des éléments hétérogènes.
Swann rentrait souvent assez peu de temps avant le dîner. Mais il ne se demandait plus ce qu'Odette pouvait être en train de faire. Il se rappelait parfois qu'il avait, bien des années auparavant, essayé un jour de lire à travers l'enveloppe une lettre adressée par Odette à Forcheville. Mais ce souvenir ne lui était pas agréable. Il savait à présent que si Odette l'avait aimé plus qu'il n'avait cru, elle l'avait aussi trompé davantage. Il avait cessé d'être jaloux. Il était depuis longtemps insoucieux qu'Odette l’eût trompé et le trompât encore.
Et pourtant il avait continué pendant quelques années à rechercher d'anciens domestiques d'Odette tant avait persisté chez lui la douloureuse curiosité de savoir si ce jour là, tellement ancien, à six heures, Odette avait couché avec Forcheville. Puis cette curiosité elle-même avait disparu. Mais ses investigations avaient continué. Éclaircir un jour les faits de la vie d'Odette auxquels il avait dû ses souffrances n'avait pas été le seul souhait de Swann ; il avait mis en réserve aussi celui de se venger d'elles. À présent, il aimait une autre femme qui ne lui donnait pas de motifs de jalousie parce qu'il n'était plus capable de renouveler sa façon d'aimer et que c'était celle dont il avait usé pour Odette qui lui servait encore pour une autre. L'amant vieilli ne pouvait connaître sa maîtresse d'aujourd'hui qu'à travers le fantôme ancien et collectif de la « femme qui excitait sa jalousie ». Il ne tenait plus à ces représailles avec Odette car, avec l'amour, avait disparu le désir de montrer qu'il n'avait plus d'amour. Autrefois, il aurait tant désiré laisser voir à Odette qu'il était épris d'une autre. Maintenant, il prenait 1000 précautions pour que sa femme ne soupçonne pas son nouvel amour.
Le narrateur avait été admis dans les sorties de Gilberte qu'elle faisait avec sa mère au théâtre, à une leçon de danse chez un camarade de Gilberte ou à une réunion mondaine chez une amie de Mme Swann ou pour visiter les tombeaux de Saint-Denis. Il est également admis aux déjeuners des Swann que ceux-ci appelaient le lunch comme ils appelaient Noël « Christmas », ce que le père du narrateur trouvait ridicule. Mme Swann arrivait souvent en retard aux déjeuners. Alors le narrateur attendait en compagnie de Gilberte et de Swann. Le narrateur rayonnait de joie dans cette maison où Gilberte lui parlait avec son regard attentif et souriant. Parfois, Mme Swann se mettait au piano. Elle avait même joué la partie de la sonate de Vinteuil dans laquelle se trouvait la petite phrase que Swann avait tant aimée. Le narrateur découvrit petit à petit ce qui se cachait dans la sonate mais ne la posséda jamais tout entière. Il trouvait qu'elle ressemblait à la vie. Ce qui était cause, selon lui, qu’une oeuvre de génie était difficilement admirée tout de suite, c'était que celui qui l'avait écrite était extraordinaire et que peu de gens lui ressemblaient. C'était donc l'oeuvre elle-même qui, en fécondant les rares esprits capables de la comprendre, les ferait croître et multiplier. Le narrateur pensait que les génies préparaient pour l'avenir un public meilleur dont d'autres génies et que l'oeuvre créait donc elle-même sa postérité. Swann avait sa propre interprétation de la fameuse phrase de la sonate de Vinteuil. Il pensait que cette sonate évoquait le bois de Boulogne. Le narrateur comprit plus tard par d'autres propos de Swann que les feuillages nocturnes du bois de Boulogne étaient tout simplement ceux sous l'épaisseur desquels, dans maint restaurant des environs de Paris, il avait entendu, bien des soirs, la fameuse petite phrase. Pour Swann, la sonate évoquait aussi tout un printemps dont il n'avait pu jouir autrefois car il n'avait pas assez de bien-être pour cela. Les charmes que lui avaient fait éprouver certaines nuits dans le bois de Boulogne et sur lesquels la sonate de Vinteuil pouvait le renseigner, il n'aurait pu à leur sujet interroger Odette qui pourtant l'accompagnait comme la petite phrase. Puis Swann et sa femme évoquèrent Mme Blatin qu'ils trouvaient bête. Soi ne raconta au narrateur qu'un jour, Mme Blatin se rendit au jardin d'acclimatation et y rencontra un Cynghalais qu'elle traita de "ni négro ». Et l'homme lui répondit qu'elle était un chameau. Le narrateur éprouva le besoin d'aller au jardin d'acclimatation avec les Swann. La mère de Gilberte avait raconté au narrateur que celle-ci avait non seulement pour ses amies, mais pour les domestiques, pour les pauvres, des attentions délicates, longuement méditées et un désir de faire plaisir qui se traduisait par de petites choses qui souvent lui donnaient beaucoup de mal. Quand Swann parlait des grandes relations de sa femme, Gilberte détournait la tête et se taisait car son père ne lui paraisst pas pouvoir être l'objet de la plus légère critique. Elle ne voulait pas connaître Mlle Vinteuil parce que cette dernière n'était pas gentille pour son père et cela lui faisait de la peine. Le narrateur avait demandé à Mme Swann quels étaient parmi les camarades de Gilberte ceux qu'elle aimait le mieux. Odette avait répondu que c'était lui le grand favori. Le salon des Swann avait dans le souvenir du narrateur une cohésion, une unité, un charme individuel.
Le narrateur était fier de s'avancer à côté de Mme Swann au jardin d'acclimatation. Les camarades de Gilberte jetaient sur elle des regards d'admiration auxquels elle répondait coquettement par un long sourire. Les camarades de Gilberte regardaient le narrateur comme un de ces êtres qu'il avait tant enviés quand il n'était encore lui-même l'ami de Gilberte. Souvent dans les allées du bois ou du jardin d'acclimatation, une grande dame amie de Swann les saluait. Odette avait pris toutes les manières du monde et si élégante et noble de port que fut la dame rencontrée, Mme Swann l'égalait toujours en cela. Un jour, le narrateur fut présenté à la princesse Mathilde qui avait été l'amie de Flaubert et de Sainte-Beuve. Elle était la nièce de Napoléon et avait été demandée en mariage par Napoléon III et par l'empereur de Russie.
Le narrateur souffla à Swann de demander à la princesse si elle avait connu Musset. Elle répondit qu'elle l'avait très peu connu.
Le narrateur fut surpris de rencontrer son ami Bloch et encore plus d'apprendre que Mme Swann le connaissait, car il lui avait été présenté par Mme Bontemps, et qu’il était devenu attaché au cabinet du ministre ce que le narrateur ignorait.
Mme Swann conseilla au narrateur d'aller écrire son nom chez la princesse pour qu'elle puisse l'inviter chez elle. Quand le le temps était mauvais, les Swann emmenaient le narrateur au concert ou au théâtre. Puis ils allaient prendre le thé. Dès que Mme Swann voulait dire au narrateur quelque chose qu'elle désirait que les personnes des tables voisines ou même les garçons qui servaient ne comprissent pas alors elle le disait en anglais. Or tout le monde savait l'anglais sauf le narrateur. Néanmoins, il devinait que les réflexions de Mme Swann devaient être désobligeantes.
Une fois, les Swann devaient emmener le narrateur à l'opéra mais c'était l'anniversaire de la mort du père de Swann. Cela ennuyait Swann de les voir aller au concert ce jour-là. Le narrateur trouva cela tout à fait naturel mais Gilberte resta impassible. Puis Swann appela Gilberte et on entendit des éclats de voix. Le narrateur ne pouvait pas croire que Gilberte si soumise et si tendre résiste à la demande de son père.
Le narrateur tenta de la convaincre de ne pas y aller mais elle lui répondit d'une voix dure qu'i ne devait pas lui faire d'observations.
Un jour, le narrateur reçut un carton d'invitation de la part des Swann. Jamais personne ne lui avais déposé de cartes et il en fut très fier.
Alors il commanda une superbe corbeille de camélias et l'envoya à Mme Swann puis il demanda à son père de faire imprimer des cartes à son nom et d'ajouter « Mr » comme c'était la mode. Mais son père refusa. C'est lors de cette invitation que le narrateur put rencontrer Bergotte, son poète préféré. Dans son imagination, le poète était un langoureux vieillard. Il eut la surprise de découvrir que c'était en réalité un homme jeune, rude, petit et myope.
Le narrateur se demandait à présent si l'oeuvre du poète garderait la force de s'élever. Puis en écoutant parler, le narrateur se dit que Bergotte avait dû s'appliquer pour écrire ses livres comme un médiocre divertissement d'homme à barbiche et que s'il avait vécu dans une île entourée par des bancs d'huîtres perlières alors il se serait livré avec succès au commerce des perles. Alors l'oeuvre du poète ne sembla plus aussi inévitable au narrateur.
Le narrateur découvrit le caviar pour la première fois. Il était ignorant de ce qu'il fallait en faire mais fut résolu à n'en pas manger.
Le narrateur pouvait entendre parler Bergotte. Il avait l'impression que la diction du poète semblait entièrement différente de sa manière d'écrire. Bergotte avait l'air de parler presque à contresens. De sorte qu'un débit prétentieux, emphatique et monotone était le signe de la qualité esthétique de ses propos et l'effet, dans sa conversation, de ce même pouvoir qui produisait dans ses livres la suite des images et l'harmonie. Un jour que le narrateur répétait des phrases qu'il avait entendu dire à Bergotte, il y retrouva toute l'armature de son style écrit dont il put reconnaître et nommer les différentes pièces dans ce discours parlé qui lui avait paru si différent.
Selon le narrateur, le génie, même le grand talent, venait moins d'éléments intellectuels et d'affinement social supérieurs à ceux d'autrui, que de la faculté de les transformer, de les transposer.
S'il ne devait rien à personne dans sa façon d'écrire, Bergotte tenait sa façon de parler d'un de ses vieux camarades, merveilleux causeur dont il avait subi l'ascendant et qu'il imitait sans le vouloir.
Il y avait dans le style de Bergotte une sorte d'harmonie pareille à celle pour laquelle les anciens donnaient à certains de leurs orateurs des louanges dont nous concevons difficilement la nature, habitués que nous sommes à nos langues modernes où ou ne cherche pas ce genre d’effets.
Bergotte perdit son talent et à chaque fois qu'il écrivit quelque chose dont il n'était pas content il se répéta à lui-même : « malgré tout, c'est assez exact, cela n'est pas inutile à mon pays ». Les mêmes mots avaient servi à Bergotte d'excuse superflue pour la valeur de ses premières oeuvres et lui devinrent comme une inefficace consolation de la médiocrité des dernières.
Bergotte avait appris qu'il avait du génie mais il ne le croyait pas puisqu'il continuait simuler la déférence envers des écrivains médiocres pour arriver à être prochainement académicien alors que l'académie n’a plus à voir avec la part de l'Esprit éternel qu'avec le principe de causalité ou l'idée de Dieu. Le narrateur recueillit des témoignages sur Bergotte. Un de ses proches avait fourni des preuves de la dureté de l'écrivain. Il avait agi cruellement avec sa femme. Mais, dans une auberge de village où il était venu passer la nuit, il était resté pour veiller une pauvresse qui avait tenté de se jeter à l'eau et il avait laissé beaucoup d'argent à l'aubergiste pour qu’il ne chasse pas cette malheureuse. De sorte que l'écrivain avait excité autour de lui des rancunes justifiées et des gratitudes ineffaçables.
Le narrateur, ce premier jour où il rencontra Bergotte, lui raconta avoir entendu récemment la Berma dans cette. Bergotte s'était figuré que l'actrice avait trouvé son inspiration en allant dans les musées. Cela donna au narrateur une nouvelle raison de s'intéresser aux jeux de la Berma.
Le narrateur se laissa aller à raconter ses impressions sur l'interprétation de la Berma. Bergotte n'était pas toujours d'accord avec lui mais il le laisser parler. Alors le narrateur se rappelait des arguments de M. de Norpois en matière d'art qui étaient sans réplique parce qu'ils étaient sans réalité. Le narrateur raconta à Bergotte que ses opinions avaient été méprisées par M. de Norpois. L'écrivain lui répondit que c'était un vieux serin. Il pensait que de Norpois disait beaucoup de sottises. Alors Swann prit la défense de l'ambassadeur en disant que quand celui-ci était secrétaire Rome, il se rendait à Paris deux fois par semaine pour rendre visite à sa maîtresse. Puis Swann prononça une phrase qui devait plus tard prendre dans le souvenir du narrateur la valeur d'un avertissement prophétique mais duquel il ne sut pas tenir compte. Swann dit que le danger des amours qu'ont les gens nerveux pour des personnes qu’ils considèrent comme au-dessous d'eux et qui leur permettent d'une question d'intérêt mette la femme qu'ils aiment à leur discrétion représentaient toutefois un danger. Le danger était que la sujétion de la femme calme un moment la jalousie de l'homme mais rend aussi cette femme plus exigeante. Cela finissait généralement par des drames.
Mme Swann conseilla au narrateur de se méfier de M. de Norpois car il était très mauvaise langue. Mais Swann regarda sa femme avec un air de réprimande comme pour l'empêcher d'en dire davantage. Le narrateur observait Gilberte qui se tenait à côté de ses parents. Il constatait que la distribution des qualités et des défauts de Gilberte dont elle avait hérité de ses parents faisait comme s'il y avait deux Gilberte. L'une parlait avec le coeur de son père et l'autre avec le coeur de sa mère. L'écart était même parfois tellement grand entre les deux Gilberte qu'on se demandait ce qu'on avait pu lui faire pour la retrouver si différente.
Swann était de ces hommes qui, ayant vécu longtemps dans les illusions de l'amour, ont vu le bien-être qu'ils ont donné à un nombre de femmes accroître le bonheur de celles-ci sans créer de leur part aucune reconnaissance et aucune tendresse ; mais dans leur enfant ils croient sentir de l'affection qui les fera durer après leur mort.
Le narrateur était persuadé qu'il avait paru stupide à Bergotte quand Gilberte lui chuchota à l'oreille qu'elle nageait dans la joie parce qu'il avait fait la conquête de son grand ami Bergotte. Bergotte avait dit à Mme Swann qu'il avait trouvé le narrateur extrêmement intelligent. Pourtant le narrateur sentait combien ce qu'il désirait dans la vie était purement matériel et avec quelle facilité il se serait passé de l'intelligence.
Bergotte chercha à convaincre le narrateur de son intelligence. Il lui demanda s'il était bien soigné et qui le soignait. Alors le narrateur lui parla du docteur Cottard.
Bergotte pensait que Cottard était un imbécile et que le narrateur avait besoin d'un médecin approprié à son intelligence. Bergotte estimait que les trois quarts du mal des gens intelligents venaient de leur intelligence.
Bergotte lui conseilla de consulter le docteur du Boulbon. Ce que Bergotte lui dit au sujet de Cottard le frappa, tout en étant contraire à tout ce qu'il croyait. Le narrateur ne s'inquiétait nullement de trouver son médecin ennuyeux et il ne tenait pas à ce que Cottard cherche à comprendre son intelligence. Le narrateur venait de s'installer parmi les amis de Bergotte d'emblée et tranquillement grâce à Swann. À cette époque le narrateur pensait que cette amabilité de Swann était indirectement à l'adresse de ses parents. Mais les parents du narrateur n'avaient pas été sensibles à cette faveur que Swann avait consentie à l'admirateur de Bergotte. Déjà la simple fréquentation du narrateur chez les Swann avais été très loin d'enchanter ses parents. La présentation à Bergotte leur apparut comme une conséquence néfaste d'une première fois qu'ils avaient eue. Le narrateur raconta à ses parents que Bergotte l'avait trouvé extrêmement intelligent et sans s'en douter, il venait de dire la seule parole qui fut au monde capable de vaincre chez ses parents leurs préjugés à l'égard de Bergotte.
La mère du narrateur dit qu'il serait beaucoup pardonné à Bergotte puisqu'il avait trouvé son petit enfant gentil.
La mère du narrateur lui proposa d'inviter Gilberte à goûter mais il n'osait pas le faire pour deux raisons. La première était que chez Gilberte on ne servait jamais que du thé alors que chez le narrateur on y servait aussi du chocolat, ce que Gilberte aurait pu trouver commun. L'autre raison fut une difficulté de protocole que le narrateur ne ut jamais réussir à lever. Quand le narrateur arrivait chez Mme Swann celle-ci lui demandait comment allait sa mère. Or, la mère du narrateur ne pouvait se résoudre à demander la même chose car elle ne connaissait pas Mme Swann.
Ce fut vers cette époque que Bloch bouleversa la conception du monde du narrateur. Il lui assura que les femmes ne demandaient jamais mieux que de faire l'amour.. Il le conduisit pour la première fois dans une maison de passe.
C'était une maison de passe d'un rang trop inférieur au bloc continu d'y aller. Le personnel était trop médiocre et trop peu renouvelé. La patronne de cette maison ne connaissait aucune des femmes qu'on lui demandait et en proposait toujours dont on n'aurait pas voulu.
Elle vantait surtout une jeune femme avec un sourire plein de promesses en disant que c'était une Juive. Cette jeune femme s'appelait Rachel. Elle était brune et pas jolie mais elle avait l'air intelligent. Mais il avait entendu dire à la patronne : « alors, c'est entendu, demain je suis libre, si vous avez quelqu'un vous n'oublierez pas de me faire chercher ». À cause de cela, le narrateur avait classé Rachel immédiatement dans une catégorie générale de femmes dont l'habitude commune à toutes était de venir là le soir voir s'il n'y avait pas un louis ou deux à gagner.
À cause de l'opéra d'Halévy, le narrateur l'avait surnommée « Rachel quand du seigneur ».
Le narrateur cessa de se rendre dans cette maison de passe après avoir donné quelques meubles hérités de sa tante Léonie à la tenancière. Quand il vit les meubles de sa tante dans la maison de passe, toutes les vertus qu'on respirait dans la chambre de la tante Léonie à Combray apparurent au narrateur suppliciées par le contact cruel auquel ils les avaient livrées sans défense. Alors il ne retourna plus dans cette maison. Beaucoup plus tard, le narrateur se rappela que c'était sur le canapé qu'il avait offert à la tenancière, que bien des années auparavant, il avait connu pour la première fois les plaisirs de l'amour avec une de ses petites cousines.
Il avait aussi vendu l'argenterie de la tante Léonie pour envoyer plus de fleurs à Mme Swann. À cette époque, le narrateur remettait toujours à plus tard son désir d'écriture. Sa tante l'avait sermonné une fois mais elle sentit que son scepticisme venait de heurter à l'aveugle une volonté et elle s'en excusa. Mais enfin, il était heureux grâce à Gilberte et à ses parents et aucune menace ne s'élevait plus contre son bonheur. Il pensait que dans l'amour, il y avait une souffrance permanente que la joie neutralisait et rendait virtuelle mais qui pouvait à tout moment devenir ce qu'elle serait depuis longtemps si l'on n'avait pas obtenu ce qu'on souhaitait, atroce. Plusieurs fois le narrateur sentit que Gilberte désirait éloigner ses visites. Les parents de Gilberte étaient de plus en plus persuadés de l'excellente influence du narrateur sur leur fille. Il pensait que grâce à eux son amour ne courait aucun risque. Malheureusement, certains signes d'impatience que Gilberte laissait échapper quand son père faisait venir le narrateur malgré elle incitaient le narrateur à se demander si ce n'était pas le fait qu'il était apprécié par les parents de Gilberte la raison secrète pour laquelle son amour ne pourrait durer. La dernière fois qu'il se rendit chez Gilberte, il pleuvait et il avait pris plus de caféine que d'habitude à cause de l'humidité. Gilberte avait été invitée à une leçon de danse chez des gens qu'elle connaissait trop peu pour pouvoir emmener le narrateur avec elle. Mme Swann ordonna à sa fille de rester avec le narrateur au lieu de se rendre sa leçon de danse. Elle haussa les épaules en ôtant ses affaires. Puis Mme Swann se mit à parler en anglais avec sa fille. Et elle s'en alla. Gilberte sembla vouer un regret mélancolique par la présence du narrateur qui l'empêchait d'aller danser. Durant cet après-midi pluvieux, ils discutèrent de la météo et de la pendule du salon. Au bout d'un moment, ne voyant pas se produire de la part de Gilberte le changement heureux qu'il attendait depuis plusieurs heures, le narrateur lui dit qu'elle n'était pas gentille. Elle rétorqua que c'était lui qui n'était pas gentil. Un instant, il eut peur qu'elle crut qu'il ne l'aimait pas. Gilberte lui dit qu'elle l'aimait vraiment et qu'il verrait cela un jour. Mais cette réponse lui fit penser aux coupables qui assurent que leur innocence sera reconnue et il prit subitement la résolution de ne plus voir Gilberte.
En rentrant chez lui, le narrateur écrivit une lettre à Gilberte dans laquelle il laissait tonner sa fureur. Il pensait que les hommes, devant les pensées et les actions d'une femme qu'ils aimaient, étaient aussi désorientés que le pouvaient être devant les phénomènes de la nature les premiers physiciens. Le lendemain, il se rendit chez les Swann en se disant qu'il était bien absurde de décider de ne plus voir Gilberte. Mais le maître d'hôtel lui annonça que Gilberte était sortie. À cause de la façon dont il le dit, le narrateur comprit qu'il était devenu un importun dans la vie de Gilberte et que l'entourage de son amie avait également cette impression. Alors, le narrateur reporta la haine qu'il avait pour Gilberte sur le maître d'hôtel. Il attendit des nouvelles de Gilberte mais elle n'écrivait pas. Le narrateur était en état d'anxiété permanent et ainsi sa souffrance était infiniment plus cruelle qu'au temps de cet ancien 1er janvier où il avait attendu une lettre de son amie. Cette fois, il y avait en lui, au lieu de l'acceptation pure et simple de cette souffrance, l'espoir, à chaque instant, de la voir cesser. Il finit pourtant par arriver à accepter sa souffrance et renonça pour toujours à Gilberte. Plus tard, Gilberte lui proposa des rendez-vous qu'il accepta pour les annuler au dernier moment. Il espérait ainsi persuader Gilberte de son indifférence. Il espérait, de cette façon, elle retrouverait du goût pour lui. Il retournera voir Mme Swann quand il était certain de l'absence de Gilberte. De cette façon, il pouvait entendre parler de Gilberte et il était sûr qu'elle entendrait ensuite parler de lui et d'une façon qui il lui montrerait qu'il ne tenait pas à elle. Savoir qu'il n'avait plus rien à espérer ne l'empêchait pas de continuer à attendre. Chaque visite qu'il faisait à Mme Swann sans voir Gilberte lui était cruelle mais il sentait qu'elle améliorait d'autant l'idée que Gilberte avait de lui. Il pensait que son espérance resterait plus intacte s'il ne rencontrait pas Gilberte. Mme Swann étendait aux fleurs le goût d'un luxe secret. On était gêné de ne pas trouver le salon vide tant y tenaient une place énigmatique et se rapportant à des heures de la vie de la maîtresse de maison qu'on ne connaissait pas, ces fleurs qui n'avaient pas été préparées pour les visiteurs d'Odette mais qui étaient comme oubliées par elle. Mme Swann s'imaginait avoir fondé un salon rival à celui de Mme Verdurin. Elle se flattait d'avoir retiré du petit groupe de Mme Verdurin ses hommes les plus agréables et en particulier Swann. Au commencement de l'hiver, Odette avait des chrysanthèmes énormes et d'une variété de couleurs comme Swann jadis n’eût pu en voir chez elle. Un soir, Mme Swann annonça au narrateur que celle-ci lui avait laissé une lettre pour lui demander de venir la voir le lendemain. Cela lui faisait justement le bien qu'il était venu chercher. Pourtant il annonça à Odette que Gilberte et lui-même ne pouvaient plus se voir.
Alors Odette affirma que sa fille l'aimait infiniment et insista pour qu'il vienne la voir le lendemain.
Swann avait demandé à Odette de quitter le clan Verdurin. Il avait seulement permis qu'Odette échange avec Mme Verdurin deux visites par an, ce qui semblait encore excessif à certains fidèles indigns de l'injure faite à la Patronne qui avait pendant tant d'années traité Odette et même Swann comme les enfants chéris de la maison.
Les « ultras » » auraient souhaité que Mme Verdurin cesse toute relation avec Odette mais elle avait refusé. Swann accompagnait sa femme chez les Verdurin en soirée mais il évitait d'être là quand Mme Verdurin venait chez Odette en visite.
Odette enviait secrètement à Mme Verdurin ses arts auxquels la patronne attachait une telle importance : l'art de savoir réunir, de s'entendre à grouper, de mettre en valeur, de s'effacer, de servir de trait d'union.
Mme Verdurin continuait d'appeler Odette par son ancien, de Crécy. En s'en allant, Mme Verdurin déclara à Odette qu'elle ne savait pas arranger les chrysanthèmes. Elle lui conseilla de les disposer comme le faisaient les Japonais. Après le départ de Mme Verdurin, Mme Cottard était restée avec Odette. Elle en profita pour dire qu’elle n'était pas d'accord avec elle au sujet des chrysanthèmes. Odette s'efforçait d'avoir de l'esprit et de conduire la conversation chez elle où elle se sentait plus à l'aise que dans le petit clan Verdurin. Mme Bontemps qui avait dit 100 fois qu'elle ne voulait pas aller chez les Verdurin était ravie d'être invitée axu mercredis du petit clan. À un moment donné, Odette nia le fait d'être intelligente alors que Mme Bontemps venait de lui faire ce compliment. Mais le prince d'Agrigente abonda dans le sens de Mme Bontemps.
Swann était arrivé à l'âge où il se plaisait à entendre dire à Mme Bontemps que c'était ridicule de ne recevoir que des duchesses. Aussi, il appréciait Mme Bontemps parce qu'elle n'était pas snob et parce qu'elle saisissait vite les histoires que Swann racontait. Mme Cottard annonça avoir appris que l'hôtel particulier que venait d'acheter Mme Verdurin serait éclairé à l'électricité. Mme Cottard annonça au narrateur qu'il avait fait la conquête de Mme Verdurin.
Le 1er janvier fut particulièrement douloureux cette année-là pour le narrateur. Gilberte ne lui avait pas envoyé ses voeux. Il pleura beaucoup. Il se rendait compte que c'était par un long et cruel suicide de son moi qui aimait Gilberte qu'il s'acharnait avec continuité, avec la clairvoyance de ce qu'il faisait dans le présent avec pour résultat de ne plus aimer Gilberte. Et pourtant l'idée qu'il éprouverait un jour les mêmes sentiments pour une autre lui était odieuse. En effet, cette idée lui enlevait son amour et sa souffrance pour Gilberte. Le narrateur avait cette idée : le temps dont nous disposons chaque jour est élastique ; les passions que nous ressentons le dilatent, celle que nous inspirons le rétrécissent, et l'habitude le remplit.
Le narrateur pensait que s'il était venu annoncer à Gilberte son indifférence future et les moyens de la prévenir, Gilberte aurait induit de cette démarche que son amour pour elle, le besoin qu'il avait d'elle, étaient encore plus grands qu'elle n'avait cru et son ennui de le voir en eût été augmenté. Malheureusement, certaines personnes parlèrent à Gilberte du narrateur d'une façon qui dût lui laisser croire qu'elles le faisaient à la demande du narrateur. Le narrateur en éprouva moins de plaisir à voir Gilberte car elle le croyait à présent non plus dignement résigné mais manoeuvrant dans l'ombre pour une entrevue. Quand le narrateur écrivait à Gilberte c'était pour chercher seulement à frayer le lit le plus doux au ruissellement de ses pleurs. Il pensait que le regret comme le désir ne cherchait pas à s'analyser mais à se satisfaire. Quand on commence d'aimer, on passe le temps non à savoir ce qu'est son amour mais à préparer les possibilités des rendez-vous du lendemain.
Il pensait également que quand on renonce, on cherche non à connaître son chagrin, mais à offrir de lui à celle qui le cause l'expression qui nous paraît la plus tendre. On dit des choses qu'on éprouve le besoin de dire et que l'autre ne comprendra pas, on ne parle que pour soi-même. Mme Swann avait changé sa décoration et ses vêtements. La mode orientale avait laissé place à la mode de Louis XV. Odette recevait ses intimes dans les soies claires et mousseuses de peignoirs Watteau et non plus dans des robes de chambre japonaises. À présent, elle passait auprès de ses amis pour une femme supérieure. Dans le petit monde dont elle était le soleil, chacun eut été bien étonné si on avait appris qu'ailleurs, chez les Verdurin par exemple, elle passait pour bête. Elle avait engraissé et avait l'air plus calme, plus frais, plus reposé qu'auparavant. Elle s'était enfin inventé une physionomie personnelle, un « caractère » immuable. Swann avait conservé dans sa chambre une photo de sa femme datant de sa jeunesse. Il goûtait dans la jeune femme grêle aux yeux pensifs une grâce botticellienne.
Odette ne voulait pas entendre parler de ce peintre. Swann possédait une merveilleuse écharpe orientale, bleue et rose, qu'il avait achetée parce que c'est exactement celle de la Vierge du Magnificat. Mais Odette ne voulait pas la porter.
Un jour où Mme Swann redit au narrateur ses habituelles paroles sur le plaisir que Gilberte aurait pas le voir, mettant ainsi le bonheur dont il se privait déjà depuis si longtemps comme à la portée de sa main, il fut bouleversé en comprenant qu'il était encore possible de le goûter et il se résolut à aller surprendre Gilberte avant son dîner.
Il décida de ne plus la voir qu'en amoureux et de lui envoyer tous les jours les plus belles fleurs. Il vendit à un marchand une grande potiche de Chine qui avait appartenu à sa tante Léonie. Le marchand lui en proposa 10 000 fr. Cela lui permettrait d'offrir de beaux cadeaux à Gilberte. Quand il remonta dans la voiture en quittant le marchand, le cocher l'emmena dans l'avenue des Champs-Élysées. Très près de la maison des Swann, le narrateur aperçut Gilberte qui marchait lentement à côté d'un jeune homme avec qui elle causait. Le narrateur ne distingua pas le visage du jeune homme. Arrivé chez Mme Swann, celle-ci dit au narrateur qu'elle était désolée car sa fille avait dû prendre un peu l'air avec une de ses amies. Après quoi, le narrateur demanda au cocher de reprendre le même chemin mais Gilberte avait disparu. Alors il rentra chez lui tenant avec désespoir les 10 000 fr. inespérés qui auraient dû lui servir à couvrir Gilberte de cadeaux et il était décidé à ne plus la revoir.
Il dépensa l'argent pour aller voir des femmes qu'il n'aimait pas et pour pleurer dans leurs bras. Il décida tout d'abord de ne pas retourner chez les Swann. Cependant il continuait d'aimer toujours celle, qu’il est vrai, il croyait détester.
Il était irrité du désir que beaucoup de gens manifestaient à cette époque de le recevoir et chez lesquels il refusait d'aller. Il imaginait Gilberte, son attention toujours tournée vers lui. Pendant cette période où, tout en s'affaiblissant, persistait le chagrin, le narrateur distinguait deux formes de chagrin. Il y avait celui que lui causait la pensée constante de Gilberte et celui que ranimaient certains souvenirs comme une phrase méchante prononcée par Gilberte ou un verbe employé par son amie dans une lettre qu'elle lui avait envoyée. La première forme de chagrin lui semblait infiniment moins cruelle que la seconde.
Il fit un rêve qui provoqua en lui de la souffrance. Dans ce rêve un de ses amis agissait envers lui avec la plus grande fausseté et croyait à la sienne. En y réfléchissant, il se rendit compte qu'il venait de rêver de Gilberte. Et il s'était rappelé que la dernière fois où il avait vu Gilberte, le jour où sa mère l'avait empêchée d'aller à une matinée de danse, Gilberte feignait, tout en riant d'une façon étrange, de croire à ses bonnes intentions pour elle. Cela lui rappela que longtemps auparavant, c'était Swann qui n'avait pas voulu croire à sa sincérité et inutilement il avait écrit à Swann.
Il se rappela que Gilberte lui avait rapporté la lettre qu'il avait écrite à Swann en riant. Le narrateur comprit qu'on devient moral des que l'on est malheureux. La souffrance qui s'était renouvelée en lui finit par s'apaiser et il ne voulut plus retourner que rarement chez Mme Swann. Il voulait oublier Gilberte au plus vite. Il continua de lui écrire de temps à autre. Notamment pour lui apprendre la mort de leur vieille marchande de sucres d'orge des Champs-Élysées qui avait remué en lui bien des souvenirs.
Peu à peu, chaque refus de la voir lui fit moins de peine. Il regrettait d'avoir renoncé à entrer dans la diplomatie et de s'être fait une existence sédentaire pour ne pas s'éloigner d'une fille qu'il ne verrait plus et qu'il avait déjà presque oubliée. Il pensait que l'on construisait sa vie pour une personne et, quand enfin on pouvait l'y recevoir, cette personne ne venait pas et on vivait prisonnier dans ce qui n'était destiné qu'à cette personne.
Avec le retour des beaux jours, le narrateur espaça encore ses visites chez Mme Swann. Il se promenait le dimanche avec elle dans l'avenue du Bois. Mme Swann arrivait avec son mari et quelques hommes du club qui étaient venu la voir le matin chez elle ou qu'elle avait rencontrés. Mme Swann se promenait dans l'avenue comme dans l'allée d'un jardin à elle. La foule sentait les barrières d'une certaine sorte de richesse en regardant Mme Swann. Swann était flatté que tant de monde salue sa femme. Mme Swann avait demandé au narrateur s’il ne comptait plus venir voir sa fille. Mais elle était contente qu'il accepte encore de se promener avec elle, le dimanche.
Elle lui dit qu'elle l'avait aimé l'influence qu'il avait exercée sur Gilberte. Longtemps après, le narrateur se rappelait ses promenades avec Mme Swann les dimanches du mois de mai entre midi un quart et une heure.
Deuxième partie : le nom de pays : le pays (premier séjour à Balbec, jeunes filles au bord de la mer).
Deux ans plus tard, le narrateur était arrivé à une presque complète indifférence à l'égard de Gilberte et partit avec sa grand-mère pour Balbec. Mais parfois ne plus voir Gilberte lui était soudain douloureux et cela arrivait à cause d'une chose subtile. Par exemple, pour anticiper sur son séjour en Normandie, il entendit, à Balbec un inconnu qu'il croisa sur la digue dire : « la famille du directeur du ministère des postes ». Cela lui fit repenser à une conversation que Gilberte avait eue avec son père relativement à la famille du directeur du ministère des postes. Le narrateur pensait que c'était grâce à ce genre de détail oublié que nous pouvions de temps à autre retrouver l'être que nous fûmes et souffrir à nouveau. À Paris, le narrateur était devenu de plus en plus indifférent à Gilberte grâce à l'Habitude. Le changement d'habitude, c'est-à-dire la cessation momentanée de l'Habitude paracheva l'oeuvre de l'Habitude quand il partit pour Balbec. Chaque jour depuis des années, le narrateur calquait tant bien que mal son état d'âme sur celui de la veille. Son voyage à Balbec fut comme la première sortie d'un convalescent qui n'attend plus qu’elle pour s'apercevoir qu'il est guéri. Cependant il avait appris que sa mère ne serait pas du voyage et que son père était retenu au ministère jusqu'au moment où il partirait pour l'Espagne avec M. de Norpois. Mais ce n'était pas la première fois qu'il sentait que ceux qui aiment et ceux qui ont du plaisir ne sont pas les mêmes. Il croyait désirer aussi profondément Balbec que le docteur qui le soignait. Pourtant le narrateur savait que quelque fût la chose qu'il aimerait, elle ne serait jamais placée qu'au terme d'une poursuite douloureuse au cours de laquelle il lui faudrait d'abord sacrifier son plaisir à ce bien suprême au lieu de l’y chercher. Comme sa grand-mère ne pouvait se résoudre à aller tout bêtement à Balbec, le narrateur savait qu'elle s'arrêterait 24 heures chez une de ses amies mais aussi pour se rendre à l'église de Balbec. Pour la première fois, le narrateur sentait qu'il était possible que sa mère vécue sans lui et autrement que pour lui.
Elle allait habiter de son côté avec son père parce que la mauvaise santé de son fils rendait l'existence de son mari un peu compliquée et triste. Cette séparation désolait le narrateur parce qu'il se disait qu'elle était probablement pour sa mère le terme des déceptions successives qu'il lui avait causées. Mais sa mère essaya de le rassurer en lui disant qu'il recevrait une lettre d'elle en arrivant à Balbec. Le narrateur pensait à Françoise, la servante qui ne savait rien sauf les rares vérités que le coeur est capable d'atteindre directement. Le monde immense des idées n'existait pas pour elle. Il comparait son regard à celui d'un chien intelligent et bon à qui on sait pourtant que sont étrangères toutes les conceptions des hommes. Le narrateur se demandait s'il n'y avait pas parmi les paysans des être pareils aux hommes supérieurs du monde et que l'on condamnait par une injuste destinée à vivre parmi les simples d'esprit. Il trouvait pourtant les paysans plus essentiellement apparentés aux natures d'élite que la plupart des gens instruits. Il pensait qu'il n'aurait manqué à Françoise que du savoir pour avoir du talent.
Pour éviter les crises de suffocation que lui donnerait le voyage, le narrateur commanda de l'alcool dans le bar du train. C'est son médecin qui lui avait conseillé ce remède. Il effectua le voyage avec sa grand-mère. Elle lui passa un volume de Mme de Sévigné. Tout en lisant, il sentit grandir son admiration pour Mme de Sévigné. Mme de Sévigné était de la même famille qu'un peintre que le narrateur allait rencontrer à Balbec et qui aurait une influence profonde sur sa vision des choses. Ce peintre s'appelait Elstir. Après avoir passé la soirée avec sa grand-mère et l'amie de cette dernière, le narrateur reprit seul le train. Dans le train, le narrateur passa son temps à courir d'une fenêtre à l'autre pour rapprocher, pour rentoiler les fragments intermittents et opposites de son beau matin écarlate et versatile et en avoir une vue totale et un tableau continu.
Le train s'arrêta à une petite guerre entre deux montagnes et une paysanne longea les wagons pour offrir du café au lait à quelques voyageurs réveillés. Empourpré des reflets du matin, son visage était plus rose que le ciel. Le narrateur ressentit devant elle ce désir de vivre qui renaît en nous chaque fois que nous prenons à nouveau conscience de la beauté et du bonheur.
Le narrateur aurait aimé vivre avec cette paysanne pour être initié aux charmes de la vie rustique et des premières heures du jour. Mais il ne put lui parler car déjà le train repartit.
Ce fut à une station de chemin de fer, au-dessus d'un buffet, en lettres blanches sur un avertisseur bleu, que le narrateur put lire le nom, presque de style persan, de Balbec. Il avait imaginé que l'église était près de la plage mais elle était à plus de cinq lieues de distances. Près de l'église il y avait un café. Le narrateur contempla les sculptures des apôtres qui se trouvaient des deux côtés de la Vierge devant la baie profonde du porche. Jusqu'à présent, le narrateur n'avait pu voir que des photographies de l'église de Balbec. Il fut étonné de voir la statue qu'il avait vue 1000 fois sculptée réduite à présent à sa propre apparence de pierre. La Vierge avait sur son corps encrassé la même suie que les maisons voisines. Le narrateur trouva la Vierge qu'il avait imaginée métamorphosée en une petite vieille de pierre. Il en fut déçu et accusa sa déception par la mauvaise disposition où il était et à sa fatigue.
Il retrouva sa grand-mère dans le petit chemin de fer qui devait les conduire à Balbec-Plage. Il n'osa pas lui avouer sa déception après avoir vu l'église de Balbec. Le petit chemin de fer les arrêta à chacune des stations qui précédaient Balbec-Plage et dont les noms ; Incarville, Marcouville, Doville, Pont-à-Couleuvre, Arambonville, Saint-Mars-le-Vieux, Hermonville, Maineville rappelaient au narrateur ces autres noms de Roussainville de Martinville qu'il avait entendu prononcer si souvent par sa grand-tante à table et qui avaient acquis un certain charme où s'était peut-être mélangé des extraits du goût des confitures, de l'odeur du feu de bois et du papier d'un livre de Bergotte. La souffrance du narrateur s'aggrava quand ils débarquèrent dans le hall du Grand hôtel de Balbec car sa grand-mère discuta les « conditions » avec le directeur. Il avait peur de l'hostilité et du mépris des étrangers. Le directeur de l'hôtel, oubliant sans doute que lui-même ne touchait pas 500 fr. d'appointements mensuels, méprisait profondément les personnes qui cherchaient à discuter les conditions. La situation sociale était la seule chose à laquelle le directeur faisait attention. Il émaillait ses propos commerciaux d'expressions choisies, mais à contresens.
La grand-mère du narrateur partit pour faire quelques emplettes. Durant ce temps, le narrateur fit les 100 pas dans les rues encombrées de Balbec. Le besoin qu'il avait de sa grand-mère était grandi par sa crainte de lui avoir causé une désillusion. Elle devait être découragée qu' aucun voyage ne pût faire du bien à son petit-fils. Alors il retourna à l'hôtel. Il observa les personnes qui circulaient dans le grand hôtel et les compara à toute une série de personnages de guignol. Dans sa chambre, il fut incapable de s'allonger pour se reposer à cause des objets qui dérangeaient ses habitudes. Ainsi, il entendait la pendule alors qu'à la maison il n'entendait la sienne que quelques secondes par semaine. Des petites bibliothèques à vitrines le tourmentaient ainsi qu'une grande glace à pieds. Alors sa grand-mère entra, et à l'expansion de son coeur refoulé s'ouvrirent aussitôt des espaces infinis. Elle portait une robe de chambre de percale qu'elle revêtait à la maison chaque fois qu'un membre de la famille était malade. Il se jeta dans ses bras. Puis il se déshabilla pour se coucher. Elle lui dit que s'il avait besoin d'elle, il lui suffirait de frapper au mur puisqu'elle dormait à côté. Ce qui lui faisait la plus peur que l'avenir lui enlèverait la vue et l'entretien de ceux qu'il aimait et d'où il tirait aujourd'hui sa plus chère joie. Il avait encore plus peur de ne pas ressentir comme une douleur cette perte. Cela représenterait pour lui une vraie mort de lui-même. Même si après cette mort, il y aurait une résurrection dans un moi différent. À Combray, le narrateur était connu de tout le monde et ne se souciait de personnes. Dans la vie de bains de mer, on ne connaît pas ses voisins. Le narrateur n'était pas encore assez âgé et restait trop sensible pour avoir renoncé au désir de plaire aux êtres et de les posséder. Il regardait les jeunes gens et les jeunes filles avec une curiosité passionnée. Les gens qui occupaient l'hôtel étaient composés de personnalités éminentes des principaux départements de cette partie de la France. Ils y conservaient toujours la même chambre, et, avec leurs femmes qui avaient des prétentions à l'aristocratie, formaient un petit groupe auquel s'étaient adjoints un grand avocat et un grand médecin de Paris. Ce petit groupe de l'hôtel de Balbec regardait d'un air méfiant chaque nouveau venu et interrogeait sur son compte le maître d'hôtel. Le narrateur et sa grand-mère, parce qu'ils mangeaient des oeufs durs dans la salade, ce qui était réputé commun et ne faisait pas dans la bonne société d'Alençon, étaient toisés par le petit groupe. Un jour, le narrateur et sa grand-mère furent placés à la table de M. et Mlle de Stermaria, au hobereau de Bretagne et sa fille. Ces derniers n'étaient pas censés rentrés avant le soir. Mais ils revinrent plutôt que prévu et M. de Steraria, sans le moindre geste d'excuse, pria à haute voix le maître d'hôtel de faire lever le narrateur et sa grand-mère. Il lui était désagréable que des gens qu'il ne connaissait pas eussent pris sa table.
Le soir, à l'hôtel, les sources électriques faisant sourdre à flot la lumière dans la grande salle à manger, celle-ci devenait comme un immense et merveilleux aquarium devant la paroi de verre duquel la population ouvrière de Balbec, les pêcheurs et aussi les familles de petit-bourgeois, invisibles dans l'ombre, s'écrasaient au vitrage pour apercevoir, lentement balancée dans des remous d'or, la vie luxueuse de ces gens, aussi extraordinaire pour les pauvres que celle de poissons et de mollusques étranges. Le narrateur se posait de grandes questions sociales, de savoir si la paroi de verre protégerait toujours le festin des bêtes merveilleuses et si les gens obscurs qui regardaient avidement dans la nuit ne viendraient pas les cueillir dans leur aquarium et les manger. Le narrateur savait qu'il était bien loin d'être comme tous ces gens riches. Il aurait voulu ne pas être ignoré d'un homme au front déprimé et au regard fuyant lequel n'était autre que le beau-frère de Legrandin. C'était le grand seigneur de la contrée. Il donnait une garden-party hebdomadaire le dimanche. Cela dépeuplait l'hôtel d'une partie de ses habitants. D'ailleurs il ne connaissait pas les habitudes de l'hôtel car il avait ôté son chapeau dès la porte ce qui avait fait que le directeur n'avait même pas touché le sien pour lui répondre estimant que ce devait être quelqu'un de la plus humble extraction. Seule la femme du notaire s'était sentie attirée par lui. Elle avait reconnu dans ce gentilhomme-fermier à allure de sacristain les signes maçonniques de son propre cléricalisme.
Le narrateur pensait qu'il n'y avait rien que l'on cultivait si soigneusement dans la vie de Paris que les amitiés de bains de mer. Il se souciait de l'opinion que pouvaient avoir de lui les notabilités locales. Hélas, d'aucune de ces personnes le mépris ne lui était aussi pénible que celui de M. de star Stermaria. En effet, le narrateur avait remarqué la fille de Stermaria avec son joli visage pâle et son éducation aristocratique.
Le hasard mit tout d'un coup le moyen de donner au narrateur et à sa grand-mère, pour tous les habitants de l'hôtel un prestige immédiat. La grand-mère du narrateur avait excité chez tous une curiosité et un respect auxquels il fut visible qu'échappait moins que personne M. de Stermaria. Le narrateur avait l'impression de reconnaître parmi les inconnus de Balbec des physionomies ou des manières de parler des personnes qu'ils connaissaient à Paris. Ainsi, Mme Swann était devenue un maître baigneur avec sa physionomie habituelle et sa façon de parler. Il eut la chance de retrouver Mme de Villeparisis qu'il connaissait. Grâce à elle, il allait franchir en quelques instants les distances sociales infinies qui le séparaient de Mlle de Stermaria. Malheureusement, sa grand-mère avait l'habitude de vivre enfermée dans son univers particulier. Aussi, elle n'aurait pas compris son petit-fils si elle avait su qu'il attachait de l'importance à l'opinion de gens dont elle ne remarquait même pas l'existence. Sa grand-mère avait pour principe qu'en voyage on ne doit plus avoir de relations et qu'on ne doit pas aller au bord de la mer pour voir des gens. Elle ne voulait pas perdre son temps précieux voulant le passer tout entier au grand air. C'est pourquoi elle fit semblant de ne pas voir Mme de Villeparisis et cette dernière la regarda à son tour dans le vague.
Le narrateur supposait que Mlle de Stermaria était pauvre et cela la rapprochait de lui. Il espérait qu'elle voyait en lui non le rang insignifiant mais le sexe et l'âge. Il lui semblait qu'il ne l'aurait vraiment possédée que dans l'île où elle habitait.
Les repas du vaste restaurant du grand hôtel intimidaient le narrateur et davantage encore quand arrivait pour quelques jours le propriétaire de ce palace. Il apparaissait au commencement du dîner à l'entrée de la salle à manger. Il était petit avec des cheveux blancs, un nez rouge et il était d'une impassibilité et d'une correction extraordinaires. Il était connu pour un des premiers hôteliers de l'Europe. Devant les clients qui avaient une très grande importance, le directeur général de l'hôtel s'inclinait avec autant de froideur qu'avec le narrateur mais plus profondément comme s'il eut devant lui devant lui, à un enterrement, le père de la défunte ou le Saint-Sacrement.
Il se sentait évidemment plus que metteur en scène ou chef d'orchestre, véritable généralissime. Jugeant qu'une contemplation portée à son maximum d'intensité lui suffisait pour s'assurer que tout était très, il s'abstenait de tout geste. Quand le directeur général s'en allait, le narrateur respirait plus librement. Le narrateur se sentait triste dans cet hôtel car il n'y avait pas de relations alors que Françoise en avait noué de nombreuses. Les prolétaires avaient quelque peine à être traités en personnes de connaissances par Françoise et ils ne le pouvaient qu'à certaines conditions de grande politesse envers elle. En revanche, une fois qu'ils y étaient arrivés, c'était les seuls gens qui comptaient pour Françoise. Son vieux code lui enseignait qu'elle qu'elle n'était tenue à rien envers les amis de ses maîtres. Elle avait fait la connaissance du cafetier et d'une petite femme de chambre qui cousait des robes pour une dame belge et elle passait une heure avec eux après le déjeuner. La petite femme de chambre était orpheline et cette situation excitait la pitié de Françoise mais aussi son dédain bienveillant. Françoise avait de la famille, une petite maison et ne pouvait pas considérer cette femme de chambre comme son égale. Françoise s'était liée aussi avec un sommelier, un homme de la cuisine et une gouvernante d'étage. Aussi, elle n'osait plus sonner en assurant que ce serait mal vu parce que cela obligerait à rallumer pour nous ou gênerait le dîner des domestiques qui seraient mécontents. Mme de Villeparisis et la grand-mère du narrateur tombèrent un matin l'une sur l'autre dans une porte et furent obligées de s’aborder pour exécuter des protestations de politesse et de joie. La marquise prit l'habitude de venir tous les jours. Après le déjeuner fini, Françoise et le narrateur s'attardaient souvent à causer avec Mme de Villeparisis. Et, afin de garder, pour pouvoir aimer Balbec, l'idée qu'il était sur la pointe extrême de la terre, le narrateur s'efforçait de voir la mer et d'y chercher les effets décrits par Baudelaire.
Le maître d'hôtel, Aimé, voyant que Mme de Villeparisis avait retrouvé avec le narrateur et sa grand-mère d'anciennes relations sut se retirer à propos. De plus, il chérissait la noblesse. Françoise la chérissait davantage. Mais elle n'était pas de la race agréable et pleine de bonhomie dont Aimé faisait partie. Elle était fière. Pour Françoise, Mme de Villeparisis avait donc à se faire pardonner d'être noble. Elle avait un amour excessif pour le narrateur et sa grand-mère mais elle avait également plaisir à leur être désagréable. Elle constata les 1000 prévenances dont l'entourait Mme de Villeparisis et l'excusa d'être marquise et elle la préféra à toutes les personnes que fréquentaient le narrateur et sa grand-mère. Mme de Villeparisis, oubliant qu'elle avait aperçu la grand-mère du narrateur dans l'hôtel avant de la rencontrer dans cette porte, lui avait fait remarquer s'être rendu compte qu'elle lisait les lettres de Sévigné. Elle lui demanda si elle ne trouvait pas que c'était un peu exagéré ce souci constant que Mme de Sévigné avait pour sa fille. La grand-mère du narrateur trouva la discussion inutile. Mme de Villeparisis rencontrait Françoise au moment que celle-ci appelait « le midi millésimé. Elle l'arrêtait pour lui demander des nouvelles du narrateur et sa grand-mère. Françoise transmettait alors les commissions de la marquise. La grand-mère du narrateur se demandait si la marquise n'avait pas que quelque parenté avec des Guermantes. Le narrateur en fut indigné. Il ne voulait pas croire à une communauté d'origine entre eux deux noms qui étaient entrés en lui, l'un par la porte honteuse de l'expérience, l'autre par la porte d'or de l'imagination. Depuis quelques jours, la princesse de Luxembourg était en villégiature dans le pays. Elle offrit des fruits merveilleux à Mme de Villeparisis. Le lendemain, Mme de Villeparisis offrit les fruits au narrateur et à sa grand-mère. La princesse de Luxembourg fut présentée au narrateur et à sa grand-mère par Mme Villeparisis.
Quand la princesse de Luxembourg regarda le narrateur et sa grand-mère, avec de doux regards, dans son désir de ne pas avoir l'air de siéger dans une sphère supérieure, le narrateur vit approcher le moment où elle les flatterait de la main comme deux bêtes sympathiques qui auraient passé la tête vers elle, à travers un grillage, au Jardin d'acclimatation. Cette idée d'animaux prit plus de consistance pour le narrateur quand la princesse acheta du pain de seigle du genre de ceux qu'on jette aux canards, à un marchand sur la plage pour l'offrir au narrateur en lui demandant d'en offrir à sa grand-mère.
Le lendemain, Mme de Villeparisis apprit au narrateur et à sa grand-mère que la princesse les avait trouvés charmants. Mme Villeparisis demanda au narrateur s'il était le fils du directeur au ministère. Cela lui fut confirmé.
À l'hôtel, Mme de Luxembourg, nièce du roi d'Angleterre et de l'empereur d'Autriche, et Mme Villeparisis parurent toujours, quand la première venait chercher la seconde pour se promener en voiture, deux drôlesses.
Le narrateur eut un accès de fièvre, le médecin appelé conseilla des promenades. Alors Mme Villeparisis les invita dans sa calèche. Quand le narrateur attendait l'arrivée de la marquise, il regardait un jeune chasseur aux nuances précieuses et à la taille élancée et frêle. Après quoi, le narrateur partait avec sa grand-mère et la marquise dans une route campagnarde qui il lui devint bientôt aussi familière que celles de Combray. Mme de Villeparisis voyant que le narrateur aimait les églises lui promettait de l'emmener voir celle de Carqueville. Chopin et Liszt y avaient joué. Le narrateur et sa grand-mère furent étonnés de voir combien la marquise était plus « libérale » que même la plus grande partie de la bourgeoisie.
Mme Villeparisis exprimait avec franchise des opinions avancées mais pas jusqu'au socialisme qui était sa bête noire. Le narrateur l'avait interrogée sur Chateaubriand, sur Balzac, sur Victor Hugo. Mme Villeparisis répondit que ses parents les avaient tout reçus jadis et elle riait de l'admiration du narrateur pour ces écrivains.
Mme de Villeparisis lui raconta des traits piquants sur ces écrivains qu'elle jugeait sévèrement car ils avaient manqué de modestie et de modération à son avis. Elle rapporta que son père lui avait souvent dit que Stendhal était d'une vulgarité affreuse. Elle semblait penser que son jugement à l'égard de ces écrivains étaie plus juste que celui des jeunes gens qui n'avaient pas pu les fréquenter. Bloch avait ouvert l'esprit du narrateur en lui apprenant que quand il rêvait de prendre une paysanne dans ses bras cela était possible car selon lui toutes les filles qu'on rencontrait elles étaient toutes prêtes à exaucer de pareils rêves. À présent, le narrateur pouvait imaginer qu'il assouvissait ce rêve. Il était devenu curieux de l'âme des belles filles qui passaient. Quand la voiture de Mme de Villeparisis passait vite devant une fille qui avait fait rêver le narrateur, il lui arrivait de penser que s'il avait pu descendre, il aurait été désillusionné par quelque défaut de la peau de la fille qu'il n'aurait pas pu distinguer à cause de la vitesse. Un jour, le narrateur vit repasser sous ses yeux une laitière et pensait qu'elle aussi l'avait reconnu. Ayant reçu une lettre alors que personne ne le connaissait à Balbec, il croyait que c'était la laitière qui lui avait envoyé un mot. En réalité, c'était une lettre de Bergotte. Il en fut affreusement déçu. Pourtant, recevoir une lettre de l'écrivain était bien plus flatteur. Le narrateur pensait que ses rencontres avec des jeunes filles lui faisaient encore plus beau un monde qui faisait ainsi croître sur toutes les routes campagnardes des fleurs à la fois et singulières communes, trésors fugitifs de la journée, aubaines de la promenade, dont les circonstances contingentes qui ne se reproduiraient peut-être pas toujours lui avaient seules empêché de profiter et qui donnaient un goût nouveau à la vie.
Mme de Villeparisis emmena le narrateur et sa mère à Carqueville. Les deux femmes allèrent goûter chez le pâtissier pour que le narrateur puisse admirer seul l'église du village qui était recouverte de lierre. Il rencontre une jeune fille qui était en train de pêcher. Il aurait voulu atteindre son corps mais aussi sa personne. Il aurait voulu apercevoir sa propre image se refléter furtivement dans le miroir du regard de la jeune fille. Il aurait voulu que l'idée de lui qui entrerait en cet être, qui s'y accrocherait, n'amènerait pas à lui seulement son intention mais son admiration, son désir pour le forcer à garder son souvenir jusqu'au jour où le narrateur pourrait le retrouver. Il donna une pièce de cinq francs à la jeune fille et lui demanda s'il y avait bien une voiture qui l'attendait devant la pâtisserie du village. Il en profita pour dire que c'était la voiture de la marquise de Villeparisis. il espérait ainsi que la jeune fille prendrait une grande idée de lui. Il sentit que la pêcheuse se souviendrait de lui et il lui sembla qu'il venait de toucher sa personne avec des lèvres invisibles.
Mme de Villeparisis demanda à son cocher de prendre la vieille route de Balbec pour rentrer. Cette route était pareille à bien d'autres de ce genre qu'on rencontre en France, montant en pente assez raide, puis redescendant sur une grande longueur. Sur le moment, le narrateur ne lui trouva pas un grand charme, il était seulement content de rentrer. Mais par la suite, cette route devint pour lui une cause de joie en restant dans sa mémoire comme une amorce où toutes les routes semblables sur lesquelles il passerait plus tard au cours d'une promenade ou d'un voyage s’embrancherait aussitôt sans solution de continuité et ainsi communiqueraient immédiatement avec son coeur. Quand le narrateur voyait la lune sur le chemin du retour, il citait Hugo, Vigny ou Chateaubriand. Alors Mme de Villeparisis était encore une fois désobligeante à l'égard de ces grands écrivains. Elle reprochait aussi à Balzac d'avoir prétendu peindre une société où il n'était pas reçu et dont il avait raconté 1000 invraisemblances. Elle affirmait que Victor Hugo n'avait reçu le titre de grand poète qu'en vertu de son indulgence intéressée pour les dangereuses divagations des socialistes.
Quand le narrateur et sa grand-mère dînaient avec Mme de Villeparisis, la marquise se souvenait de son éducation et des façons aristocratiques avec lesquels une grande dame doit montrer à des bourgeois qu'elle est heureuse de se trouver avec eux et de n'afficher aucune morgue. On retrouvait alors ce pli professionnel d'une dame du faubourg Saint-Germain. Elle n'était pas naturelle et affichait des excès de politesse.
Le narrateur dit à sa grand-mère que les qualités de Mme de Villeparisis : le tact, la finesse, la discrétion, l'effacement de soi-même n'étaient peut-être pas bien précieuses. Sa grand-mère lui répondit qu'il devait au contraire rechercher ce genre de qualité à cause de son penchant maladif à la tristesse et l'isolement. De cette façon, il pourrait trouver une distraction et un apaisement. Elle ne voulait pas que son petit-fils subisse les souffrances de Baudelaire, d'Edgar Poe ou de Verlaine.
Le narrateur rencontra un homme grand et mince aux yeux pénétrants et aux cheveux dorés. C'était le marquis de Saint-Loup-en-Bray. Il était célèbre pour son élégance. Les plus jolies femmes du grand monde se l'étaient disputé. À cause de son extraordinaire beauté, certains lui trouvaient un air efféminé mais on savait combien il était viril et aimait passionnément les femmes. Il était le neveu de Mme de Villeparisis. Saint-Loup ne chercha pas à se rapprocher du narrateur ni de sa grand-mère. Le narrateur put sentir l'insolence et la dureté naturelle de Saint-Loup. Mme de Villeparisis ne put faire autrement que de présenter son neveu au narrateur quand ils se retrouvèrent dans un chemin étroit. Aucun muscle de son visage ne bougea. Pourtant il tendit la main au narrateur. Le lendemain il fit passer sa carte au narrateur. Ils passèrent plusieurs heures ensemble tous les jours pour parler de littérature. Saint-Loup témoigna de la sympathie pour le narrateur. Le narrateur se rendit compte que ce jeune homme était à la fois aimable et prévenant. Au bout de peu de temps, Saint-Loup devait laisser au narrateur voir un autre être bien différent de celui que l'on pouvait soupçonner. Saint-Loup avait l'air d'un aristocrate n'avait d'estime et de curiosité que pour les choses de l'esprit. Il passait des heures à étudier Nietzsche et Proudhon.
Il était le fils du comte de Marsantes. Mais Robert de Saint-Loup avait un souvenir un peu méprisant d'un père qui s'était occupé toute sa vie de chasse et de course et avait bâillé à Wagner et raffolé d'Offenbach. Saint-Loup ne comprenait pas pourquoi le narrateur n'était pas davantage sérieux. Dès les premiers jours, il fit la conquête de la grand-mère du narrateur grâce à son naturel.
La grand-mère du narrateur appréciait l'élégance de Saint-Loup. Elle retrouvait même le charme de ce naturel dans l'incapacité que Saint-Loup avait gardée de l'enfance d'empêcher son visage de refléter une émotion. Elle aimait également la sympathie que Saint-Loup manifestait pour son petit-fils. Le narrateur était triste et embarrassé de ne pouvoir répondre à l'amitié de Robert de Saint-Loup avec la même intensité. Quelquefois le narrateur se reprochait de prendre plaisir à considérer son ami comme une oeuvre d'art.
C'est parce qu'il était un gentilhomme que son activité mentale et ses aspirations socialistes faisaient rechercher à Saint-Loup de jeunes étudiants prétentieux. Se croyant l'héritier d'une caste ignorante et égoïste, il cherchait sincèrement à ce que ces étudiants lui pardonnent ses origines aristocratiques. Il était amené à faire des avances à des gens dont les parents du narrateur auraient été stupéfaits qu'il ne se détourne pas. Ainsi, un jour Saint-Loup et le narrateur entendirent sur la plage des propos antisémites. Ces propos étaient prononcés par un camarade du narrateur : Bloch. Saint-Loup demanda immédiatement au narrateur de rappeler à Bloch qu'ils s'étaient rencontrés au Concours général. Bloch était venu avec ses soeurs. Il y avait beaucoup de juifs à Balbec. Ils étaient toujours ensemble au casino ou au bal. Ils formaient un cortège homogène.
Bloch avait demandé au narrateur s'il était en train de traverser une jolie crise de snobisme parce qu'il fréquentait Saint-Loup. Le narrateur pensait que la bonté était le sentiment le plus répandu dans l'humanité. Selon lui, chacun de nos amis a tellement ses défauts que, pour continuer à l'aimer, nous sommes obligés d'essayer de nous consoler d'eux en pensant à son talent, sa bonté, sa tendresse. Malheureusement notre complaisante obstination à ne pas voir le défaut de notre ami est surpassée par celle qu'il met s’y adonner à cause de son aveuglement ou de celui qu'il prête aux autres. Le narrateur pensait également qu'il ne fallait jamais parler de soir parce que c'est un sujet ou on peut être sûr que la vue des autres et la nôtre propre ne concordent jamais.
Et à la mauvaise habitude de parler de soi et de ses défauts il faut ajouter, comme faisant bloc avec elle, cette autre de dénoncer chez les autres des défauts précisément analogues à ceux qu'on a. Ainsi Bloch était mal élevé, snob et, appartenant à une famille peu estimée, supportait les incalculables pressions que faisaient peser sur lui les chrétiens mais aussi les castes juives supérieures à la sienne. Alors le narrateur avait envie de lui répondre que s’il était snob, il ne le fréquenterait pas. Mais il lui dit seulement qu'il était peu aimable. De plus, il trouvait que la qualité de sa conversation était inégale. Il avait appris que Bloch avait dit à Robert Saint-Loup il trouvait le narrateur snob. Bloch n'en avait dit pas moins de Saint-Loup au narrateur. C'était Bloch lui-même qui avait avoué lui-même ses médisances aux deux amis.
Le narrateur tenait de sa mère et de sa grand-mère d'être incapable de rancune et de ne jamais condamner personne. Du reste, le narrateur préférait la société des hommes qui vous chérissent et s'attendrissent jusqu'à pleurer puis prennent leur revanche quelques heures plus tard en faisant une cruelle plaisanterie sur vous. Un jour, Bloch invita le narrateur et Saint-Loup chez son père. Il avait adressé cette invitation parce qu'il avait le désir de se lier plus étroitement avec Saint-Loup. Il formait ainsi le voeu que Saint-Loup le ferait pénétrer dans les milieux aristocratiques. Le père de Bloch après avoir entendu le nom du marquis de Saint-Loup- en-Bray avait éprouvé une commotion violente. Il avait jeté sur son fils, capable de s'être fait de telles relations, un regard admiratif. Bloch sentait que son père le traitait de dévoyé parce qu'il vivait dans l'admiration de Leconte de Lisle, Hérédia et autre « bohèmes ». Mais le dîner dut être reporté car Saint-Loup avait dû attendre un oncle qui allait venir passer 48 heures auprès de Mme de Villeparisis.
L’oncle Palamède se distinguait comme particulièrement difficile d'accès car dédaigneux et entiché de sa noblesse, formant, avec la femme de son frère et quelques autres personnes choisies, ce qu'on appelait le cercle des Phénix. Chez le comte de Paris il était connu sous le sobriquet du « Prince » à cause de son élégance et de sa fierté.
Dans sa jeunesse, un homme lui avait fait des propositions. L'oncle avait fait semblant de ne pas comprendre puis était revenu avec deux amis pour déshabiller le coupable et le frapper jusqu'au sang. En toutes circonstances, il faisait ce qui lui plaisait et il était imité aussitôt imité par les snobs.
Un jour, le narrateur croisa devant le casino un homme qui semblait attendre quelqu'un. Il crut que c'était un escroc d'hôtel qui préparait un mauvais coup. Cet homme était connu de la marquise de Villeparisis qui le présenta au narrateur.
C'était le baron de Charlus, l'oncle de Saint-Loup. Il n'adressa pas la parole au narrateur. Alors le narrateur demanda à Saint-Loup si c'était vrai que son oncle était un Guermantes comme l'avait dit Mme Villeparisis. Robert le lui confirma. C'était le frère du possesseur actuel du château. Ainsi s'apparentait aux Guermantes Mme de Villeparisis restée si longtemps pour le narrateur la dame qui lui avait donné une boîte de chocolat tenue par un canard quand il était petit, plus éloignée alors du côté de Guermantes que si elle avait été enfermée dans le côté de Méséglise. La marquise subit brusquement une hausse fantastique dans le coeur du narrateur. Robert expliqua au narrateur que sa tante était la nièce de Mme de Villeparisis. Son oncle avait choisi le titre de baron de Charlus par protestation et avec une apparente simplicité dans laquelle se trouvait beaucoup d'orgueil. Le narrateur demanda Robert si parmi les nombreuses maîtresses que son oncle avait eues ne se trouvait pas aussi Mme Swann. Robert voulut le convaincre du contraire. La grand-mère du narrateur fut enchantée de M. de Charlus car elle le trouvait intelligent et sensible. Elle lui avait pardonné aisément son préjugé aristocratique.
Avant de partir déjeuner chez la princesse de Luxembourg, Charlus annonça au narrateur qu'il prendrait le thé après-dîner dans l'appartement de la marquise de Villeparisis. Il espérait que le narrateur voudrait bien l'accompagner avec sa grand-mère. Le soir, le narrateur comprit que Charlus avait oublié l'invitation. Mais il sut donner le change en manifestant ouvertement de la joie devant la marquise de Villeparisis. Mme de Villeparisis pour plaire à son neveu parut soudain avoir trouvé à la grand-mère du narrateur de nouvelles qualités. Il voulut rappeler à M. Charlus que c'était lui qui les avait invités mais il ne répondit pas. Le narrateur crut voir flotter sur les lèvres de Charlus le sourire de ceux qui de très haut jugent les caractères et les éducations.
Durant la soirée, Charlus n'adressa pas la parole au narrateur mais seulement à sa grand-mère. Le narrateur avait remarqué que Charlus était bienveillant pour les femmes et avait à l'égard des hommes et particulièrement des jeunes gens une violence qui rappelait celle des misogynes pour les femmes. Il reprochait aux jeunes gens d'aujourd'hui d'être trop efféminés. Il n'admettait même pas qu'un homme porte une seule bague.
Mais ce parti pris de virilité ne l'empêchait pas d'avoir des qualités de sensibilité des plus fines. Ainsi, il accepta de décrire un château où avait séjourné Mme de Sévigné pour la grand-mère du narrateur. La grand-mère du narrateur trouvait à Monsieur de Charlus des délicatesses et une sensibilité féminines. Le narrateur et sa grand-mère se dirent plus tard que Monsieur de Charlus avait dû subir l'influence profonde d'une femme, peut-être sa mère. Le narrateur pensait plutôt à une maîtresse. Il pensait que les femmes avec lesquelles ils vivaient affinaient les hommes.
Charlus en voulait à la famille Israël d'avoir racheté une demeure qui avait appartenu aux Guermantes. Il estimait que cette famille devait être jetée en prison pour avoir détruit le parc de Lenôtre de cette demeure. Il estimait également que cette famille devait être jetée en prison pour beaucoup d'autres choses. La grand-mère du narrateur lui fit signe de monter se coucher et Robert avait fait allusion devant M. Charlus à la tristesse que le narrateur éprouvait souvent le soir avant de s'endormir. Il fut surpris que Charlus vienne le voir dans sa chambre. Il avait appris par Robert que le narrateur admirait les livres de Bergotte. Il était venu lui apporter un livre de Bergotte et le narrateur le remercia avec émotion. Le lendemain, Charlus retourna voir le narrateur quand il était dans son bain. Le narrateur fut étonné de l'entendre lui dire, en lui pinçant le cou, avec une familiarité et un rire vulgaires : « mais on s'en fiche bien de sa vieille grand-mère ? Hein ! ». Charlus lui conseilla de s'abstenir d'exprimer des sentiments trop naturels pour n'être pas sous-entendus et de ne pas partir en guerre pour répondre aux choses qu'on lui disait avant d'avoir pénétré leur signification. Puis il demanda de rendre le livre de Bergotte qu'il lui avait prêté la veille.
Une fois Monsieur de Charlus parti, le narrateur put se rendre chez Bloch avec Robert. C'est là qu'il comprit pendant cette petite fête que les histoires faussement trouvées drôles par son camarade étaient des histoires de son père. Le narrateur trouvait que Bloch père débitait des anecdotes saugrenues.
Le narrateur avait pu remarquer l'importance illusoire de M. Bloch père. Il avait aussi remarqué qu'il se permettait de juger les écrits de Bergotte sans les avoir lus. Pourtant ses enfants le considéraient comme un homme supérieur.
Bloch père étant dit que Bergotte ne serait plus aujourd'hui reçu dans son cercle. Tremblant d'avoir sous-estimé l'adversaire, Saint-Loup demanda si ce cercle était celui du jockey club. M. Bloch répondit non d'un air négligé, fier et honteux.. Bloch fils croyait savoir que Bergotte aller se présenter à l'Académie. Son père répondit que Bergotte n'avait pas un bagage suffisant. Sur ce point, l'oncle de Bloch père était d'avis différents. Alors Bloch père ne perdit plus une occasion d'invectiver son malheureux oncle. M. Nissim Bernard attristé inclina vers son assiette la barbe annelée du roi Sargon.
M. Bloch souffrait beaucoup des mensonges de son oncle et de tous les ennuis qu'ils lui causaient. Nissim Bernard dit à Saint-Loup qu’il avait bien connu son père. Alors M. Bloch conseilla à Saint-Loup de ne pas faire attention aux propos de son oncle. Alors l'oncle, blessé, arrêta brusquement son récit et resta muet jusqu'à la fin du dîner.
M. Bloch fit servir du vin mousseux qu'il affirma être du champagne et proposa à ses invités de se rendre au théâtre assurant qu'il avait réservé des fauteuils d'orchestre. En réalité, il avait fait prendre des parterres qui coûtaient moitié moins car il était avare. Dehors, Bloch demanda au narrateur quel était cet excellent fantoche en costume sombre qu'il avait vu son camarade promener l'avant-veille sur la plage. Saint-Loup, piqué, répondit que c'était son oncle. Bloch, loin de s'excuser, en rajouta et Robert fut furieux. Puis Bloch demanda au narrateur quelle était donc cette belle personne avec laquelle il avait rencontré son ami au jardin d'acclimatation et qui était accompagnée d'un monsieur et d'une jeune fille. Il voulait parler des Swann. Le narrateur en fut étonné. Bloch prétendit avoir passé un bon moment avec Mme Swann dans le train. Il voulait donc connaître son adresse. Il était sûr que Mme Swann était une professionnelle qui s'était donnée à lui trois fois de suite et de manière la plus raffinée.
Quelques jours plus tard, Bloch se rendit chez le narrateur mais le narrateur était absent. C'est Françoise qui l'avait reçu mais elle était incapable de dire au narrateur quel était le nom du visiteur. Par déduction, le narrateur devina qu'il s'agissait de Bloch. Françoise avait été déçue d'apprendre que Saint-Loup était républicain. Elle était monarchiste. Finalement elle se réconcilia avec Saint-Loup en se disant qu'il faisait semblant d'être républicain car cela devait l'arranger pour ses affaires. Saint-Loup avait un préjugé contre les gens qui le fréquentaient et il allait rarement dans le monde aristocratique. Robert avait pour maîtresse une femme de théâtre. Ses proches parents accusèrent cette liaison de lui être fatale. La maîtresse de Saint-Loup lui avait enseigné la pitié envers les animaux car elle en avait la passion. De plus, elle l'avait préservé du snobisme et guéri de la frivolité. Avec son instinct de femme et appréciant plus chez les hommes certaines qualités de sensibilité que son amant aurait sans elle méconnues, elle avait toujours vite fait de distinguer entre les autres celui des amis de Saint-Loup qui avait pour lui une affection vraie. Elle savait le forcer à éprouver pour celui-là de la reconnaissance. Bientôt Saint-Loup commença à se soucier des autres grâce à sa maîtresse. Elle avait mis du sérieux dans sa vie et des délicatesses dans son coeur. Puis elle avait commencé à trouver son amant bête et ridicule parce que les amis qu'elle avait parmi de jeunes auteurs et acteurs lui avaient assuré que Saint-Loup l'était. Elle le voyait le moins possible tout en reculant encore le moment d'une rupture définitive. Pourtant Saint-Loup faisait pour elle des sacrifices. Il semblait difficile qu'elle trouve un autre amant qui en consenti de semblables. Il s'était refusé à lui constituer un capital mais il avait emprunté beaucoup d'argent pour qu'elle ne manque de rien tout en ne lui remettant qu'au jour le jour. Cette période dramatique de leur liaison était arrivée maintenant à son point le plus aigu. Elle lui avait défendu de rester à Paris et l'avait forcé de prendre son congé à Balbec. Malgré tout, Saint loup avait obtenu d'elle qu'elle vienne chez une tante dire des fragments d'une pièce symboliste. Mais quand elle était apparue, un grand lys à la main dans un costume copié de l'«Ancilla Domini » son entrée avait été accueillie dans cette assemblée d'hommes de cercle et de duchesses par des fous rires. La tante de Saint-Loup avait été unanimement blâmée d'avoir laissé paraître chez elle une artiste aussi grotesque. L'actrice avait dit à son amant que parmi les hommes présents il n'y en avait pas un qui ne lui avait fait de l'oeil et c'est parce qu'elle les avait repoussés qu'ils avaient cherché à se venger. Cela avait changé l'antipathie de Robert pour les gens du monde en une horreur autrement plus profonde et douloureuse.
Robert passait la plus grande partie de son temps à envoyer à sa maîtresse des lettres car elle trouvait le moyen d'avoir une brouille avec lui à distance. Alors il lui demandait ce qu'il avait fait de mal et était prêt à reconnaître ses torts. Elle lui faisait attendre indéfiniment des réponses d'ailleurs dénuées de sens. Robert avait proposé à la grand-mère du narrateur de la photographier. Le narrateur avait été surpris que sa grand-mère affiche de la coquetterie. Françoise remarqua l'agacement du narrateur et s'empressa involontairement de l'accroître en lui tenant un discours sentimental sur sa maîtresse. La grand-mère s'apercevant que son petit-fils avait l'air ennuyé proposa de renoncer à la science de pose. Alors il l'assura qu'il n'y voyait aucun inconvénient et la laissa se faire belle. Il réussit du moins à faire disparaître de son visage cette expression joyeuse qui aurait dû le rendre heureux mais qui lui apparaissait comme la manifestation exaspérante d'un travers mesquin plutôt que comme la forme précieuse du bonheur. La mauvaise humeur du narrateur venait surtout que cette semaine-là sa grand-mère avait paru le fuir. Robert avait été obligé d'aller à Doncières. Alors le narrateur regardait seul les jeunes femmes sur la plage ou au casino. S'il devait bientôt mourir, il aurait aimé savoir comment elles étaient faites de près. Il ne se rendait pas compte qu'il y avait un désir de possession à l'origine de sa curiosité.
Son regard s'arrêta sur un groupe de jeunes filles qui longeaient la plage avec leurs bicyclettes. En les écoutant, il comprit qu'elles appartenaient à la population fréquentant les vélodromes et devaient être les jeunes maîtresses de coureurs cyclistes. Il n'avait aucune idée commune avec ces jeunes filles et il savait qu'il ne pourrait se lier avec elles et leur plaire.
Il n'avait jamais rien vu d'aussi beau. Ni parmi les actrices, où les paysannes, où les demoiselles de pensionnat religieux. Les jeunes filles de la plage de Balbec étaient imprégnées d'inconnu et d'inestimablement précieux mais aussi vraisemblablement inaccessible. Elles étaient un exemplaire si délicieux du bonheur inconnu et possible de la vie. C'était presque pour des raisons intellectuelles que le narrateur était désespéré de ne pas pouvoir faire l'expérience de ce que nous offre de plus mystérieux la beauté qu'on désire.
Le narrateur ne savait pas pourquoi il se disait dès le premier jour que le nom de Simonet devait être celui d'une des jeunes filles aperçues sur la plage. Il ne cessa plus de se demander comment il pourrait connaître la famille Simonet.
Il avait demandé à Aimé de lui livrer la liste des occupants. Aimé profita pour lui dire que Dreyfus était 1000 fois coupable. C'était un monsieur très lié dans l'état-major qui lui avait dit.
Sur la liste, le narrateur repéra le nom des Simonet. Il espérait que Robert l'aiderait à trouver Mlle Simonet. Malheureusement Robert devait retourner tous les jours à Doncières. De plus, Robert ne voulait pas s'intéresser à une jeune fille car à cause d'une sorte de croyance superstitieuse, il pensait que de sa propre fidélité pouvait dépendre celle de sa maîtresse.
Le narrateur se rendit à Rivebelle avec Robert et cela lui procurera l'excitation d'un plaisir nouveau. Dans ces moments-là, il n'avait plus peur de tomber malade et ne ressentait plus l'importance de travail. Il était un homme nouveau qui n'était plus le petit-fils de sa grand-mère. Il consommait plus d'alcool. Le restaurant de Rivebelle réunissait en un même moment plus de femmes au fond desquelles sollicitaient au narrateur des perspectives de bonheur que le hasard des promenades ou des voyages ne lui en eût fait rencontrer en une année. Il se sentait plus puissant et presque irrésistible. Il lui semblait que son amour avait précisément de la beauté touchante et la séduction de la musique qu'il pouvait entendre au restaurant. Le narrateur rencontra dans ce restaurant la belle princesse de Luxembourg. Ils se saluèrent. Le narrateur pensait que ce n'était pas l'allégresse du moment présent mais les sages réflexions du passé qui nous aident à préserver le futur. Mais à Rivebelle il ne voyait pas plus loin que la félicité de la minute présente. Il adhérait tout entier à l'odeur de la femme qui était à sa table voisine.
Il connaissait l'exaltation et tout le reste : parents, travail, plaisirs, jeunes filles de Balbec, ne pesait pas plus qu'un flocon d'écume dans un grand vent. Robert connaissait presque toutes les femmes de Rivebelle. Il n'y en avait guère qu’il n'eût connu pour avoir passé au moins une nuit avec elles. Mais il ne les saluait pas si elles étaient avec un homme. L'indifférence qu'on lui savait pour toute femme qui n'était pas son actrice lui donnait aux yeux des femmes de Rivebelle un prestige singulier. Le narrateur aurait voulu que Robert le présente à ces femmes et que celle-ci lui accordent un rendez-vous même si le narrateur n'aurait pas pu l'accepter.
Il se doutait que Robert se rappelait des cheveux défaits et de la bouche pâmée, des yeux mi-clos de toutes ces femmes.
Après une longue nuit de repos, le narrateur se rappela d'une jeune femme triste qu'il avait vue à Rivebelle. Il lui semblait qu'elle l’avait remarqué mais Robert ne la connaissait pas et croyait qu'elle était comme il faut. À présent, il était prêt à tout pour la retrouver. Il interrogea plusieurs clients de l'hôtel qui venaient presque tous les ans à Balbec au sujet des jeunes filles qu'il avait vues sur la plage. Ils ne purent le renseigner.
Le narrateur et Robert avait, deux ou trois fois, vu venir s'asseoir à une table en homme de grande taille et très musclé à la barbe grisonnante. Ils avaient demandé au patron qui était ce dîneur obscur. C'était le célèbre peintre Elstir. Swann avait une fois prononcé son nom devant le narrateur. Aussitôt passa sur le narrateur et sur Robert comme un frisson, la pensée qu'Elstir était un grand artiste et un homme célèbre. Alors ils lui écrivirent une lettre pour se présenter comme deux amateurs passionnés de son talent mais également comme amis de Swann.
L'artiste accepta de leur parler. Il proposa au narrateur d'aller le voir à son atelier de Balbec, invitation qu'il n'adressa pas à Robert.
Il prodigua pour le narrateur une amabilité qui était aussi supérieure à celle de Robert que celle-ci à l'affabilité d'un petit-bourgeois. Robert cherchait à plaire alors que le peintre aimait à se donner. Il aurait donné avec joie à quelqu'un qui l'eût compris. Mais faute d'une société supportable, il vivait dans un isolement que les gens du monde appelaient de la pose et de la mauvaise éducation et sa famille de l'égoïsme et de l'orgueil.
Le narrateur se promit d'aller à l'atelier de Elstir dans les deux ou trois jours suivants mais le lendemain, en accompagnant sa grand-mère tout au bout de la digue vers les falaises de Canapville, il croisa une jeune fille qui ressemblait à celle de la petite bande qui l'avait tant ému. Elle jeta dans sa direction un regard rapide ; les jours suivants, quand le narrateur revit la petite bande sur la plage, et même plus tard quand il connut toutes les jeunes filles qui la composaient, il n'eut jamais la certitude absolue que la jeune fille à la bicyclette était bien celle qu'il avait vue ce soir-là au bout de la plage. Le désir du narrateur se portait une fois sur l'une des jeunes filles, une fois plutôt sur l'autre. Le narrateur avait raconté son entrevue avec Elstir à sa grand-mère. Elle s'était réjouie de tout le profil intellectuel qu'il pouvait tirer de son amitié. Elle s'étonnait de l'élégance de son petit-fils car il s'était soudain souvenu de costumes qu'il avait jusqu'ici laissés au fond de sa malle. À présent, il en portait chaque jour un différent. Il prenait tous les prétextes pour aller sur la plage aux heures où il espérait pouvoir rencontrer les jeunes filles. Il les aimait toutes et leur rencontre possible était pour ses journées le seul élément délicieux qui faisait seul naître en lui de ces espoirs où on briserait tous les obstacles. Sa grand-mère lui témoigna un mépris qui lui sembla procéder de vues un peu étroites. Elle reprochait à son petit-fils de snober Elstir alors il finit par obéir avec d'autant plus d'ennui que le peintre habitait assez loin de la digue.
Le narrateur trouva la maison que le peintre louait très laide mais il se sentit parfaitement heureux en découvrant les oeuvres d'Elstir car il sentait la possibilité de s'élever à une connaissance poétique. C'était pour lui comme le laboratoire d'une sorte de nouvelle création du monde. Le peintre avait utilisé divers rectangles de tôles pour représenter une vague de la mer écrasant avec colère sur le sable son écume lilas. Les rares moments où l'on voit la nature telle qu'elle est, poétiquement, c'était de ceux-là qu'était faite l'oeuvre d'Elstir. Le peintre avait su habituer les yeux à ne pas reconnaître de frontière fixe, de démarcation absolue, entre la terre et l'océan. Dans un tableau pris de Balbec par une torride journée d'été, un rentrant de la mer semblait, enfermé dans des murailles de granit rose, n'être pas la mer, laquelle commençait plus loin.
Le narrateur se croyait bien loin des jeunes filles jusqu'à ce qu'il se rende jusqu'au fond de l'atelier, devant la fenêtre qui donnait derrière le jardin sur une étroite avenue. Tout à coup apparut la jeune cycliste de la petite bande avec, sur ses cheveux noirs, son polo abaissé vers ses grosses joues. Elle salua le peintre. Le narrateur demanda à Elstir il connaissait la jeune fille. Le peintre répondit qu'elle s'appelait Albertine Simonet. Il nomma aussi les autres amies de Simone que le narrateur lui avait décrites avec assez d'exactitude. Le narrateur avait situé dans un milieu interlope des filles d'une petite bourgeoisie du monde de l'industrie. En réalité, elles étaient des filles de bourgeois. Le peintre expliqua au narrateur qu'il n'y avait pas de jour qu'une ou l'autre d'entre elles ne passe devant l'atelier et n'rentre lui faire un bout de visite.
Alors le narrateur désespéra ainsi par la pensée que s'il avait été voir le peintre aussitôt que sa grand-mère lui avait demandé de le faire alors il aurait probablement depuis longtemps déjà fait la connaissance d'Albertine.
Elstir ne se suffisait plus à lui-même à présent car il n'était plus que l'intermédiaire nécessaire entre ces jeunes filles et le narrateur. Il voulut se rendre à la plage pour retrouver les jeunes filles avec le peintre mais ce dernier demanda au narrateur d'attendre qu'il ait terminé sa toile. Alors le narrateur passa le temps en regardant une toile qu’Elstir avait peinte en 1872. C'était une actrice travestie en homme. Il ne peut contenir son admiration. Il demanda au peintre était devenu le modèle. Le peintre parut étonné et demanda au narrateur de cacher la toile car sa femme arrivait et bien que la jeune personne représentée sur la toile n'avait joué aucun rôle dans sa vie, il était inutile que sa femme pût voir cette aquarelle.
Mme Elstir ne resta pas très longtemps. Le narrateur la trouva très ennuyeuse. Mais il réalisa que Mme Elstir était une créature immatérielle, un portrait exécuté par son mari. Puis le narrateur se rendit sur la digue avec Elstir. Ils rencontrèrent les jeunes filles. Il avait attendu que le peintre le présente aux jeunes filles. Et maintenant que ce moment était arrivé, il regrettait son désir et presque d'être sorti avec Elstir. Mais le peintre ne présenta pas le narrateur aux jeunes filles. Il se contenta de les saluer et de les laisser partir. Tout était manqué.
Ce jour-là, Albertine n'était pas apparue au narrateur la même que les précédentes fois. La croyance, puis l'évanouissement de la croyance, que le narrateur allait connaître Albertine avait rendu celle-ci presque insignifiante puis infiniment précieuse à ses yeux. Quelques années plus tard, la croyance, puis la disparition de la croyance qu'Albertine lui était fidèle, amènerait des changements analogues. Il dit à Elstir qu'il aurait été content de connaître les jeunes filles alors le peintre lui demanda pourquoi il était resté à des lieues. Elstir voulut offrir une esquisse au narrateur. Il répondit qu'il désirait avoir une photographie du petit portrait de Miss Sacripant. C'était en réalité un portrait d'Odette de Crécy. Le narrateur trouvait que ce portrait peu ressemblant et pourtant il y avait là un être qu'il sentait bien avoir déjà vu. Le narrateur pensait que le portrait d'Odette par Elstir était le contemporain d'un des nombreux portraits que Manet ou Whistler ont peint d'après tant de modèles disparus qui appartiennent déjà à l'oubli ou l'histoire.
Le narrateur se demanda si Elstir, cet homme de génie, ce solitaire, ce philosophe à la conversation magnifique et qui dominait toutes choses fût le peintre ridicule et pervers adopté jadis par les Verdurin. Alors il lui demanda s'il avait connu les Verdurin. Elstir reconnut avoir fait partie du clan. Le narrateur fut déçu. Le peintre s'en rendit compte. Il expliqua au narrateur qui n'existait d'homme, si sage qu'il soit, n'ayant mené une vie dont le souvenir lui était désagréable et qu'il souhaitait être aboli. Mais il ne fallait absolument pas regretter car cela permettait de passer par toutes les incarnations ridicules ou odieuses permettant de précéder la sagesse. L'apaisement apporté par la probabilité de connaître maintenant les jeunes filles quand il le voudrait fut d'autant plus précieux au narrateur qu'il n'aurait pu continuer à les guetter les jours suivants. En effet, il allait être pris par les préparatifs du départ de Saint-Loup. La grand-mère du narrateur, avez-vous lu le remercier des gentillesses qu'il avait eues pour elle et pour son petit-fils alors le narrateur lui donna l'idée de faire venir de nombreuses lettres autographes de Proudhon dont Robert était l'admirateur. Robert les lut avidement. Il fut pris d'une joie immense et devint écarlate comme un enfant quand la grand-mère du narrateur lui dit que ces lettres étaient pour lui.
Le narrateur était venu le raccompagner à la gare avec Bloch. Mais Robert ne souhaitait inviter à Doncièreq que le narrateur et surtout pas Bloch. Alors Robert employa un ton signifiant à Bloch qu'il était invité tout en lui conseillant de ne pas venir.
Le narrateur reçut une lettre de Robert qui lui annonçait la visite surprise de son amie. Robert voulait la présenter au narrateur. À ce moment-là, le narrateur influencé par Elstir essayait de trouver la beauté là où il ne s'était jamais figuré qu'elle fût, dans les choses les plus usuelles, dans la vie profonde des natures mortes. Quelques jours plus tard, Elstir donna une petite matinée où le narrateur put rencontrer Albertine.
Il connut le plaisir d'avoir rencontré Albertine qu'une fois rentré chez lui. Mais il ressentit tout de suite la gravité de cette présentation. Il fut étonné de l'entendre se servir de l'adverbe « parfaitement » au lieu de « tout à fait ». Pour le narrateur, cela indiquait un degré de civilisation et de culture auquel il n'aurait pu imaginer qu'atteigne la bacchante à bicyclette. Pour commencer, il trouvait Albertine assez intimidée et comme il faut alors qu'il l'avait trouvée mal élevée lors de sa première vision.
Une fois rentré chez lui, il repensa à cette matinée en revoyant l'éclair au café, qu'il avait fini de manger avant de se laisser conduire par Elstir auprès d'Albertine. Il repensa également à la Rose qu'il avait donnée au vieux monsieur. Il avait l'impression de voir ce tableau comme s'il n’avait existé que pour lui. Mais quelques mois plus tard, à son grand étonnement, Albertine se rappelait des mêmes détails de leur première rencontre. Il avait beau être assez désappointé d'avoir trouvé en Mlle Simonet une jeune fille trop peu différente de tout ce qu'il connaissait, le narrateur se disait qu'elle pourrait connaître ses amies de la petite bande de la plage. Il revit Albertine sur la plage et fut étonné par son ton rude et ses manières « petite bande ». Chaque fois que le narrateur passait quelques jours sans revoir Albertine, il s'exaltait en se répétant : « on ne vous voit jamais au golf », avec le ton nasal sur lequel Albertine avait prononcé cette phrase. Le narrateur pensait alors qu'il n'existait pas de personne plus désirable.
Le narrateur finit par immobiliser dans son souvenir le grain de beauté d'Albertine comme il avait pu immobiliser la fameuse phrase musicale de Vinteuil grâce à la partition. Le grain de beauté était sur la lèvre d'Albertine. Le groupe de jeunes filles s'approcha d'Albertine et du narrateur. Il aurait voulu les saluer. Malheureusement Albertine se contenta de leur faire bonjour de la main. Un jeune homme arriva. C'était le joueur de baccara dont les folies indignaient la femme du premier président. Il était le fils d'un très riche industriel.
Le narrateur fut frappé par la connaissance de tout ce qui était vêtements, manière de les porter, cigares, boissons anglaises, chevaux que ce jeune homme possédait dans ses moindres détails sans pour cela posséder la moindre culture intellectuelle. Cette disparité entre les deux cultures devait être la même chez son père, président du syndicat des propriétaires de Balbec. Le jeune homme s'appelait Octave. Pensant que s'il connaissait leurs amis, le narrateur aurait plus occasion de voir les jeunes filles, il aurait souhaité qu'Albertine lui présente Octave. Mais Albertine lui répondit qu'elle ne pouvait pas le présenter à un gigolo. Bloch croisa Albertine et le narrateur. Albertine demanda quel était son nom. Bloch annonça au narrateur qu'il allait voir Saint-Loup. Le narrateur ne souhaitait pas l'accompagner alors son ami s'en alla. Albertine le trouvait assez joli garçon et pourtant il la dégoûtait. Le narrateur n'avait jamais songé que Bloch pût être joli garçon. Mais il ne pouvait pas plaire à Albertine à cause des mauvais côtés de celle-ci, sa grossièreté et de l'insensibilité de la petite bande. D'ailleurs plus tard, quand le narrateur présenta Bloch a Albertine, l'antipathie d'Albertine ne diminua pas.
Quand Albertine apprit que Bloch était juif, elle s'écria : « je l'aurai parié que c'était un youpin ». Bloch continua de l'irriter car, comme beaucoup d'intellectuels, il ne pouvait pas dire simplement les choses simples. Le narrateur n'arrivait pas à savoir s'il était compris par Albertine. Essayer de se lier avec Albertine lui apparaissait comme une mise en contact avec l'inconnu sinon avec l'impossible. C'était un exercice aussi malaisé que dresser un cheval.
Le narrateur avait projeté une excursion avec Albertine et il s'était promis d'être plus hardi avec elle. Mais quand il se trouva de nouveau avec Albertine, il lui dit tout autre chose que ce qu'il avait projeté. Il était embarrassé devant certains de ses regards et de ses sourires. Il était hésitant comme un élève devant les difficultés d'une version grecque.
Albertine présenta une de ses amies, celle qui avait sauté par-dessus le premier président, Andrée. Cinq Messieurs passèrent devant eux. C'était le dentiste de Balbec, le maire de Balbec, le professeur de danse, le chef d'orchestre puis Octave. Le narrateur apprit qu'Octave était assez aimé par les Verdurin. Mais Octave parla avec dédain des fameux mercredis. Il ajouta que M. Verdurin ignorait l'usage du smoking. Puis ce fut le tour d'André qui n'adressa pas la parole au narrateur. Des jeunes filles, les demoiselles d'Ambresac passèrent. Le narrateur est Albertine les saluèrent.
C'était les filles d'une parente de Mme de Villeparisis. Elles avaient l'air d'appartenir à une autre humanité qu'Albertine. Albertine trouvait que le narrateur semblait aimer les petites oies blanches. Elle savait qu'une d'entre elles était fiancée au marquis de Saint-Loup. Albertine trouvait qu'elles s'habillaient et d'une manière ridicule surtout pour aller jouer au golf avec des robes de soie. Puis Albertine parla des robes de la femme d'Elstir. C'étaient des robes élégantes mais simples que le peintre faisait faire pour sa femme à des prix fous. Albertine avait fait un peu de peinture avec Elstir et il lui avait donné des notions. En réalité, bien que cela ne se voyait guère encore, Albertine était très intelligente Elstir avait eu sur elle une influence heureuse. Le narrateur ressentit tout à coup beaucoup de chagrin que Robert lui eût caché ses fiançailles et fît quelque chose d'aussi mal que se marier sans avoir rompu avec sa maîtresse. Quelques jours plus tard, le narrateur fut présenté à André. Deux jours plus tard, Elstir lui dit la sympathie très grande qu'Andrée avait pour lui. Albertine présenta au narrateur une autre de ses amis. C'étaient celle qui avait dit : « ce pauvre vieux, y m’fait de la peine », en parlant du premier président et que le narrateur avait trouvée si cruelle sur la plage.
Le narrateur se rappelait l'avoir vue souvent le soir se promenant sur la plage. Il pensait que c'était probablement avec l'espoir de le rencontrer. Elle s'appelait Gisèle. Elle parla des innombrables crasses qu'Andrée lui avait faites. Albertine se plaça obstinément entre Gisèle et le narrateur. Alors Gisèle s'en alla. Le narrateur reprocha à Albertine d'avoir était désagréable avec Gisèle. Albertine répondit que Gisèle devait apprendre à être plus discrète. Puis Albertine expliqua au narrateur que Gisèle n'était pas flirt du tout il posant que le narrateur devait aimer les jeunes filles flirt. Elle lui apprit que Gisèle devait rentrer à Paris pour ses examens. Elle en profita pour se plaindre d'un sujet qui était : « d'Alceste ou de Philinte, qui préféreriez-vous avoir comme ami ? ». Albertine pensait que les jeunes filles n'étaient pas censées avoir pour ami des Messieurs. Cette phrase, en lui montrant qu'il avait peu de chances d'être admis dans la petite bande, fit trembler le narrateur.
En rentrant à l'hôtel, le narrateur attendit le retour de sa grand-mère pour la supplier de le laisser aller faire dans des conditions inespérées une excursion. Il avait pour projet de retrouver Gisèle dans le train de Paris. Mais il échoua à cause d'un arrêt prolongé devant la barrière de la gare. Il n'avait pu rejoindre le train. Quelques jours plus tard, malgré le peu d'empressement qu'Albertine avait mis à présenter le narrateur à ses amies, il finit par connaître toute la petite bande. Bientôt, il passa toutes ses journées avec ces jeunes filles.
Il pouvait distinguer les points imperceptibles qui se révéleraient dans les visages des jeunes filles. Il comparait les futurs défauts physiques des jeunes filles au dreyfusisme, au cléricalisme, à l'héroïsme national tenus en réserve pour la circonstance et qui étaient prêts à entrer en scène. Le narrateur imaginait donc les jeunes filles en vieilles dames sur cette plage de Balbec. Il refusa les rendez-vous que lui opposèrent Mme de Villeparisis ou Robert pour rester uniquement avec les jeunes filles. Quand il pleuvait, le narrateur se rendait au casino avec les jeunes filles. Et il les aidait à jouer de mauvais tours au professeur de danse. Il se rendait compte qu'Andrée n'était pas dionysiaque mais au contraire frêle et intellectuelle. Il la trouvait plus affectueuse qu'Albertine. Andrée était extrêmement riche et faisait profiter de son luxe Albertine qui était pauvre et orpheline.
Elstir avait expliqué au narrateur qu'il avait tort de ne pas vouloir se rendre à l'hippodrome ou dans les régates car il aurait pu admirer comme lui les femmes d'une extrême élégance dans une lumière humide où l'on sentait monter dans le soleil même le froid pénétrant de l'eau. Avant de connaître Elstir, le narrateur s'était toujours efforcé, devant la mer, d'expulser du champ de sa vision les baigneurs, les yachts et tout ce qui l'empêchait de se persuader qu'il contemplait le flot immémorial qui déroulait déjà sa même vie mystérieuse avant l'apparition de l'espèce humaine. À présent, c'était le mauvais temps qui lui paraissait devenir quelque accident finesse et il désirait vivement aller retrouver dans la réalité ce qui l'exaltait si fort pour voir du haut de la falaise les mêmes ombres bleues que dans le tableau d'Elstir.
Souvent le narrateur rencontrait les soeurs de Bloch qu'il était obligé de saluer depuis qu'il avait dîné chez leur père. Ses amies de la plage ne les connaissaient pas car on ne leur permettait pas de jouer avec des israélites disait Albertine. À vrai dire les soeurs de Bloch ne produisait pas une impression excellente au narrateur à cause de leur air fastueux et souillon, à la fois trop habillées et à demi nues.
Le narrateur partait faire des pique-niques dans les fermes-restaurants du voisinage. Ses amies préféraient les sandwiches et s'étonnaient de le voir manger seulement un gâteau au chocolat ou une tarte à l'abricot. Il trouvait les gâteaux instruits et les tartes bavardes. Tandis que pour lui les sandwiches étaient et des nourritures ignorantes et nouvelles. Les gâteaux lui évoquaient Combray et Gilberte. Il repensait aux goûters qu'il partageait avec elle. Il repensait également à ces assiettes à petits fours des Mille et une nuits qui distrayaient sa tante Léonie quand Françoise lui apportait une assiette sur laquelle était représentée Aladin et la lampe merveilleuse ou Ali-Baba, ou encore Simbad le marin. Après avoir mangé, le narrateur jouait à des jeux auxquels il n'aurait pas renoncé pour un empire. Il admirait des jeunes filles, celles chez qui la chair comme une pâte précieuse travaille encore. Pour lui l'adolescence était antérieure à la solidification complète et de là venait qu'on éprouvait auprès des jeunes filles ce rafraîchissement que donne le spectacle des formes sans cesse en train de changer.
Robert ne comprenait pas pourquoi le narrateur le snobait. Mais ce dernier préférait sacrifier les plaisirs de la mondanité et de l'amitié pour passer tout le jour avec les jeunes filles dans la nature.
Avec les jeunes filles, le narrateur échangeait des paroles qui étaient peu intéressantes et rares. Mais cela ne l'empêchait pas de prendre du plaisir à les écouter et à les regarder. C'est avec délice qu'il écoutait leur pépiement. Il admirait ce gazouillis que les jeunes filles perdent aussitôt qu'elles deviennent des femmes. Le narrateur pensait que nos intentions étaient capables de contenir notre philosophie de la vie. Il pensait que les paroles des jeunes filles étaient également influencées par celles de leurs parents et aussi celle de leurs origines géographiques. Les gentilles attentions des jeunes filles éveillaient en lui d'amples vibrations. Ainsi un jour Albertine avait écrit sur un papier : « je vous aime bien ». Puis elle avait parlé à ses amies d'une lettre que Gisèle lui avait envoyée pour lui apprendre qu'elle avait obtenu un 14 au certificat d'études après avoir choisi un sujet difficile sur Sophocle et Racine.
Gisèle avait envoyé sa composition et Albertine l'avait lue à ses amies.
Andrée avait émis des critiques sur la composition de Gisèle. Albertine écouta Andrée avec attention et admiration. Pendant ce temps, le narrateur songeait à la petite feuille que lui avait passée Albertine : « je vous aime bien » et il se disait que c'était avec elle qu'il aurait son roman.
Le narrateur finit par jeter son dévolu sur Albertine, une après-midi où la petite bande jouait au furet. Ce jour-là, le narrateur regardait avec envie le voisin d'Albertine, un jeune homme, en se disant que s'il avait eu sa place, il aurait pu toucher les mains d'Albertine pendant des minutes inespérées. Il réussit à prendre la place du voisin d'Albertine mais il était trop timide et trop ému pour prendre les mains d'Albertine. Il ne sentait plus rien que le battement rapide et douloureux de son coeur. Finalement, le narrateur sentit une légère pression de la main d'Albertine contre la sienne. Elle lui adressa en même temps un clin d'oeil. Mais il se méprenait sur les intentions d'Albertine. Elle voulait simplement que le narrateur prenne la bague pour que le jeu puisse continuer.
Elle annonça à ses amies qu'il ne devait plus être invité les jours où la petite bande jouerait ou alors elle ne viendrait plus. Puis Andrée emmena le narrateur dans un endroit du bois appelé les Creuniers qu'il désirait voir. Durant le chemin, le narrateur fit l'éloge d'Albertine devant Andrée. Il espérait qu'Andrée répéterait ses paroles à Albertine. Mais Andrée ne fit jamais usage du moindre des riens dont elle avait la disposition pour unir le narrateur à Albertine. Le narrateur n'était plus certain de la sincérité des mille raffinements de bonté qu'Andrée avait manifestée. De plus, il pensait qu'Andrée manquait de tact. Le narrateur savait maintenant qu'il aimait Albertine. Quelques jours après la partie de furet, le narrateur trouva à Maineville deux petits « tonneaux « ils permirent à la petite bande de revenir pour l'heure du dîner. Il put ainsi rentrer avec Albertine. Il avait encore rien demandé à Albertine. Elle pouvait imaginer ce qu'il désirait et supposer qu'il ne tendait qu'à des relations sans but précis. Dans la semaine qui suivit, il ne chercha guère à voir Albertine et fit semblant de préférer Andrée. Il espérait ainsi accroître aux yeux d'Albertine son prestige. Il tâcha d'entrer en relation avec Mme Bontemps qui était pour quelques jours près de Balbec et chez qui Albertine devait bientôt aller passer trois jours. Afin d'effacer de l'esprit d'Andrée l'idée qu'il s'intéressait à Mme Bontemps, la tante d'Albertine, il ne parlait plus d’elle avec distraction mais avec malveillance. Il demanda à Elstir de parler de lui à Mme Bontemps et de la lui faire rencontrer. Le peintre s'étonna que le narrateur souhaite rencontrer cette femme qu'il trouvait méprisable, intrigante et aussi inintéressante qu'intéressée. Andrée était généralement en tiers dans les rendez-vous du narrateur avec Albertine. Environ un mois après le jour où le narrateur avait joué au furet, on lui dit qu'Albertine devait partir le lendemain matin chez sa tante et obligée de prendre le train de bonne heure, elle viendrait coucher la veille au Grand-Hôtel. Andrée voulut convaincre le narrateur que cela ne l'avancerait à rien de chercher à rencontrer Albertine quand elle serait à l'hôtel. Peu de temps après, Albertine et Octave vinrent rejoindre Andrée et le narrateur dans leur discussion. Albertine leur annonça que Mme de Villeparisis avait fait une réclamation auprès du père d'Octave et du maire de Balbec pour qu'on ne joue plus haut diabolo sur la digue. Puis le narrateur resta seul avec Albertine. Elle lui dit qu'elle arrangeait à présent ses cheveux comme il les aimait. Elle lui confirma qu'elle se rendrait au Grand-Hôtel avant de partir chez sa tante. Elle l'invita à venir la voir à son dîner à côté de son lit après quoi ils pourraient jouer à ce que le narrateur voudrait.
Alors, ce soir-là, il fit les quelques pas du palier à la chambre d'Albertine avec délice et prudence comme plongé dans un élément nouveau avec un sentiment inconnu de toute-puissance. Il trouva Albertine dans son lit. Elle avait défait ses cheveux et regarda le narrateur en souriant. Il voulut se pencher pour l'embrasser mais elle lui ordonna d'arrêter. Il voulut insister mais elle sonna de toutes ses forces.
Huit jours plus tard, à son retour de chez sa tante, Albertine dit au narrateur avec froideur qu'elle lui pardonnait mais lui demanda de ne jamais recommencer. Peu à peu le désir du narrateur pour Albertine cessa et sa curiosité intellectuelle de ce qu'Albertine pensait sur tel ou tel sujet ne survécut pas à la croyance qu'il pourrait l'embrasser. Alors il reporta son désir sur Andrée. Albertine ne raconta à personne l'échec que le narrateur avait essuyé auprès d'elle.
Albertine était de ces jeunes filles qui, dès leur extrême jeunesse, pour leur beauté ont plus davantage que des jeunes filles plus riches. Elle avait toujours été admirée devant ses camarades et le savait. S'il y avait une pavane à danser, on demandait Albertine plutôt qu'une jeune fille mieux née. N'ayant pas un sou en dot, elle était pourtant invitée à dîner chez des personnes qui aux yeux de la mère d'Andrée représentaient quelque chose d'énorme. Ainsi Albertine passait tous les ans quelques semaines dans la famille d'un agent de la Banque de France, président du conseil d'administration d'une grande compagnie de chemins de fer. Certes, à cause du milieu où tout cela évoluait, où l'argent joue un tel rôle, et où l'élégance vous fait inviter mais non épouser, aucun mariage « potable » ne semblait pouvoir être pour Albertine la conséquence utile de la considération si distinguée dont elle jouissait et qu'on n’eût pas trouvée compensatrice de sa pauvreté. Néanmoins le succès d'Albertine excitait l'envie de certaines mères méchantes. Si cette sorte de vogue qu'avait obtenue Albertine ne paraissait devoir comporter aucun résultat pratique, elle avait imprimé à l'amie d'Andrée le caractère distinctif des êtres qui, toujours recherchés, n'ont jamais besoin de s'offrir. Elle était même ennuyée de tellement plaire parce que cela l'obligeait à faire de la peine.
Ainsi, Albertine succombait au système des fins multiples. Par exemple, ayant un service à demander pour une de ses amies, elle allait pour cela voir une certaine dame. Mais, arrivée chez cette dame bonne et sympathique, Albertine, obéissant à son insu au principe de l'utilisation multiple d'une seule action, trouvait plus affectueux d'avoir l'air d'être venu seulement à cause du plaisir qu'elle avait senti qu'elle éprouverait à revoir cette dame. Elle craignait alors de faire douter la dame de sentiments en réalité sincères et repartait sans avoir demandé le service. Plaisant plus qu'elle ne voulait et n'ayant pas besoin de claironner ses succès, Albertine garda le silence sur la scène qu'elle avait eue avec le narrateur auprès de son lit. Pour se faire pardonner, Albertine offrit au narrateur un petit crayon d'or. Le narrateur lui dit qu'en lui donnant ce crayon, elle lui faisait un grand plaisir, moins grand pourtant que celui qu'il aurait eu si elle lui avait permis de l'embrasser. Elle répondit qu'elle se demandait-elle jeunes filles il avait pu connaître pour que sa conduite l’ait surpris. Elle ajouta que s'il tenait à son amitié, il pouvait être content car il fallait qu'elle l'aime joliment pour lui pardonner. Elle était persuadée que c'était Andrée qui lui plaisait.
Les paroles franches d'Albertine donnèrent au narrateur une grande estime pour son amie et lui causèrent une impression très douce et un noyau moral qui devait toujours subsister au milieu de son amour pour Albertine.
Andrée était trop intellectuelle, trop nerveuse, trop maladive, trop semblable au narrateur pour qu'il l'aime vraiment. Il avait cru trouver en elle une créature saine et primitive alors qu'elle n'était qu'un être cherchant la santé.
Le narrateur ne croyait plus à l'innocence des jeunes filles de la petite bande. Pendant les longues heures qu'il passait à causer, écouter, à jouer avec ces jeunes filles, il ne se souvenait même pas qu’elles étaient les mêmes vierges impitoyables et sensuelles qu'il avait vues défiler devant la mer. Mais les créatures surnaturelles qu'elles avaient été un instant pour lui, mettaient encore quelque merveilleux dans les rapports les plus banals qu'il avait avec elles ou plutôt préservaient ces rapports d'avoir jamais rien de banal. Puis le mauvais temps arriva et les jeunes filles quittèrent Balbec dans la même semaine. Albertine s'en alla la première. L'hôtel n'allait pas tarder à fermer et le chemin de fer d'intérêt local cessa de fonctionner jusqu'au printemps suivant. Les carrioles permettaient de conduire les voyageurs en attendant. Le narrateur demanda souvent à monter à côté du cocher et cela lui fit faire des promenades par tous les temps comme dans l'hiver qu'il avait passé à Combray. Le narrateur avait bien peu profité de Balbec, ce qui ne lui donnait que davantage le désir d'y revenir.
Le narrateur avait dû quitter Balbec à cause du froid et de l'humidité qui étaient devenus trop pénétrants pour rester plus longtemps dans cet hôtel dépourvu de cheminées.
Il oublia d'ailleurs presque immédiatement ces dernières semaines. Ce qu'il revit presque invariablement quand il pensa à Balbec, ce furent les moments où, chaque matin, pendant la belle saison, comme il devait l'après-midi sortir avec Albertine et ses amies, sa grand-mère, sur l'ordre des médecins, le força à rester couché dans l'obscurité. Il se souvenait que sur le mur qui faisait face à la fenêtre, un cylindre d'or que rien ne soutenait était verticalement posé et se déplaçait lentement comme la colonne lumineuse qui précédait les Hébreux dans le désert. Et quand Françoise tirait les rideaux, le jour d'été qu'elle découvrait semblait aussi mort et aussi immémorial qu'une somptueuse millénaire momie embaumée dans sa robe d'or.
