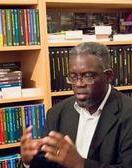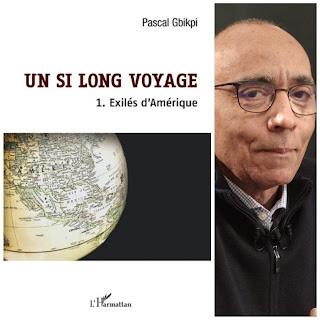
Certaines quêtes identitaires peuvent très riches et ne conduisent pas forcément à un repli sur soi. Bien au contraire, elles sont parfois l’occasion d’un travail sur soi, d’une meilleure compréhension de son rapport à l’autre en tenant compte de son histoire, de l’Histoire. Michel, le personnage de Pascal Gbikpi dans ce livre en deux volumes, va entreprendre une longue expédition d’abord en Amérique, puis en Afrique. Avec un angle d’attaque singulier : découvrir l’histoire des populations noires dans les villes, régions, états qu’il parcourt, que ce soit aux Etats-Unis ou à Cuba, en Bolivie ou en Haïti.
Je vous propose d’aborder le volet américain des pérégrinations de Michel. Le schéma de son parcours va être le suivant : le sud des Etats Unis, le Mexique, le Costa Rica, le Panama, la Colombie, l'Équateur, la Bolivie, le Brésil, Cuba, la Jamaïque, Haïti et les Antilles françaises. Avec un schéma qui va se répéter sur chacune de ces destinations : des villes administratives d’abord, puis des territoires plus symboliques liés aux vécus ou à la présence des populations afro-descendantes comme Montgomery en Alabama, la région du Choco en Colombie, la ville d’Esmeralda en Equateur ou Récife et Bahia de Salvador au Brésil. Michel arrive, pose ses bagages et il va à la découverte des points qui lui semblent importants. Il prend donc le temps de décrire le pays, la place des communautés afro-descendantes, l’histoire de leur présence dans le pays qu’il visite, il évoque les lieux de mémoire les concernant et mesure de manière récurrente leur impact sur le plan culturel (arts plastiques, littérature, musique), sur le plan spirituel, et sportif. Présenté comme cela, le propos de P. Gbikpi pourrait sembler caricatural. Et je reconnais volontiers avoir quelque peu été agacé, en début de lecture, par l'énumération des grands sportifs équatoriens, américains d'ascendance africaine. Mais ne vous méprenez pas sur ses intentions. En y réfléchissant, l'enfant que je fus, se souvient, pour ce qui concerne le football, au Mundial 82, de la composition très colorée d’une équipe comme celle du Pérou ou celle du Brésil (de manière plus arc-en-ciel), c’était les autres équipes « africaines ». On se pose très peu de questions sur l’histoire de ces joueurs de l’équipe de Colombie, de l’Equateur (l’an dernier) ou du buteur Campbell du Costa Rica. Cette présence physique rappelle l’existence de ces communautés afro-descendantes dont le sociologue Bastide parlait déjà dans son essai Les Amériques noires.
Projet colonial de peuplement
Les Amériques ont été des colonies de peuplement avec une approche extrêmement prédatrice et ambitieuse. Que ce fut les Portugais, les Espagnols, les Français, les Anglais ou les Néerlandais. Prendre la terre, souvent par la force, puis faire travailler les Amérindiens avant de les substituer par des captifs venus d’Afrique. Des empires entiers ont été soumis et détruits en Amérique centrale et en Amérique latine. Aztèques, Maya, Incas. Michel décrit ce contexte pour mieux signifier le commerce des esclaves, leur endurance, leur résilience et le fait qu’ils soient encore présents malgré tous ces tourments. En fonction des pays, entre trois et quatre siècles d’esclavage violent subis par ces communautes là où d’autres peuples ont vite fait de disparaître. Au dix-neuvième siècle, période de l’abolition de l’esclavage, en fonction des pays (1804 pour Haïti, 1838 pour la Jamaïque, 1886 pour Cuba), ces populations qui ne sont pas dédommagés (souvent ce sont les colons, les maîtres des plantations qui recevaient des compensations, pour le préjudice de ne plus pouvoir faire travailler des esclaves). La liberté est acquise, avec en parallèle, un phénomène d’étouffement de toute forme d’organisation de ces communautés. Pendant la période esclavagiste, les communautés de marrons sont traquées. Le cas de la Colombie et de la traque de ces communautés par les soldats espagnols est très intéressant . D’ailleurs, Michel va visiter une des plus célèbres de ces communautés, Saint Basile de Palenque où les survivances des langues d'Afrique centrale est remarquable.Les variations de l’esclavage en Amérique
Je parle pour moi. Dans mes lectures et mon imaginaire nourri de films hollywoodiens et de musique Soul et de blues, l’esclavage c’est avant tout l’exploitation du coton, de la canne à sucre, du café ou du tabac. Mais je crois que ce qui a le plus marqué ma lecture du parcours de Michel, c’est la Bolivie. Il faut comprendre qu’il s’agit d’une pays les plus hauts au monde qui, comme la République Démocratique du Congo, est un scandale géologique. L’exploitation dans les mines d’argent du Potosi est la situation qui m’a le plus horrifié. Pourtant, il n’en fait pas une description détaillée. Mais le simple fait de penser que la Bolivie fut une colonie espagnole, que le parcours des esclaves pour arriver aux mines du Potosi passait soit par le Panama, soit par Buenos Aires (et oui, la capitale d’Argentine fut à une certaine époque le premier port négrier d’Amérique latine, un comble pour un pays qui nie une présence noire dans son histoire, on peut parler de génocide). Représenter le chemin, les marches interminables de ces captifs africains pour atteindre la Bolivie vous donne une petite du calvaire vécu pour arriver. Puis les mines... Dans les Yungas, Michel a retrouvé des descendants de ces esclaves du Potosi.L’invisibilisation
C’est une constante. La démarche récurrente dans plusieurs pays des Amériques a consisté à rendre invisible ces communautés. Michel fait montre de beaucoup de volonté en rencontrant les Afro-boliviens des Yungas. Au Costa Rica, en Equateur, en Bolivie, il y a à peine une dizaine d’années que des gestes symboliques pour reconnaitre officiellement l’apport à la construction de ces pays des Afro-descendants. Dans ce contexte, l’auto-dénigrement de ces populations afro-américaines est une conséquence logique. Le niveau d’instruction est souvent faible et le discours sur l’Afrique est souvent dévalorisant. Le travail de celles et ceux qui détiennent le pouvoir économique et politique sur l’imaginaire est abouti. Michel n’a de cesse de questionner l’estime de soi, le rapport à l’histoire même de ces communautés, les résistances, les constructions. Avec le FIFDA et l’Afrique des idées, on a produit beaucoup de travaux sur le racisme au Brésil*. L’immigration massive européenne au début du 20è siècle au Brésil a longtemps eu pour but de neutraliser la présence noire au Brésil. Les stratégies varient au niveau des discours. Au Brésil, il n’y a officiellement pas de racisme, la nation est arc-en-ciel. Le métissage est vendu comme la norme. La réalité est toute autre. En Argentine, la question n’a jamais existé. Mais, et c’est là où la question de l’impact culturel africain est étonnant, le tango a survécu. Cette danse issue du milieu des esclaves rappellent le fait simple qu’un tiers de la population de Buenos Aires était noire. Ceci est une déduction, l’Argentine n’est pas une destination atteinte par Michel. La polémique argentine sur la sur-représentation des Noirs dans l’équipe de France avait quelque chose de croustillant quand je lisais ce Si long voyage.Les résistances / l’influence culturelle
Michel (ou Pascal) raconte aussi les faits de résistance. Que ce soit au Panama, au Brésil ou en Colombie, la question des marrons est souvent occultée. Je l’ai dit plus haut, il est passé par Saint Basile de Palenque. Au Panama, pendant plusieurs siècles des communautés de marrons ont survécu. Avant de disparaître avec la fin de l’esclavage. Il y a dans les sociétés esclavagistes, cette traque du marron. Je ne découvre pas le sujet avec Gbikpi. Le marron est présent dans le travail de Chamoiseau, de Depestre, de Whitehaed, d'Alem et bien d’autres. Le problème du marron, c’est qu’il n’a pas de voix. Les communautés se sont souvent développées du système éducatif dominant. Et quand il revient dans la communauté « nationale » il est un paria et son héritage souvent se dissout. Michel rappelle chaque fois l’influence culturelle. Il définit le rap, nous parle du rythme and blues pour le sud des Etats-unis. Quand on sait qu’aujourd’hui le hip hop américain est le courant musical le plus important de notre monde global. Marcus Garvey, ce jamaïcain qui fut extrêmement influent aux Etats Unis avait déjà fait un travail sur sa terre natale, en Amérique centrale comme au Costa Rica où l’African Hall qu’il a initié existe encore. Haïti incarne mieux que tout la rupture totale avec le système esclavagiste, en deux phases, avec la mythique défaite française à Vertières. L’indépendance qui suit est un événement dans le monde occidental, une douche froide pour Napoléon, sa première défaite militaire. Celle dont on ne parle pas. L’histoire retient Trafalgar. Le tribut a néanmoins été lourd à payer malgré une victoire militaire nette. Occupations successives par les troupes américaines.Mon point de vue
Comme je l’ai indiqué, il y a un côté répétitif dans ce premier volume. Un schéma qu’on retrouve dans chacune de ces « escales ». Il aurait gagné à échanger avec les populations rencontrées. Un dialogue, un partage sur l’expérience vécue des afrodescendant. Le regard de Michel fait penser à celui d'un touriste qui visite Manhattan avec le guide du routard. Sauf que, le guide du Routard ne fournit pas ce type d’itinéraires. Pascal Gbikpi a fait un choix et il m’a donné envie de visiter ces lieux. Ce livre souligne les nombreux ponts à établir entre le continent Africain et les Amériques. Un livre utile, très utile.Un si long voyage, volume 1, Exilés d'AmériqueÉditions L'Harmattan, 2022.
* J'ai été pendant huit ans responsable de la rubrique culture du think tank L'Afrique des idées.