
La crise financière, dont de nouvelles répercussions émergent chaque jour, peut surprendre par son ampleur – mondialisation de l’économie oblige – mais guère par ses origines. Les écrivains du XIXe siècle avaient déjà identifié le phénomène, mis à jour ses causes (la création de valeurs artificielles, le manque de contrôles, la cupidité) et décrit ses effets.
Médecins légistes de l’âme humaine, ils s’étaient livrés à une impitoyable autopsie littéraire des acteurs financiers de leur siècle. L’ère était aux spéculations ; la révolution industrielle, fondée au départ sur « l’économie réelle » (pour reprendre une expression contemporaine lourde de signification), se laissait progressivement absorber par les mirages boursiers, et si les termes « d’économie virtuelle » ou de « bulle » n’étaient pas encore entrés dans les mœurs, la situation qu’ils représentent existait déjà bel et bien.
Pour s’en convaincre, on peut, avec intérêt, lire La Maison Nucingen (Gallimard, collection Folio, 245 pages, 7,40€), roman de Balzac moins populaire que d’autres en raison de sa complexité, dans lequel l’auteur, dès 1838, se livre à une critique acerbe des excès d’un capitalisme en pleine expansion, personnalisé par le banquier Nucingen. Celui-ci, fin manœuvrier et sans scrupules, accroît sa fortune au moyen de fraudes et de spéculations ourdies au détriment de ses créanciers, en utilisant l’arme redoutable de la désinformation, sans être outre mesure inquiété. Dans ce texte sombre, Balzac fait dire, non sans cynisme, mais avec un sens aigu des réalités, à l’un de ses personnages, Emile Blondet :
A la même époque, le théâtre s’empara de la vogue spéculative, traitant ce thème sur un mode souvent plaisant. Les auteurs dénonçaient autant les aigrefins que les bons bourgeois mus par l’appât du gain facile, personnifiés par « Monsieur Gogo ». Le nom restera, synonyme de personne crédule, facile à tromper, de « pigeon ». M. Gogo se retrouve ainsi dans le Robert Macaire, de Saint-Amand et Frédéric Lemaître (1834), dans M. Gogo à la bourse, de Jean-François Bayard (1838). Paul de Kock immortalisera le même Gogo dans ses romans populaires. En 1857, Dumas-fils fera jouer La Question d’argent, pièce qui connut un certain succès au Théâtre du Gymnase, au point qu’il s’attira les protestations du célèbre Jules Mirès, banquier douteux, proche de Napoléon III, qui crut se reconnaitre dans le personnage de Jean Giraud.
Toutefois, c’est à Emile Zola que l’on devra le roman le plus intéressant et le plus complet sur la question boursière, L’Argent (Gallimard, collection Folio, 544 pages, 7,90 €). Avec la minutie d’un enquêteur, l’auteur reprend, de manière romancée, le krach de l’Union générale, banque catholique créée en 1878 qui s’effondra en 1882 (et qu’il nomme pour les besoins du livre la Banque universelle). Beaucoup des ingrédients que nous retrouvons disséminés çà et là dans la crise d’aujourd’hui y sont déjà réunis.
Dès la création de l’établissement financier, Saccard, homme d’affaires qui n’en est pas à sa première escroquerie, fait litière de la législation en vigueur avec une désinvolture d’autant plus belle que les contrôles sont quasi inexistants :
« Ah ! reprit-il avec un geste qui jetait bas les vains scrupules, si vous croyez que nous allons nous conformer aux chinoiseries du Code ! Mais nous ne pourrions faire deux pas, nous serions arrêtés par des entraves, à chaque enjambée, tandis que les autres, nos rivaux, nous devanceraient, à toutes jambes !… Non, non, je n’attendrai certainement pas que tout le capital soit souscrit ; je préfère, d’ailleurs, nous réserver des titres, et je trouverai un homme à nous auquel j’ouvrirai un compte, qui sera notre prête-nom enfin.—C’est défendu, déclara-t-elle simplement de sa belle voix grave.—Eh ! oui, c’est défendu, mais toutes les sociétés le font. »
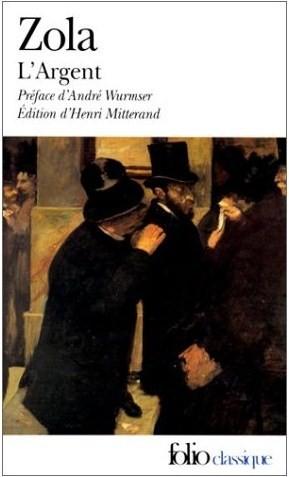
Une telle affaire ne pouvait être saine, et Zola en apporte des preuves accablantes. Afin d’attirer davantage de capitaux et de faire artificiellement grimper le cours des actions de la Banque universelle, Saccard n’hésite pas à procéder à des augmentations de capital (non libéré), tout en rachetant à l’occasion ses propres titres avec la complicité d’hommes de paille :
« La vérité était que trois mille actions environ, refusées par les premiers actionnaires à qui elles appartenaient de droit, restaient aux mains de la société, laquelle les passa de nouveau au compte Sabatani, par un jeu d’écritures. C’était l’ancienne irrégularité, aggravée, le système qui consistait à dissimuler dans les caisses de l’Universelle une certaine quantité de ses propres valeurs, une sorte de réserve de combat, qui lui permettait de spéculer […]. »
Il devient aussi le propriétaire de journaux financiers chargés de distiller publicités et articles louangeurs sur son projet ; il pratique à l’occasion le délit d’initié (au moment de Sadowa) et fait intervenir des politiciens en sa faveur. Une atmosphère d’euphorie moite se crée alors dans cette France prospère du Second Empire, dont Zola mesure avec lucidité les dangers :
« Le terrain était préparé, le terreau impérial, fait de débris en fermentation, chauffé des appétits exaspérés, extrêmement favorable à une de ces poussées folles de la spéculation, qui, toutes les dix à quinze années, obstruent et empoisonnent la Bourse, ne laissant après elles que des ruines et du sang. Déjà, les sociétés véreuses naissaient comme des champignons, les grandes compagnies poussaient aux aventures financières, une fièvre intense du jeu se déclarait, au milieu de la prospérité bruyante du règne, tout un éclat de plaisir et de luxe, dont la prochaine Exposition [universelle] promettait d’être la splendeur finale, la menteuse apothéose de féerie. Et, dans le vertige qui frappait la foule, parmi la bousculade des autres belles affaires s’offrant sur le trottoir, l’Universelle enfin se mettait en marche, en puissante machine destinée à tout affoler, à tout broyer, et que des mains violentes chauffaient sans mesure, jusqu’à l’explosion. […] Des humbles logis aux hôtels aristocratiques, de la loge des concierges au salon des duchesses, les têtes prenaient feu, l’engouement tournait à la foi aveugle, héroïque et batailleuse. On énumérait les grandes choses déjà faites par l’Universelle, les premiers succès foudroyants, les dividendes inespérés […]. »
Les affairistes professionnels sont épinglés au passage pour leur « brigandage financier », leur cynisme envers les apporteurs de capitaux, surtout les petits porteurs : « Se dégageait surtout leur dédain immense du public, le mépris de leur intelligence d’hommes d’affaires pour la noire ignorance du troupeau, prêt à croire tous les contes, tellement fermé aux opérations compliquées de la Bourse, que les raccrochages les plus éhontés allumaient les passants et faisaient pleuvoir les millions. » Comme Michel Audiard le faisait dire à Jean Gabin dans Le Gentleman d’Epsom, « la bourse est la nécropole des dots bourgeoises… »
La bulle escomptée naît, s’amplifie avec le temps dans un cadre où l’irrationnel l’emporte 
Dans son roman, Zola ne néglige aucune occasion de rebondissements, introduit des rivalités entre hommes d’affaires, des jalousies de femmes humiliées, les contours d’un scandale sexuel. Tous ces éléments aboutiront naturellement à l’explosion de la bulle et à un krach retentissant :
« La catastrophe de l’Universelle venait d’être une de ces terribles secousses qui ébranlent toute une ville. Rien n’était resté d’aplomb et solide, les crevasses gagnaient les maisons voisines, il y avait chaque jour de nouveaux écroulements. Les unes sur les autres, les banques s’effondraient, avec le fracas brusque des pans de murs demeurés debout après un incendie. Dans une muette consternation, on écoutait ces bruits de chute, on se demandait où s’arrêteraient les ruines. Elle, ce qui la frappait au cœur, c’était moins les banquiers, les sociétés, les hommes et les choses de la finance détruits, emportés dans la tourmente, que tous les pauvres gens, actionnaires, spéculateurs même, qu’elle avait connus et aimés, et qui étaient parmi les victimes. Après la défaite, elle comptait ses morts. »
L’actualité du livre frappe le lecteur qui y retrouve bien des similitudes avec la crise que nous traversons, même si ses effets ne touchaient alors que l’économie nationale. Il n’était, à cette époque de libéralisme économique, guère possible de compter sur le pouvoir régulateur de l’Etat. Les différents krachs montraient toutefois les limites d’un système sensé s’autoréguler et s’articuler autour d’un homo œconomicus par définition rationnel. La cupidité, voire le simple espoir de s’enrichir ou le goût du jeu, ne peuvent s’accommoder de rationalité ; et le facteur humain, dans sa diversité, représente bien ce « grain de sable » qui fait gripper le mécanisme le mieux construit. La crise de ce début de XXIe siècle, entre interventions des Etats et volonté de légiférer et de contrôler davantage le marché financier, semble asseoir la revanche des économistes keynésiens sur les libéraux et les néoclassiques. Toutefois, les acteurs économiques sauront-ils tirer les leçons de cette nouvelle crise ? Zola, à son époque, affichait à cet égard un certain pessimisme :
« Il faut des années pour que la confiance renaisse, pour que les grandes maisons de banque se reconstruisent, jusqu’au jour où, la passion du jeu ravivée peu à peu, flambant et recommençant l’aventure, amène une nouvelle crise, effondre tout, dans un nouveau désastre. Mais, cette fois, derrière cette fumée rousse de l’horizon, dans les lointains troubles de la ville, il y avait comme un grand craquement sourd, la fin prochaine d’un monde. »
Illustrations : La Bourse, vers 1833 (gravure) - La Bourse, vers 1860 (photographie)

