Emmanuel Carrère
« Limonov »
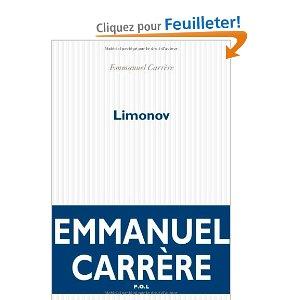
J’allais écrire, c’est un livre un peu curieux, intriguant ; mais j’écris plutôt : « c’est un drôle de choix... ce personnage principal » dont Carrère nous offre la biographie, ce Limonov.
C’est un type que l’on ne souhaiterait pas rencontrer, - et encore - dans la vraie vie, un personnage si controversé (violent jusqu’à la guerre, - dans les Balkans - conservateur borné jusqu’à idéaliser la vieille Russie de L’Urss, et même Staline, admirateur fou des leaders Serbes Karadzic et Milosévic), mais aussi un personnage si attachant, une sorte de héros pour les jeunes d’aujourd’hui en Russie, le chef d’un parti politique qui s’oppose à Poutine et aux nouveaux riches. Des jeunes années de Limonov, Carrère garde un souvenir étrange, une sorte de De Niro dans Taxi Driver.
Limonov était un modèle de la dissidence, de l’intransigeance, de la révolte ; je dirais, une tête brulée, un baroudeur, une sorte d’aventurier fou, tellement ce personnage de l’underground des années noires en Russie fascine, - tellement son ambition de vaincre la vie dans ce monde sordide du New York des années 80 était forte, tellement sa soif de vaincre la vie nulle et si peu reluisante qui lui échoit en Amérique lui fait accepter toutes les offres de s’en sortir (valet de chambre pour richissime homme d’affaire, enculé par des nègres à grosses bites, peu importe, tout est bon), tellement son roman à scandale « Le poète russe préfère les grands nègres », lui semble, à Carrère, d’un élan vital, cuir et coriace, qu’il envie, tellement ce Limonov non orthodoxe est sexé, rusé et marrant, tellement son sentiment étroit et chauvin pro-Russe lui fait traiter Soljenitsyne de vieux con, et réclamer pour Gorbatchev le peloton d’exécution, tellement, tellement, - il y a tellement de tellement que l’on en vient à croire que Carrère lui est vendu comme à dieu ou à diable – et son âme avec - et qu’il lui demande l’aumône d’écrire sa vie, ce que Limonov, après tout, trouve assez bizarre.
Cette petite phrase « Depuis combien de temps n’ai-je pas pensé à lui ? », et cette autre « Limonov était notre barbare, notre voyou : nous l’adorions » (eux les petits bourgeois français, sic Carrère, en 1968) m’ont intrigué, et m’ont fait me demander à quel point il ne lui était pas lié en pensée, en sentiment, en idéologie, bref, lié-attaché comme à un gourou, un quasi prêtre spirituel, et à quel point cela ne répondrait pas à un besoin psychologique fort chez Carrère, à une sorte d’idéal de vie ?
Alors ? Limonov n’est-il alors qu’une sorte de deuxième Carrère, un clone, un modèle ? Un type qu’il aurait voulu être, un phantasme, une sorte d’idéal qu’il n’atteindra jamais ? Alors, autant en parler, raconter sa vie, se faire une sorte de deuxième vie ainsi, se faire un double, un autre... qu’il ne sera jamais que par Limonov « interposé » ? Tel était peut-être le « projet » qui soustend ce livre.
Pourquoi pas ?
Écrire la biographie de Limonov est un choix que peu de ses amis partageaient : un choix ambigu. C’est aussi ce que je me dis après avoir lu quelques pages, je me demande bien où il veut en venir, je me demande bien où il arrivera en fin de texte. La petite phrase de Poutine, mise en exergue, n’est pas invitante, pour moi, j’entends ; elle me laisse perplexe. J’exècre Poutine. Mais je me dis, je fais confiance, j’ai lu de lui L’Adversaire et D’Autres vies que la mienne, des livres que j’ai appréciés, et de plus, l’incipit sur l’assassinat de la journaliste Anna Politkovskaïa, et surtout, les réactions des Français de Moscou qui sourient de commisération quand Carrère leur parle de la journaliste et des « supposés vertueux démocrates » qu’elle représentait, renforcent ma confiance dans le choix de Carrère. Je poursuis ma lecture.
Carrère s’appuie sur les textes de Limonov, ses romans, ses fictions puisque, comme il le dit, Limonov n’écrit pas de fiction, il n’écrit que sur lui, il se fantasme une vie, des vies, et vit ses fictions. Alors, réalité du personnage, réalité de ses écrits ? Mais voilà, il a une vie ( ?) passionnante, une vie qu’il fictive, et Carrère est médusé, disons conquis, enthousiasmé et impressionné à un point tel qu’il se lance vaillamment dans la recherche – entretiens, documents, rencontre de témoins - des « histoires de vie » de Limonov. C’est parti, il écrira, plutôt qu’un article, comme il avait été prévu, - c’était une commande d’un magazine - un livre de 489 pages.
Limonov, au moment où Carrère écrit ce livre, est un chef de parti, un parti de « révoltés » contre le cynisme qui est devenu la religion de la Russie nouvelle et capitaliste. Ses membres, les nasbols (nationalistes-bolcheviques) sont jeunes, délinquants souvent, marginaux, en mal de vivre, et vouent un véritable culte à leur héros.
Son histoire est controversée, on ne peut dire moins, mais Carrère croit qu’elle lui apprendra des choses sur notre histoire à tous ; « quelque chose, oui, mais quoi ? » Carrère commence ce livre pour l’apprendre. Cette remarque aussi m’intrigue... et je poursuis ma lecture ; je ne suis qu’à la page 35.
Je vois bien comme il entre dans la vie de cet homme ; il lit ses livres, questionne ses nasbols, s’entretient avec des gens de son entourage, discute avec ses amis... Les témoins et témoignages affluent tout au long de ce livre.
Un peu de la vie de Limonov
L’enfance de Limonov (prénom : Édouard), il est né en 1943, débute au moment de la défaite du Reich à Stalingrad : Staline, au prix de millions de morts, a vaincu les nazis – c’est un credo (sa foi en son pays, son principe de reconnaissance de la Russie soviétique) dans la vie de Limonov. Son père est un héros de la grande guerre patriotique, il l’admire. Sa mère lui apprend – suite à un épisode de vie dure - que « les hommes sont des lâches, des salauds, et qu’ils te tueront si tu ne te tiens pas prêt à frapper le premier ». C’est son deuxième credo. Ensemble, ils forment sa règle de vie). L’un et l’autre ne vont pas le quitter, ils lui apporteront joies et ennuis de toutes sortes ; et seront à la source de bien des aventures, des déclarations controversées et souvent des actes barbares, brutaux, indécents et amoraux.
Ainsi, pour Limonov, les prisonniers politiques en Urss sont des intellectuels pontifiants, ou des crétins. Les bandits, en revanche, sont des héros, « et particulièrement cette aristocratie du banditisme qu’on appelle vory v zakonié, les voleurs dans la loi ».
Limonov est aussi poète, il devient poète, un jour qu’il l’a décidé, gagnant un concours, et le prix qu’il convoitait. Quand il fait quelque chose, il le fait « bien », comme tout ce qu’il fait, c’est à dire, de son mieux, écrit Carrère. Il écrit bientôt un petit recueil qui le fera connaître et surtout, lui donnera « toute la plénitude de ce statut » de poète. C’est au cours d’une soirée avec des amis poètes qu’il décide de son nom, et qu’il adoptera ce nom de Limonov, « hommage à son humeur acide et belliqueuse, car limon signifie citron et limonka grenade – celle qui se dégoupille ». Ça lui plaît de ne devoir son nom qu’à lui- même.
Mais à 25 ans, Limonov voit bien que personne au monde ne sait qu’il existe, et que cela devrait changer. Mais cela va rester ainsi, - sa vie en Russie ; poète, membre de l’underground, subvenant à ses besoins matériels avec le métier de tailleur sur mesure, amant d’une femme magnifique et si belle, Elena, dont il est amoureux fou – jusqu’à ce qu’il quitte la Russie pour New-York, non sans avoir mal à la tête et à l’âme, comme tout bon Russe, puisque à cette époque, nous sommes en 1975, émigrer voulait dire émigrer pour de bon, sans espoir de retour.
Ses débuts en Amérique : ils (il est avec Elena) découvrent avec avidité un mode de vie, une imagerie si nouvelle – des enseignes lumineuses délirantes, des cireurs de chaussures noirs, des magasins de fringues en abondance et hors de prix... – que les premiers temps sont magnifiques ; d’autant plus qu’ils sont introduits dans la vie newyorquaise par des Russes qui sont bien établis et jouissent d’une réputation telle que Limonov et Elena croient fermement que les portes de la vie américaine, décontractée, libertaire, où chacun peut réussir, vont, grâce à leur influence, leur être ouvertes. C’est une amère déconvenue qui les attend. De plus leur vie de couple chancelle, et meurt définitivement. Elle le quitte, il se saoule au vin californien à 95 centimes le magnum, il ne peut que se masturber en pensant à elle. « Il est une merde, il vivra comme une merde ».
Il pleure longtemps, puis il se laisse consoler dans les bras d’un jeune noir « Baby, my baby, you are my baby... I am Eddy, dit Édouard, I have nobody in my life, will you love me » ? Puis, il n’a plus peur, pense-t-il, il s’est « fait enculer, c’est super. Molodiets !, comme dirait son père : bon petit gars ».
Dès lors, il se considère comme un homosexuel. Par principe, il est du côté des noirs, des arabes, des pédés, des clodos... il aime que Trotski déclare Vive la guerre civile, il méprise les vaincus, il abhorre Soljenitsyne, Brodsky, et Pasternak avec son Docteur Jivago, « cet hymne à la lâcheté de l’intelligentsia russe... ». Bref personne n’a sa considération, il en a contre tous... Il vivote jusqu’à ce qu’il devienne le serviteur d’un homme d’affaire richissime qui l’aime bien, Steven, que l’idée enchante d’avoir à son service un poète russe. C’est curieux, mais Limonov, qui voit pour la première fois un homme d’affaire si riche, ne le trouve pas du tout « cruel, suçant le sang des pauvres », comme on le dit en Urss de tout capitaliste, mais plutôt humain et civilisé. Malgré cela, Limonov se demande bien pourquoi lui, et pas moi. « À cette question, il n’y a qu’une réponse : la révolution. La vraie ». Ce travail ne va durer qu’un an, puis, sur des entrefaites un peu nébuleuses, Limonov apprend que son livre (il écrit sur ses expériences de vie à New York où il raconte tout, tout, tout ce qui lui est arrivé) va être publié à Paris, sous le titre Le poète russe préfère les grand nègres. Ainsi prend fin sa vie à New York (1975-1980).
Paris (1980-1989)
C’est cette partie du livre qui m’a intéressé le plus (à partir de la page 211), puisque c’est à ce moment que Carrère, enfin, se met en scène. Tous les livres de Carrère le mettent en scène, et c’est justement cette apostrophe que lui procurent les « sujets » qu’il a choisis qui rendent ses livres intéressants à mes yeux. Pourquoi ? je ne sais pas. Ce qui me semble évident, c’est que ça lui permet d’exorciser ses démons, et de comprendre mieux qui il est, et tout le tra la la : d’où il vient ? à quoi cela rime-t-il de vivre ainsi ? où il va ? ce qu’il ressent et pourquoi il le ressent ainsi ?... et tout cela, à partir de ce qu’il découvre (voit, analyse, comprend) dans le sujet qu’il a investi – là le faux médecin qui tuera sa famille, - là cette famille qui a perdu un enfant dans le Tsunami en Asie du Sud-Est, - là sa belle sœur qui meurt du cancer, et ici, cette biographie de Limonov.
Son incipit en cette partie du livre: « j’ai été un enfant sage, puis un adolescent trop cultivé ». Quand je lis cela, j’entends ceci : « la vie de Limonov lui offre une sorte d’exorcisme de ses vies qui l’ennuient, de cette sagesse trop instruite, trop cultivée ; il veut chasser ces désagréments, elle lui offre un exutoire, un dérivatif à sa vie si trop et toujours parfaite, me semble-t-il au fond, puisqu’il n’y a, dans sa vie sage, aucune aventure, aucun imprévu, aucune réussite particulière, que quelques saouleries pour se donner un peu de contenance, et des rêves de devenir un grand écrivain ». Comment conjurer son sort ? Comment épancher sa raison trop sage et trop étroite ? Comment comprendre la vie – la vivre aussi - au-delà de la musique classique et de ses articles critiques de cinéma ? Ces questions me semblent être son credo, et sa motivation principale pour écrire un livre sur Limonov. J’exagère sans doute.
Il est drôle, Carrère. Il aimerait se venger de ses échecs d’écrivain (à l’époque) ; sa mère est devenu célèbre avec son best seller L’Empire éclaté ; et comme critique de cinéma, il choisit d’écrire sur Herzog, un autre Limonov dans son imaginaire qu’il n’arrive pas à concrétiser, un autre aventurier qui avait traversé l’Europe à pied, une sorte de surhomme, puissant, physique, intense, encore un « autre » idéalisé et qui n’est pas lui. Mais tout ne marche pas très bien, son entrevue avec Herzog foire, et il y a ce copain qui lui reproche le choix de Herzog, un fasciste selon lui.
Mais Carrère n’en démord pas, il va écrire sur Limonov. Il réfléchit à la « réalité » de la vie de Limonov, celle qui semble invraisemblable, il a recours au discours de Nietzche pour enfin se dire que la réalité est ce qu’elle est et qu’il n’y a rien à faire. « Que dire d’autre ? Ce serait quoi, le contre-pied de cette évidence » ? écrit-il. Il a aussi recours à son ami Hervé Clerc, le « bouddhiste ordinaire », pour se convaincre que « l’homme qui se juge supérieur, inférieur ou égal à un autre ne comprend pas la réalité ». C’est là pour Carrère le sommet de la sagesse, là son regard unique en toutes circonstances. Cherche-t-il à assumer paradoxalement un choix plus que paradoxal ?
Mais revenons à son sujet, Limonov. Celui-ci, une fois à Paris, et heureux, rêve de devenir un écrivain célèbre, ou plutôt, un homme célèbre et riche, rien de moins ; mais il renâcle, ses livres se vendent, mais pas assez, « cet enculé de Brodsky vient d’avoir le prix Nobel », Soljenitsyne est toujours adulé comme écrivain révolté, et Gorbatchev, que Limonov exècre, mais que tout le monde aime – en Occident – vient de déclencher, malgré lui, un mouvement qui va faire éclater l’Urss.
On se rappelle, les gens de mon âge, l’importance de la Perestroïka et de la Glasnost.
Cette autre partie du livre de Carrère m’a ramené plus de 20 ans en arrière, au moment où nous suivions attentivement les évènements en Urss. C’était prévu, et je me rappelle bien ce que je me disais à l’époque : « si vraiment les Soviétiques vont vers la Glasnost, la transparence, ils ouvrent la boite de Pandore de l’information et de la connaissance vraies, de l’introspection, du savoir mémoriel authentique, ils vont faire éclater la boite qui s’appelle Urss ».
Je sais pourquoi je disais cela : je n’ai pas la science infuse ni aucune capacité de prédire... mais voilà, j’avais vécu une expérience importante à l’automne 1975 qui m’avait ouvert les yeux sur une réalité non moins importante chez l’être humain : laissez lui du temps, l’humain, du temps et des moyens pour qu’il puisse observer librement, le monde, le comprendre avec de vraies informations, se voir également dans ce monde, comprendre quelle place il occupe ou peut occuper, mais aussi en connaître les enjeux, etc... et il verra et comprendra dans quelle société il vit.
Cette expérience pourtant a été toute simple.
J’étais étudiant en Sociologie, (en 1975) et l’administration et le corps professoral de la Faculté avaient accordé aux étudiants « une semaine de réflexion libre », – pas de cours, que des séminaires, conférences et rencontres de réflexion sur la SOCIOLOGIE, des rencontres organisées autour de thèmes, - travail, éducation, santé, social... - avec des invités, des professeurs, des témoignages... et tout le tra la la – ce fut l’erreur (au sens où tout ne va pas aller comme prévu) des autorités de la faculté.
On avait accordé aux étudiants la Perestroïka (une nouvelle organisation – structure - de la première semaine à la fac) et la Glasnost (la transparence : on ouvre les livres, on donne la parole, on laisse libre la pensée, on laisse faire la réflexion, on délivre toute l’information...) en même temps. Je me rappelle bien toutes ces rencontres : la ferveur, l’intensité des débats, les remises en questions fondamentales des modes d’enseignements, et des buts de la formation de sociologue, et les controverses autour de la SOCIOLOGIE telle qu’elle se concevait, se pratiquait (ex : les fonctionnalistes vs les structuralistes et les marxistes). Il n’y avait qu’une issue possible : la GRÈVE. Grève de quoi ?
Voyons cette définition de la grève (dans le dictionnaire culturel en langue française) ? « Arrêt (d’une activité) pour revendiquer, attirer l’attention, protester » Une grève de la faim, ou une grève étudiante, c’est du pareil au même.
Mais une grève pour « quoi » dans ce cas-ci ? Brièvement, disons ceci : les étudiants et les professeurs avaient eu l’occasion au cours de la semaine de discuter de tout, - méthodes pédagogiques, contenu des enseignements, le métier de sociologue... – mais ils arrivaient à des conclusions aux antipodes les uns des autres. Bref, professeurs et étudiants aboutissaient à des mésententes profondes sur presque tous les sujets. En un mot, tout simple, les étudiants avaient les « yeux grand ouverts – même si naïvement - sur le monde de la sociologie et surtout, de l’enseignement et de la recherche sociologiques » et ces yeux étaient si critiques que la seule issue possible était la GRÈVE. Tout arrêter pour « revendiquer » de nouveaux cours, de nouveaux moyens pédagogiques, de nouveaux buts pour la SOCIOLOGIE, tout arrêter pour « protester » contre les refus répétés des prof-sociologues de changer quoi que ce soit, tout arrêter pour « attirer l’attention du public » sur cette grève authentique, pertinente et vraie qui s’appuyait sur une remise en question non seulement des cours mais aussi des privilèges, des pouvoirs, et des pratiques en trompe-l’oeil des académiciens et des praticiens sociologues. Pour les étudiants, un nouveau savoir et de nouvelles pratiques devaient émerger et être reconnus. C’en était trop pour les autorités de la faculté qui répondirent NIET aux demandes des étudiants.
La grève dura 2 ½ mois, d’autres facultés étaient aussi entré en grève, mais rien n’y fit : la session des étudiants fut en partie perdue, des changements furent apportés aux formes et contenus des cours – pour une seule année - et ne furent pas renouvelés. La grève en a laissé quelques-uns amers, d’autres fiers. J’étais de ceux-là ; nous nous étions battus, nous avions obtenu des modifications de cours et de pédagogie, nous avions obtenu une certaine reconnaissance de notre mouvement dans le public, je me rappelle que nous avions été invités au 20 heures de Radio Canada, ce qui n’est pas peu, et nous avions compris quelque chose qui est resté ancré dans ma mémoire depuis. « Si tu veux quelque chose, tu comprends d’abord de quoi il est question et tu définis ce que tu veux ; tu te grouilles le cul, tu le revendiques, tu vas au bout de tes convictions ; et pour y arriver, tu t’assembles avec d’autres qui partagent tes objectifs et les moyens d’y arriver ; ensemble vous mettez le paquet ». Le résultat n’est pas toujours celui attendu, mais autrement à quoi cela sert-il de vivre « soumis » à un ordre qui te déplaît ? J’en conviens, je revendique une position « anarchiste » fondamentale.
J’ai eu une autre aventure du même genre quelques années plus tard. Mais cette fois-là, j’étais prof de Sociologie dans une université québécoise et, lors d’un séminaire dit « d’immersion » dans notre programme de « Maîtrise en développement régional », j’avais, moi, donné aux étudiants la liberté, le droit, et l’opportunité de « prendre la parole ». Ce séminaire leur donnait l’occasion toute simple de s’immerger dans ce programme en le « discutant » au préalable : revue des cours, des méthodes... et tout cela, dans un « cadre champêtre ». Et oui, j’avais choisi, l’occasion était rare et ne se répéta plus, d’amener les étudiants dans une région du Québec, à l’époque dite sous-développée, appelée le JAL. Une région rurale-forestière que l’on appelle péjorativement, une région « reculée », une région « arriérée culturellement » (voir texte des objectifs du BAEQ), bref, « l’arrière-pays. (l’une des revendications de ces populations, un jour, a été de demander que l’on désigne dorénavant leur région comme le « haut-pays », du fait de sa situation géographique, sur les hauteurs de ce pays d’en arrière ; l’appellation était plus décente). J’avais un petit budget pour ce séminaire, et je l’ai entièrement utilisé pour assurer aux 20 étudiants le gîte (en camping) et le couvert (des sandwiches). À la dure quoi... pour une semaine.
Le JAL (regroupement de 3 villages, population totale 1,200 habitants) menaient depuis quelques années des opérations de « survie » et de « développement coopératif » mais aussi de « confrontation » du type des opérations menées au Larzac à la même époque. Le gouvernement avait décidé (sic) la fermeture de ces villages. La population avait décidé que NON, on ne fermerait pas leurs villages, le mouvement de refus et de lutte s’était donné un nom combien mythique quand j’y repense : « Opération Dignité ». Il n’est pas innocent de dire que ce mouvement de lutte dans le Larzac était connu des Québécois de ces régions appelés à disparaître, et que leurs opérations de « contestation » de l’ordre gouvernemental établi, (les plans du BAEQ, et ses effets collatéraux : disparition des bureaux de postes, des écoles ; fermeture de routes...) et de l’ordre capitaliste habituel (la petite épicerie fermait, la station service fermait, les jeunes quittaient pour aller chercher du travail en ville...) empruntaient de loin à ce mouvement Larzacien.
Les étudiants avaient compris en une semaine ce qu’étaient, - à l’époque, et même aujourd’hui encore – les enjeux du « développement régional » ; ils l’ont compris surtout parce qu’ils ont côtoyé ces gens du JAL, les ont questionnés, ont participé à toutes leurs rencontres, - ces gens s’assemblaient presque chaque soir - ont visité tous leurs projets coopératifs (érablière, culture de la pomme de terre, productions d’huiles essentielles à partir des branches de sapin...). Bref, ils se sont immergés dans le développement régional.
Résultat : à leur retour à l’université la semaine suivante, ils se sont mis en GRÈVE. Je l’avais bien cherché ; mes collègues aussi m’ont rendu responsable de ce mouvement de protestation. Ils demandaient quoi, ces étudiants en grève ? Simple, ils avaient dès les premiers cours compris que ces cours ne servaient pas à répondre adéquatement aux questions qu’ils s’étaient posées au cours de ce séminaire en brousse, et surtout, aux « attentes de ces gens du JAL » qui voulaient développer leur région et qui leur avaient montré les véritables enjeux d’un tel « développement régional ». Cette grève aussi s’est terminée sans que quelque changement fondamental soit apporté à notre programme de Maîtrise en développement régional. Mais l’issue, « comprendre mieux, voir clair, être sensibilisé aux problèmes de survie des régions périphériques », celle atteinte, était réelle et avait marqué cette cohorte d’étudiants. Le sujet est trop important pour que j’aille plus loin dans ce petit article.
Et je reviens à ce que j’écrivais plus haut : il n’y avait qu’une issue possible à cette Perestroïka et Glasnost de Gorbatchev : la GRÈVE. Oui, les Russes et tous les autres citoyens des pays de l’Urss se sont mis en grève : ils ont « revendiqué, protesté et attiré l’attention d’un public international (toutes petites chandelles allumées, chaque soir, dans la rue) » et ils ont gagné une nouvelle société.
Carrère donne un résumé bien présenté – les rappels sont fraîchement montrés, on a toujours besoin de rappels, et j’ai apprécié sa présentation - de toutes les péripéties de ce mouvement qui a emporté, éclaté l’Urss, fait même disparaître les partis communistes. Il contextualise bien la place de son héros dans tout ce charivari ? Et surtout il présente bien les enjeux d’un socialisme soviétique intégral qui visait avant tout à faire disparaître le réel, mieux, la mémoire authentique de ce réel, afin de construire une autre mémoire, celle d’un monde surréel, où la vérité n’existe pas autrement que dans la religion du parti unique. Gorbatchev a voulu combler les blancs de l’histoire, rappeler les non-dits des petites histoires des gens (ainsi ceux-là qui disparaissaient en une nuit, au Goulag ou morts assassinés), et faire en sorte que la véritable histoire de l’Urss s’assume. Il ne voulait pas briser le modèle, il voulait qu’il s’assume mieux ; mais ce modèle était trop retors, il avait failli à sa grande mission d’égalité des droits et d’équité du partage des ressources, il avait même failli à sa visée démocratique du pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. C’en était fait de l’Urss quand ses habitants ont été libérés d’une histoire inventée, qu’ils se sont emparés da la parole qu’on leur avait donnée, et qu’ils se sont donnés une histoire nouvelle (la fin de l’histoire, disait l’autre ?) et réelle.
Je me dis : le droit de grève est sans doute le droit le plus démocratique qui existe et aussi le plus essentiel, et il l’est s’il s’exerce sans contraintes qui viennent lui enlever ou le brimer ou l’escorter et l’encadrer autoritairement avec des balises, lois, règles de toutes sortes qui lui enlèvent sa « raison d’être ». Le droit du travail ne « bonifie » pas, ne reconnaît pas, cette réserve que je pose, au contraire. La seule règle que ce droit de grève puisse accepter, à mon point de vue, est « éthique » ; oui, une éthique éclairée, responsable, collective, est la seule balise possible à l’exercice du droit de grève. Le droit du travail en fait fie quand il organise et permet le travail des « jaunes » (les scabs) avec mille et une circonvolutions, ou encore lorsqu’il a inventé le « service minimal » obligatoire.
Je reviens à Limonov, à ce héros, - le temps d’un livre – de Carrère. J’ai peu ou peine à dire davantage que ce que je n’ai fait jusqu’à maintenant, tellement le héros ne m’est d’aucun intérêt, ni d’aucune sensibilité, d’aucune sorte.
Je rappelle ici une anecdote. Limonov est dans le train, il vit maintenant en Russie (1989) en écrivain célèbre, un inconnu assis près de lui lit son livre Top Secret et lui raconte – il ne reconnaît pas Limonov - une des histoires de ce livre. In extenso, voici ce passage du livre de Carrère (en fait du livre de Limonov) : « Dans un village comme ceux qu’ils traversent, une bonne femme pour punir sa fille de dix ans l’a enchaînée dehors, par moins trente, et elle a tellement gelé qu’il a fallu l’amputer des bras et des jambes. Dès qu’on a ramené à la maison ce qui restait de la gamine, un tronc, le compagnon de la mère s’est dépêché de la violer et elle a accouché d’un petit garçon qu’on a enchaîné à son tour ». Voilà, je ne peux aller plus loin... dans ce registre.
La suite du livre (à partir de la page 291) m’a accroché.
Pourquoi ? Pour les même raisons que j’ai aimé le chapitre sur Gorbatchev : le rappel historique de Carrère sur d’autres événements qui ont suivi le démembrement de l’Urss. Ceausescu (le couple qui va mourir comme des amoureux ? Carrère est troublé), Radovan Karadzic, Milosévic, et d’autres du même acabit, apparaissent dans le récit. Remis en mémoire au fil des 150 dernières pages du livre, les événements tragiques de l’assassinat des Ceausescu, la libération (destruction totale) de Vukovar par les Serbes, (il a oublié les terribles événements de Srebrenica), la ville de Sarajevo assiégée, les tergiversations et l’aveuglement, il faut bien le dire, de Gorbatchev (malgré les suppliques de Sakharov pour qu’il supprime le parti), le putsch manqué à Moscou des militaires et la réponse de Eltsine, juché sur un char attaquant la Maison Blanche, le soutien « stupide » de Mitterrand, « prince des esprits subtils » (sic Carrère) aux putschistes, la fin de l’Union soviétique (Eltsine et Bush se sont mis d’accord, au téléphone), la fin des holdings des oligarques sous Poutine (alors que ce sont eux qui l’ont mis au pouvoir ; ils s’en mordent les doigts), le coup d’État au sein de la République serbe de Krajina, le retour grandiose à Moscou de Soljenitsyne mais qui ne suscite qu’indifférence,...
...et évidemment la grande aventure « politique » de Limonov de retour dans sa Russie et la création de son parti « national-bolchévique » qui sera bientôt interdit par Poutine. Il s’agit bien d’une aventure et elle est plus que rocambolesque. Limonov est un aventurier, un guerrier, prêt à tuer, - il s’en vante, et il joue à l’homme de guerre-meurtrier aux côtés des Serbes – il attire les jeunes qui en ont ras-le-bol des méthodes de Poutine et de tous ceux qui ont pris le pouvoir économique en Russie, on les appelle les Nasbols, et ils sont prêts à suivre leur chef partout, et jusqu’à la mort (ce qui arrive pour quelques-uns d’entre eux), jusqu’au jour où des hommes des forces spéciales font irruption dans la cabane où Limonov et quelques Nasbols s’étaient retirés aux confins de l’Altaï, pour réfléchir à leur action, et viennent l’arrêter. « Ils sont une bonne trentaine, cagoulés, mitraillettes à la hanche, retenant les chiens-loups qui font un raffut d’enfer ». Toute sa vie, écrit Carrère, Limonov a rêvé de cela, être arrêté à la Monte Cristo. Sauf qu’il ne va pas s’évader. En prison Limonov écrira quatre livres, dont son meilleur aux yeux de Carrère, Le livre des eaux. Accusé de menace sérieuse pour la sécurité du pays, - en prison il est vu comme un type bien, il se tient tranquille – il ne fera pas son temps, il sera libéré, il atteindra le « nirvana » - rien de moins - (cette partie du livre de Carrère, et sa réflexion sur le bouddhisme de son ami Hervé Clair, que je ne partage pas, me laissent assez indifférent) et il croit (je ne suis pas certain si ce n’est pas Carrère qui le croit, tellement il reconnaît chez Poutine un sentiment « sincère » quand il s’agit de remémorer le communisme d’antan) que Poutine est un grand homme d’état; on oublierait ses meurtres au théâtre russe de la Doubrovka (150), et au collège de Beslan (350 enfants), rien de moins.
Maintenant que me reste-t-il à écrire sur ce personnage, et sur Emmanuel Carrère?
Il y a eu des périodes où, écrit Carrère, il a douté de son héros, douté de son livre - il l’a déjà laissé en suspens pendant un an au moment où son héros s’était compromis stupidement avec les Serbes mitraillant lui-même Sarajevo – et eu peur de se fourvoyer.
Mais il a des arguments qui le rassurent. Il a rencontré Olga Matitch, une Russe blanche qui enseigne la littérature russe à Berkeley, qui a connu Limonov quand il était aux Etats-Unis et qui lui porte une affection et une estime indéfectibles. La personne est de confiance, Carrère la croit. Il sait que c’est une impression mais, comme il le dit « je m’y fie ».
Son deuxième argument en faveur de Limonov, si je puis m’exprimer ainsi, c’est lorsqu’il considère les écrits de Limonov quand il était en prison, « ce plus haut moment de sa vie, celui où il a été le plus près d’être ce qu’il s’est toujours vaillamment, avec un entêtement d’enfant, efforcé d’être : un héros, un homme vraiment grand ». Dans ces livres, contrairement à ses premiers textes, écrit Carrère, « il parle beaucoup moins de lui-même que des autres. Lui, le narcisse, l’égotiste, on le voit s’oublier, oublier de prendre la pose et s’intéresser sincèrement aux affaires qui ont valu à ses compagnons d’être là où ils sont ».
Son troisième argument, c’est sa conversion, - les mots de Carrère se dérobent pour raconter ce qui suit – une conversion inopinée : un jour, un instant ordinaire dans la vie de Limonov, celui-ci voit que tout s’arrête, lui, et autour de lui. « Le temps, l’espace : pourtant ce n’est pas la mort... rien de ce qui l’entoure n’a changé d’aspect... il est aspiré par un vide plus plein que tout ce qui au monde est plein... Il n’est plus nulle part et il est complètement là. Il n’existe plus et il n’a jamais été à ce point vivant ». Il aurait atteint le nirvana. Clerc dit de cela que c’est comme un rapt, une transe, une extase : « congédiés, le désir et l’angoisse qui sont le fond de la vie d’homme ». Limonov assure alors qu’il ne retournera pas aux émotions de l’homme ordinaire ? Peut-on le croire ?
Je prends pour réponse... cette fille qui lui a juré fidélité, « je t’attendrai toujours », cette petite fille, elle a 20 ans, Nastia, et pour laquelle Limonov a écrit ce livre Le livre des eaux, - son meilleur texte, dit Carrère – qu’advient-il d’elle quand Limonov sort de prison ? Il disait rêver d’elle et de la retrouver au plus vite. NON, à peine sortie de prison, « il plaque la vaillante petite Nastia pour sauter sur une de ces femmes de catégorie A auxquelles il n’a jamais su résister : cette ravissante actrice rendue célèbre par un feuilleton appelé Le KGB en smoking ».
Voilà, moi, « je m’y fie moins » à cet homme idéalisé par Carrère.
Mais je comprends que tout cela, ses arguments, le mien, est un peu faible. Je comprends également que Emmanuel Carrère a souvent rêvé d’être un autre, et bizarrement, sans doute d’être un type comme Limonov, une sorte d’aventurier de l’au-delà, imaginaire, peu crédible nul doute parce que si controversé, si ambigu, si malsain parfois, agissant contre toute éthique, mais bien réel dans la vie. Limonov a bel et bien existé, cette biographie le rappelle. Mais entre le ventre de sa mère et l’instant final, Limonov aura-t-il atteint un degré de maturité plus grand que celui auquel il est arrivé, et une certaine paix de l’âme qui le rassureront et qu’ils lui feront dire qu’il a accompli quelque chose ?
Perplexe ? Oui, je le suis. Je ne suis pas certain que beaucoup de lecteurs aient approuvé le choix de Carrère. Mais ce n’est peut-être pas si important. Lui-même doit se dépatouiller avec son sujet, son héros. Mais il a écrit un livre de valeur encore une fois, un livre où, c’est un fait rare en littérature, il se met à nu, je crois qu’il excelle dans cette ligne, il a ainsi créé son genre littéraire, et ainsi, il se découvre, – lui, l’homme, l’humain, l’écrivain - un peu plus à chacun de ses livres.
Un dernier mot...
Le vocabulaire, les mots, que Carrère emprunte à Limonov et qu’il nous rapporte tout au long de ce livre (empruntés à ses livres, ou entendus lors de leurs entretiens) est souvent sordide, et cela me choque, m’agresse, plus souvent qu’autrement ; pourquoi aime-t-il tant ré-utiliser ces gros mots ?
Là-dessus Carrère questionne peu son approche, sa langue, ses mots, ni même le personnage, il émet au plus quelques doutes. Le projet d’écrire ainsi sur la vie de Limonov a quelque chose d’un article de journal qui s’est allongé; le style est journalistique, cela a été souligné par plusieurs critiques littéraires, même si la plupart d’entre eux ont encensé ce texte) et pas assez celui d’un écrivain.
Pourtant, c’est plus compliqué que cela, j’aime ce style qui nous fait plonger dans une sorte d’épopée de légende qui voudrait célébrer un grand homme ; mais l’homme est plutôt un voyou et Carrère a parfois l’air de l’oublier, ou de se le cacher. Pourquoi ?
Ce que le livre révèle, on le sent ainsi, c’est un lien entre les deux hommes qui plonge à un degré assez stupéfiant de confidence. Pourquoi se sont-ils si bien entendus ? On le sent, l’élève-Carrère semble fasciné par le maître-Limonov, il est excité par sa faconde, son exubérance triviale, son goût pour la vie dure, l’action aux cent mille volts. Il questionne peu son goût pour la guerre, et le comprend ainsi...
(Lors d’une entrevue à Les Inrocks) « Il aime ça profondément. Dans les moments où il me touche, j’ai l’impression de voir quelqu’un d’obstinément et courageusement fidèle à un rêve de petit garçon chétif qui se faisait casser la gueule à la récré et qui se disait "plus tard, ils vivront une vie de péquenauds et moi je mènerai une vie d’aventurier et je les niquerai, et je serai un caïd, et j’irai en taule, et je les épaterai tous par mon courage en taule ».
Parfois Carrère m’a semblé être ce petit garçon chétif qui cherche auprès de son héros une force qu’il n’a pas, un destin qu’il envie. C’est peut-être trop simple dit comme ça.
Comme j’ai confiance en la critique de Pierre Assouline (je me suis bien gardé de le lire avant que ne n’écrive cet article...) je présente ici son intro.
Limonov, une vie de merde
"Il faut vraiment qu’un livre soit signé Emmanuel Carrère, que le lecteur soit sous le coup de l’excellent souvenir de L’Adversaire, de Roman russe, d’Autres vies que la mienne et qu’il soit encore imprégné de sa manière d’osciller entre récit, roman et reportage jusqu’à créer son propre genre, pour vaincre sa réticence à aller au-delà d’une épigraphe signée Vladimir Poutine. Il est vrai que celle-ci n’est pas mal. Ou plutôt qu’elle tombe à pic : « Celui qui veut restaurer le communisme n’a pas de tête. Celui qui ne le regrette pas n’a pas de cœur ». On ne saurait mieux annoncer l’esprit de Limonov (487 pages, 20 euros, P.O.L.), l’un des meilleurs livres de la rentrée, tout simplement. Question style, ça ressemble à un texte de la revue XXI. Et pour cause : ça vient de là. Le point de départ. Le miracle est que cela tienne sur près de cinq cents pages, qu’il n’y ait jamais de baisse de rythme et que l’intérêt ne faiblisse pas sur la longueur et la durée. Chapeau ! C’est qu’Emmanuel Carrère nous raconte une histoire pleine d’histoires. Par moments, on se surprend non plus à le lire mais à l’écouter, comme cela a pu être le cas autrefois lorsqu’on se faisait balader par les livres de Ryszard Kapuscinski ou de Hunter S. Thomson". (Pierre Assouline)
