Jeanette Winterson

« Pourquoi être heureux quand on peut être normal ? »
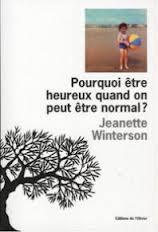
Chapitre 1: "Le mauvais berceau"
« Quand ma mère se fâchait contre moi, ce qui lui arrivait souvent, elle disait : le Diable nous a dirigé vers le mauvais berceau ».
Un incipit étonnant, qui nous introduit au cœur du sujet du livre. Jeanette Winterson va nous raconter cette relation bizarre avec une mère qui ne l’aimait pas. Ce n’est pas simple de raconter son histoire, sa vie, cela demande une capacité d’introspection que peu de gens possèdent. Comment s’y prend-elle ?
Elle l’a d’abord fait dans un premier livre, une sorte d’autofiction, « Les oranges ne sont pas les seuls fruits », qui raconte l’histoire d’une petite fille adoptée par des pentecôtistes qui veulent en faire une missionnaire.
Mais dans ce deuxième livre sur sa vie, cette fois-ci, il s’agit de sa vraie vie, elle est directe : « J’ai lutté à mains nues quasiment toute ma vie. Dans ce genre de combat, le vainqueur est celui qui frappe le plus fort. Ayant été battue dans mon enfance, j’ai appris très tôt à ne pas pleurer. Si je passais une nuit enfermée dehors, je m’asseyais sur le pas de la porte jusqu’à l’arrivée du laitier, je buvais les deux pintes qu’il nous livrait, abandonnais là les deux bouteilles vides pour faire enrager ma mère (une femme corpulente, plutôt grande, qui devait peser autour de 120 kilos, on imagine le corps, l’âme) et partais pour l’école ».
Pourquoi avait-elle opté d’abord pour la fiction ? Elle confrontait alors, par l’écriture, sa version de sa vie avec celle que sa mère (adoptive) lui faisait vivre, ou lui racontait de sa vie. Pour elle, écrit-elle, ce récit fictif fut son mode de survie. Enfant adoptée, elle s’inventait une vie qu’elle n’avait pas eue, une vie qui avait commencé sans elle. Elle avait été absente d’une partie de sa vie. Dès le départ, sa vie est un point d’interrogation, une histoire qui a commencé avant elle, sans elle ; elle a été adoptée, mais l’avait été sans que l’on ne lui demande son avis – pour sûr – alors elle écrit : « Imaginez un livre dont il manquerait les premières pages ». Cette sensation de manque, - ces premières pages - du manque d’un pan de vie qui lui a échappé, l’a marquée pour le reste de sa vie, jusqu’à aujourd’hui, et ne lui a jamais laissé un instant de répit. Voilà, dit-elle, pourquoi elle est devenue écrivaine, et pourquoi elle a écrit cette légende que sont Les oranges.
Elle aurait aimé être aimée de ses parents, mais ce ne fut pas le cas, voilà qui explique qu’elle aime écrire obsessionnellement sur l’amour – sa valeur suprême, écrit-elle – voilà aussi qui explique qu’elle n’avait aucune idée de ce que l’amour était. Et surtout de l’amour des gens. Elle aimait dieu et dieu sans doute l’aimait, elle aimait la nature, et sans doute la nature le lui rendait bien, mais l’amour des gens...
Mais pouvait-elle aimer, ou plus simplement, peut-elle aimer ? Est-il possible que cette capacité, celle d’aimer, soit brisée chez une personne ? Est-il possible que quelqu’un (sa mère ?), des institutions, des événements (terribles !), ou quoi d’autre, puissent tuer en quelqu’un, SA capacité à aimer ? Je dois revenir sur cette question.
Alors... ce livre aujourd’hui ? Qu’en est-il ?
Il raconte une histoire, la sienne, avec des mots qui traduisent des silences – elle ose les dire alors qu’avant elle les taisait – mais des mots sans doute qui laissent encore des silences, des espaces ouverts. À nous de lire ce qui n’a pas été écrit, ainsi à propos de ces douleurs ressenties qui n’ont pu être décrites parce que cela ne se dit pas. Mais elle a dit tant de mots que ces mots peuvent apaiser cette âme à la recherche d’amour – peut-on dire, de bonheur – et sans doute aussi apporter une compensation « face à un monde déloyal, injuste, incompréhensible, hors de contrôle (c’est sa vision du monde) ».
« La vérité est une chose très complexe pour tout un chacun. Pour un écrivain, ce que l’on retranche en dit autant que ce que l’on intègre... En écrivant, on offre le silence autant que l’histoire. Les mots sont la part du silence qui peut être exprimée ».
Voilà, je n’en suis qu’à la page 18 de ce livre ; l’histoire de Jeanette Winterson est ainsi lancée. Qu’y découvrirai-je ?
Chapitre 2: "Mon conseil à tous: venez au monde"
Elle est née à Manchester, au milieu d’usines gigantesques qui fonctionnaient à la vapeur, de rangées de maisons serrées les unes contre les autres, dans la crasse, la fumée, et le travail d’humains « mal fagotés, épuisés, ivres et malades » ; oui, c’est là que Jeanette Winterson a cherché le bonheur, une denrée insaisissable, dit-elle, mais qui seule peut donner un sens à une vie. Elle le raconte ainsi quand elle dit : « Ce que je désire existe si j’ose le trouver », alors qu’elle a une mère adoptive qui n’aime pas la vie et pour qui l’univers est une poubelle cosmique.
Chapitre 3 : « Au commencement était le mot »
Madame W, comme elle appelle sa belle-mère, disait d’elle : « Elle est un péché contre le ciel, un péché contre les morts et contre la nature ».
Comment interpréter le propos de cette belle-mère ? Comment interpréter cette notion de « péché » ? Une souillure, une tache, un bout d’excrément ? Allez savoir, c’est le mot qui trouble, qui fait mal, qui exécute. Le mot qui asphyxie Jeanette Winterson. Le péché, au sens le plus simple, est une faute, et celle-ci est pardonnable, mais l’on doit s’en confesser, se faire pardonner... accepter la pénitence. Sa vie a consisté à se déprendre de cet enfermement ; elle était là, présente au monde, et comme pour Adam, elle était coupable en naissant, elle était femme de « péchés ». Elle venait d’une mère qui l’avait abandonnée, qui vivait dans le péché (ce que le lui racontait Madame W), et qui était le péché sur terre. Libre à elle, alors, de construire sa vie, ou de l’inventer autrement ; d’où sans doute cette légende des « Oranges ».
Chapitre 4 : « Le problème avec un livre... »
« Le problème avec un livre, disait Madame W, c’est qu’on ne sait jamais ce qu’il contient avant qu’il ne soit trop tard ». Voilà pourquoi il n’y avait pas de livres à la maison. Jeannette Winterson ne comprenait pas pourquoi les livres lui étaient interdits ; elle a donc fait le choix de lire en cachette ; elle interrogeait ainsi la réalité, la vie qu’elle menait, la vie autour d’elle. « Voyons-nous ce que nous pensons voir ? Aimons-nous comme nous croyons aimer » ? Lire a sans doute été le moyen le plus important pour l’auteur de rejoindre la vie, et la comprendre ; lire a été son chemin de croix aussi dans ce sens où elle a dû faire un long voyage à la recherche du bonheur. Je pense bien sûr à Don Quichotte quand j’écris cela, qui cherchait, au travers de ses lectures, à faire de sa vie un roman de chevalerie. Mais le trajet est long, semé d’embûches, et regorgeant « d’éléments éphémères et inopinés » qui lui ont permis « d’aller quelque part où l’on ne pourrait aller autrement », et qui lui ont permis de gagner des éléments, des formes d’un autre monde (celui visité), des « trésors à grande échelle », qui ne devaient pas l’écraser, et qu’elle devait sans cesse adapter à sa taille, à sa forme. « Un livre est un tapis volant qui vous emporte loin » ; elle s’envolait ainsi vers d’autres mondes, elle gagnait ainsi des chances (une seconde chance, dit-elle ; il en restera toujours une, elle y croit) de trouver... l’amour, peut-être.
Un jour, quand elle tombe sur ces vers de T.S. Eliot, « C’est un moment/Mais sachez qu’une autre vision/vous percera d’une soudaine joie douloureuse », elle fond en larmes. Elle vient de découvrir la poésie... pour elle, un langage assez puissant pour décrire sa vie. Elle écrit : « Une vie difficile a besoin d’un langage difficile - et c’est ce qu’offre la poésie... Ce n’est pas un lieu où se cacher. C’est un lieu de découverte ».
Un jour, sa mère découvre ces livres qu’elle cachait, et elle les brûle... Sur le tas de cendres Jeanette Winterson comprend que cette réalité extérieure peut ainsi, et si facilement, être détruite. Ce qui lui reste, c’est ce qu’elle garde en soi, elle fait ce choix et elle y trouve la sécurité. Pour elle, la poésie, tout comme la fiction, sont des « remèdes, des médicaments. Elle guérissent l’entaille pratiquée par la réalité sur l’imagination ». Plus loin dans son livre, elle écrira qu’elle veut faire de sa vie une fiction. (Don Quichotte, encore lui, l’avait fait avant elle ; mais il était un personnage de fiction, créé par Cervantès. Dans ce cas, puis-je dire, on est dans la vie-fiction au carré). Elle est incertaine vers où cela va la mener ; mais elle continue de lire, amassant ainsi des bribes de vie, des fragments épars, et elle écrit de la même manière, par bribes, toujours, dit-elle, « incertaine de la continuité du récit ». Elle se rappelle Eliot qui a écrit : « Je veux de ces fragments étayer mes ruines... »
Lire des romans l’a amené à cette conclusion : « Merde à la fin, me suis-je dit, je peux bien écrire le mien ».
Chapitre 5 : « À la maison »
Sa maison est une maison étroite parmi une longue rangée de maisons mitoyennes étroites. Sa vie est celle d’enfants de la classe ouvrière du nord de l’Angleterre, un monde brutal s’il en est. « J’ai grandi sans trop m’attarder sur la douleur physique. J’avais l’habitude de frapper mes petites amies jusqu’à ce que je comprenne que c’était inacceptable. Même aujourd’hui, lors de grandes colères, je rêve de mettre KO la personne qui m’exaspère ».
Mais, sur le porte-bagage du vélo de son père, lorsqu’il l’emmène toute une journée dans la campagne anglaise, elle sait qu’elle engrange là ses souvenirs les plus heureux ; et elle aime se les rappeler. Elle aime se rappeler que son père, un taiseux, dit-elle, gardait le silence non pas tant parce qu’il n’avait rien à dire, mais parce qu’il monologuait, en son for intérieur (quoi, sur quoi ?), et qu’il se rappelait pour lui-même des souvenirs qu’il ne partageait avec personne. Il a pleuré parfois, agi en petit garçon aussi - il l’avait toujours été, écrit-elle – en fait, il ne demandait qu’à être rassuré. Jeanette Winterson se dit contrariée de ne pas s’être occupée assez de lui, de ne pas avoir su lui donner plus d’amour.
Son père, tel qu’il apparaît dans le film Les Oranges est un curieux de personnage. Taiseux, certes ; mais il apparaît davantage comme un homme dominé, complètement soumis, simplet même, presqu’un imbécile, au mieux, docile.
Jeanette Winterson a vécu seize ans dans la maison des Winterson. « Mon père était soit à l’usine, soit à l’église. C’était son schéma de vie. Ma mère était debout toute la nuit et déprimée tout le temps, C’était son schéma de vie. J’allais à l’école, je me promenais dans les collines ou je lisais en cachette ? C’était mon schéma de vie ».
Pour elle, les livres sont un foyer. « À l’intérieur, vous découvrez un temps et un espace différent ». Les livres sont son foyer, sa véritable maison. Mais un jour elle va quitter la maison des Winterson, elle a seize ans, elle va vivre sa vie, sa fiction. Et elle va écrire. C’est un choix qui a changé sa vie. Elle a pris un risque, c’est un choc, elle le sait ; et elle se rappelle aussi que, s’enfonçant dans un monde inconnu, elle a frôlé la déraison. « À cet instant, ce n’est pas une grande joie ni une gigantesque énergie qui nous envahit. Mais une profonde tristesse. Qui aggrave la situation. C’est un temps de deuil. De perte. De peur. On se mitraille de questions. On touche sa cible, on se blesse ».
Mais où va-t-elle ? Vers davantage de livres, plus de lectures, plus de mondes découverts ; mais aussi plus et toujours plus d’écriture.
« Il m’a fallu beaucoup de temps pour comprendre qu’il existe deux types d’écriture ; celle que l’on écrit et celle qui nous écrit. Celle qui nous écrit est dangereuse. Nous allons là où nous ne voulons pas aller. Nous regardons où nous ne voulons pas regarder ».
Chapitre 6 : « L’Église »
L’église a été le centre de sa vie pendant seize ans. Il faut avoir vu le film, tiré de son roman, « Les oranges ne sont pas les seuls fruits », (sa vie en images de fiction, donc exagérées) pour comprendre l’importance de cet environnement dans la vie de Jeanette Winterson. Ses souvenirs ne sont pas que noirs ; ils peuvent être cocasses, comme celui d’un débat houleux autour de la question de l’enterrement/crémation, avec ou sans les dentiers de la personne décédée. Humour anglais !
Plus profonde est sa réflexion lorsqu’elle ajoute : « J’ai vu beaucoup d’hommes de la classe ouvrière et de femmes – dont moi – vivre plus intensément, réfléchir davantage que cela n’aurait été possible sans l’église ». Elle dédouane ainsi l’église en quelque sorte. Ces gens-là n ‘étaient pas instruits, mais dans leurs discussions bruyantes, ils se creusaient les méninges, et... ils avaient alors l’impression de faire partie, d’avoir une place dans le grand schéma du monde.
Mais qui n’a pas un jour eu cette impression, ce sentiment intime, qu’il participe à la réorganisation du monde – il en était ainsi, quand je n’avais que 17 ans, et que nous avions des discussions à la taverne, autour de centaines de verres de bière, et que nous supputions sur la « preuve de l’existence de dieu » - quand on se retrouve avec des copains et que l’on parle politique ? Nous, jeunes étudiants aux études classiques, donnions ainsi un sens à notre vie ; du moins, nous avions cette impression. J’ai l’impression que ce sens du religieux et la recherche d’un but élevé, alors que l’église et la pratique des religions ont quitté définitivement nos vies, alors qu’un monde de consommation folle tente de nous harponner, ne cessent de nous coller à la peau...
Mais cette réalité églésiale, se rappelle Jeanette Winterson, n’est pas absente de contradictions. Elle est rigide, - il était interdit de boire, de fumer... - mais la camaraderie, le partage, la simple gentillesse était aussi au rendez-vous.
Dans son entourage d’âmes dévotes, Jeanette Winterson avait une tante, tante Nellie, qui n’avait pas beaucoup d’argent, qui accueillait des enfants qu’elle nourrissait si souvent, et de si bon sentiments,... et qui lui a montré « l’amour », cet sorte d’amour qui ne pose pas de conditions et que l’on attend – Jeanette Winterson attendait l’amour. Tante Nellie était un exemple, elle « donnait de l’amour en faisant sa soupe », qu’elle offrait inconditionnellement aux enfants du voisinage.
Un jour, l’amour – le sien propre – vint. Oui, un jour une fille l’a embrassée ; et elle a connu l’amour. Que pouvait-elle faire d’autre ? écrit-elle. Elles étaient comme des gamines, rêvant l’une de l’autre, insouciantes... Mais un jour, Madame W a tout découvert, un exorcisme (en bonne et due forme ; le film Les Oranges est effrayant dans ce passage) a été nécessaire, « le raid aérien a eu lieu ». Son père était malheureux, sa mère dérangée, et elle... « nous n’étions pas amantes, nous étions l’amour ». Ainsi, en était-il.
Chapitre 7 : « Accrington »
C’est là où elle vivait, une ville ancrée dans un territoire de prés incultes, plus favorables à l’élevage des moutons, mais qui vivait grâce au coton. C’est une ville pauvre ; et il y a des pauvres qui vivent pauvrement ; ainsi ces jeunes gamins, dans le bourg d’à côté – à la réputation encore plus pauvre - qui font la queue devant la fabrique de biscuits pour chiens et qui récoltent les chutes sur lesquelles ils ajoutent du sucre glace... afin de les rendre digestibles.
Pourtant, Jeanette Winterson n’a pas de mots amers pour décrire sa ville ; elle aime se rappeler qu’il y avait une vie sociale intense, autour du marché, des pubs, de l’église et de la bibliothèque. Pourtant presque tout cela a disparu, elle fait ce constat lorsqu’elle y est retourné bien des années plus tard, pour revoir – tentative assez peu fructueuse - Madame W. Il ne reste que les pubs, ajoute-t-elle.
Elle se rappelle avec une nostalgie empreinte d’une quasi adoration une brocante de chiffonnier – un des derniers vrais – où elle complétait ses achats de livres quand elle ne les trouvait pas à la bibliothèque. Et elle décrit cet endroit avec une telle verve, - pour ne pas dire un tel émerveillement – que je ne peux qu’insérer in extenso la dernière partie de son texte qui a déjà inventorié tout le bric-à-brac possible qui s’y trouvait – des landaus d’avant guerre, des animaux en peluche tout pelés, des bassins hygiéniques,... pour finalement arriver, après un parcours de combattant, à l’objet désiré...
« Si vous arriviez à vous frayer un chemin entre les lampes frangées de style victorien et les couvertures en patchwork orphelines, si vous rampiez sous les buffets en noyer sans portes et les bancs d’église coupés en deux, si vous parveniez à vous faire tout petit pour dépasser les tombes chaudes, sèches et étouffantes de lits encore tuberculeux, et les draps qui pendaient comme des fantômes – le linge perdu de ces générations de chômeurs qui vendaient tout et qui dormaient dans des sacs – tout cela pris sur le dos de la misère, et donc, si vous pouviez pousser jusque-là et au-delà des tricycles d’enfants à une roue, des chevaux à bascule sans crinière, des ballons de foot crevés avec leurs lacets croisés en cuir sale, alors vous arriviez aux livres ». (Quel morceau d’écriture !)
Et oui, encore les livres. Jeanette Winterson était mauvaise élève en classe, et elle ajoute « je ne comprenais pas grand-chose à ce qu’on me racontait. Je n’étais bonne que dans un domaine : les mots ».
Voilà qui la résume bien : un objet désiré, les livres, et les mots qui viennent.
Chapitre 8 : « L’Apocalypse »
Voici la seule éducation sexuelle que Jeanette Winterson ait jamais reçu de sa mère : « Ne laisse jamais un garçon te toucher En Bas ».
C’est peu, et c’est tout ; mais Jeanette Winterson n’y avait rien compris. Elle a donc dû apprendre par elle-même, par expérience, mais aussi par les livres ; elle veut voir plus loin que quiconque. « Ce n’était pas de l’arrogance ; c’était du désir. Je n’étais que désir, désir de vie ». Ainsi, un jour, elle rencontre, puis fréquente une fille de sa classe ; elles sont gamines, - encore ce mot si doux, si simple - mais elles s’aiment. Jeanette l’aime, et elle, aime Jeanette. « Et sa limpidité était comme de l’eau, fraîche et profonde et transparente au point qu’on en voyait le fond. Pas de culpabilité. Pas de peur ».
Sa mère réprouve ses amours lesbiennes, et lui déclare qu’elle n’est pas sa fille. Mais elle n’en a cure, « c’était presque sans importance. Il était trop tard pour ce genre de remarques. J’avais un langage propre et ce n’était pas le sien... J’évoluais dans le monde des livres et de l’amour que je m’étais créé. Le monde était pur et saisissant ».
Son langage est simple, et, lorsqu’elle explique à sa mère qu’elle est comme elle est, parce qu’elle est heureuse... sa mère lui répond : « Pourquoi être heureux quand on peut être normal » ? Tout a été consommé à ce moment-là.
Chapitre 9 : « Littérature anglaise de A à Z »
« Peu à peu, je me suis aperçue que j’avais de la compagnie. Les écrivains sont souvent des exilés, des marginaux, des fugueurs et des parias. Ces écrivains étaient mes amis. Chaque livre était une bouteille à la mer. Il fallait les ouvrir ».
La bibliothèque de sa ville possédait un exemplaire de presque toute la littérature. À seize ans, Jeanette en était à la lettre M ; elle lisait tout. Elle a découvert la poésie avec T.S. Eliot ; elle a mieux compris sa toux chronique quand elle a lu Katherine Mansfield, une tuberculeuse ; elle a compris que « Charlotte Brontë a dû appeler Jane Eyre une biographie parce qu’à cette époque les femmes n’étaient pas censées inventer quoi que ce soit » ; Lolita (Nabokov) l’a contrariée... parce que, « pour la première fois, je me sentais trahie par la littérature » ; elle a aussi eu un mal fou avec la lettre C... Lewis Carroll, Joseph Conrad, Coleridge ; elle aimait les écrits de Gertrude Stein qui semblaient ressortir de l’absurde.
Mais pourquoi lit-elle tant ?
« Lire ce qui est pertinent par rapport aux faits de votre existence est d’un intérêt limité. Après tout, les faits ne sont que des faits et le pan désirant et passionné de votre être ne s’y retrouvera pas. C’est pour cette raison que se lire soi-même autant comme une fiction que comme un fait est si libérateur ». Voilà pourquoi elle aime tant Emily Dickinson qui dans sa vie est à peine sortie de sa cour, mais qui a un imaginaire débordant, un imaginaire qui « plutôt que d’orner la vie, préfère la faire détonner ».
Gertrude Stein l’a inspirée lorsque, dans son livre L’autobiographie d’Alice Tocklas, elle a écrit : « Bonne ou mauvaise, c’est la route et nous sommes dessus ». La route, celle de Jeanette Winterson, ce sera l’université.
Chapitre 10 : « C’est la route »
Jeanette va s’inscrire à l’université D’Oxford parce... qu’il n’y avait pas de projet, pour elle, plus impossible à réaliser. Bonne ou mauvaise, c’était la route qu’elle avait choisie.
Jeanette Winterson fait ses constats :
- « Nous n’étions pas raffinés, nous étions des gens du Nord.
- J’étais une femme. J’étais une femme issue de la classe ouvrière. J’étais une femme qui souhaitait aimer les femmes sans se sentir coupable ni ridicule. Ces trois éléments servaient de base à mes idées politiques.
- Je n’avais pas de respect pour la vie familiale. Je n’avais pas de foyer. J’avais de la rage et du courage à revendre. J’étais intelligente. J’étais déconnectée émotionnellement. J’étais le prototype idéal pour la révolution Reagan/Thatcher ».
Quand elle s’explique là-dessus, elle comprend bien qu’à la fin de la guerre son pays a dû passer par des mesures quasi socialistes et d’une plus grande responsabilité collective. Cela a été capital pour que le pays se redresse. Elle adhérait à cela. Mais quand vinrent les années 70, la sortie de l’Angleterre du FMI, les querelles syndicales presqu’existentielles, la flambée des prix du pétrole,... l’Angleterre a emboîté le pas de Milton Friedman et de l’École de Chicago. Ce fut le retour au bon vieux laisser-faire de l’économie libérale. Et elle a aussi adhéré à cela.
Mais elle n’avait pas compris que l’argent devenait alors la valeur cardinale et... que Madame Thatcher financerait son miracle économique en vendant toutes les richesses et les industries de l’Angleterre. « Je n’ai pas compris les conséquences de la privatisation de la société ». Et elle se repent de cela.
Mais... elle est sur la route qui mène à Oxford, elle a été acceptée, et c’est le but. Tout le reste lui est égal.
Chapitre 11 : « Art et mensonges »
Le milieu d’Oxford est mensonge. « Durant notre première soirée d’étudiants de premier cycle, notre directeur d’études s’est tourné vers moi et a lancé : Vous êtes notre expérience issue de la classe ouvrière. Puis il s’est tourné vers la jeune femme qui allait devenir ma meilleure amie et a dit : Vous êtes l’expérience noire ». Bref le directeur était un homosexuel malveillant et les femmes ne devaient attendre aucun soutien de sa part.
Mais il est aussi Art. Enfin, elle est à Oxford, les livres l’entouraient, et elle lisait. Ce qui fait la grandeur d’Oxford, pour elle, c’est le « sérieux de son engagement et la croyance incontestée que la vie de l’esprit est au cœur de la vie civilisée ». Ainsi, plus elle lisait, plus elle se sentait liée à travers le temps à d’autres vies et éprouvait une empathie plus profonde. Elle comprend que le monde apprivoisé a besoin d’un monde sauvage, et aussi « d’un espace ouvert et libre de notre imagination ».
Elle cherche le point où sa propre vie pourrait se lier avec elle-même. « Je savais que cette quête était liée à l’amour ».
Un jour, elle se demande si le passé peut être racheté, et c’est sans doute ce qui l’a incitée à retourner voir Madame W, avec sa nouvelle copine, la noire ; sa mère en fait peu de cas, et lui offre des plats à base d’ananas, au petit déj, au déjeuner, au dîner (n’est-elle pas noire, et sauvage, et mangeuse d’ananas ?). Évidemment, ça n’a pas marché ; elles quittent Madame W. Jeanette Winterson dit « au revoir » à Madame W. Mais celle-ci « n’a pas répondu. Ni à ce moment-là. Ni plus tard. Je n’y suis jamais retourné. Je ne l’ai jamais revue ».
Écrire sur sa vie, se raconter, fusse de la fiction organisée, ne va pas de soi. Jeanette Winterson voit sa vie comme la flèche qui file dans le temps, « un trajet éclair de l’utérus au tombeau ». « Cela qui vit seulement/Peut seulement mourir », lui chuchote, croit-elle, T.S. Eliot.
Chapitre 12 : « La traversée nocturne » Elle aurait pu intituler ce chapitre : « Devenir fou prend du temps ; recouvrer une santé mentale prend du temps » »
En février 2008, Jeannette Winterson a tenté de mettre fin à ses jours.
Elle le raconte dans cette « traversée nocturne ». Cela a démarré lorsqu’elle découvre un certificat de naissance où est inscrit le nom de ses parents biologiques. Elle n’avait jamais pensé se mettre à leur recherche ; elle ne comprenait rien à la vie familiale et, comme elle l’écrit, elle ignorait que l’on pouvait aimer ses parents. Solitaire, elle s’était inventée, elle s’était créé une vie ; elle croyait en elle, point. Pour elle, il n’y a pas de début, pas de milieu, pas de fin, parce que cela ne lui semble pas fidèle à la réalité. Ainsi en est-il de son écriture ; « ce n’est pas une méthode ; c’est moi », écrit-elle.
Lorsqu’elle se sépare de sa compagne, Déborah Warner, la metteur en scène, la vie est très difficile ; son passé, qu’elle ne parvient toujours pas à « considérer », la rattrape. Il existe. On ne lui en a jamais parlé. « Pas de biographie, pas de biologie », écrit-elle. C’est l’angoisse ; elle se cherche, elle cherche aussi cet autre moi, celle qui dort en elle ; elle écrit des histoires d’amour et de perte, toute son écriture est influencée (« J’entretiens un rapport obsessionnel aux textes que j’insère ensuite dans les miens ») par son histoire. Ce sont « des histoires de désir et d’appartenance. Cela paraît si évident, aujourd’hui – les obsessions wintersoniques d’amour, de perte et de désir ».
Peu après cette découverte – l’acte de naissance – elle glisse dans la folie. « Il n’y a pas d’autre mot pour le décrire ». Elle, qui faisait du foyer – construire un foyer, à deux, et retrouver l’autre, l’aimée, le soir – sa vision du bonheur, voit qu’elle y renonce, non, qu’elle ne peut y arriver. Elle vit un calvaire quand Déborah ne répond pas à ses appels, elle ne sait pas pourquoi – la psyché est un mystère, qui se cache, et qui, pourtant, sait et ressent – mais elle se réveille en hurlant « maman, maman » ; elle annule ses rendez-vous, se désengage, elle erre dans les rues, elle s’absente du monde, de ses amis... et elle se réfugie dans la poésie, sa bouée de sauvetage, son roc ; et dans la nature également, son autre roc. Elle parle peu, « le langage m’avait désertée ».
Pourtant, une nuit, revenue la veille de Hollande, épuisée, - les sueurs qui la reprennent - elle se lève, fait un feu, mange une boite de haricots... et se met à écrire. L’histoire paraîtra le jour suivant dans le Times. L’écriture vient de la sauver, elle est portée par des « marées d’émotions », - « moi qui voulais ne surtout rien éprouver » - sa vie alors tient en équilibre sur un texte.
À cette époque, elle a aussi un autre refuge, la librairie d’une amie parisienne, Sylvia Whitman, sise face à Notre Dame. Là, « je n’allais pas mieux, j’allais moins bien ». Son amie lui offre une chambre, et surtout un refuge de livres, sa librairie ; mais également son énergie et son enthousiasme inépuisables. Jeanette Winterson est au plus mal, elle songe au suicide, elle voit clairement qu’elle ne peut reconstruire sa vie, et surtout, elle sait que le monde d’avant vient de disparaître. « J’avais fait mon temps » – celle qui était partie de chez elle à seize ans, celle qui avait tout culbuté dans sa vie, celle qui était devenu un écrivain célèbre, traversée des dépressions... « c’en était fini de cette Jeanette Winterson-là ». Mais elle rate sa tentative de suicide – son chat, avec elle dans le garage, ne supporte pas les émanations de gaz carbonique, et la griffe, la griffe, la griffe au visage.
Sa chatte, le départ de Déborah, son bref séjour dans cette libraire à Paris... tout cela – combiné, mais sans connexion directe – oui, tout cela lui offre une seconde chance dans la vie. Elle y croit. Une porte s’était ouverte, la « perte égarée » - cet autre soi – faisait un « retour furieux et invisible » dans sa vie.
« Vivre avec la vie est très difficile... vivre ses émotions exige du courage », écrit-elle. Elle est pleine d’émotions.
Jeanette Winterson entend des voix ; elle abrite en elle deux personnes, celle d’avant, celle d’aujourd’hui et à naître, et elles se parlent. « Dans ma folie, il m’est apparu clairement que je devais commencer à parler – à la créature ».
Celle d’avant récrimine sans cesse, la menace... celle d’aujourd’hui tient la route « grâce à l’équilibre mental dans lequel la maintient l’écriture le matin et la nécessité de jardiner régulièrement ». Elle n’a plus de suées... elle n’a plus peur. Pourquoi ne sont-elles pas allées en psychothérapie, ensemble, elle et la créature ? Jeanette Winterson a essayé, cela a échoué... – « Je n’arrivais pas à dire la vérité et de toute façon, elle ne voulait pas venir avec moi... elle était pire qu’un bébé ».
« Je suis donc allé en thérapie sans elle. Une perte de temps ».
Un jour, elle est toujours à la recherche de quelque chose, elle rencontre Neville Symington, un prêtre devenu psychothérapeute. Ce Symington lui offre un cadre – on n’est pas qu’un corps et un esprit, on peut aussi parler de l’âme - qui lui permet de réfléchir à ce qui lui arrive - cette part folle de son cerveau qui lui ravageait l’esprit sans cesse - et, peu à peu, elle arrive à contenir l’autre, à lui parler, à lui demander d’attendre un peu...
Quelques mois plus tard, elle et l’autre sont là, elles se promènent, elles causent ; puis elle dit « nous », pas « toi » ; elles s’assoient, puis elle dit « Nous allons apprendre à aimer ».
Chapitre 13 : « Ce rendez-vous se déroule dans le passé »
Revenue de sa dépression, Jeanette Winterson entreprend de retrouver sa mère biologique. La quête est difficile ; elle ne s’est jamais sentie voulue. Ni par sa mère biologique (rejetée dès la naissance), ni par Madame W, ni même par les critiques dont elle dit qu’ils ne voulaient pas d’elle. Elle frôle la paranoïa ; mais elle dit avoir ses raisons.
Pourtant, ce qu’on essaiera de lui dire (au service de l’adoption), c’est qu’elle était voulue, désirée, de sa mère biologique, même si cela ne tombe pas sous le sens immédiatement. Jeanette Winterson dit qu’elle ne savait pas aimer ; qu’elle avait appris à se tenir debout seule, et que lorsqu’elle parlait d’amour dans ses livres, c’était sincère.
Toutefois la procédure pour retrouver sa mère, elle la trouve odieuse : « Ce n’est pas une carte de crédit que je demande, connard ». Elle a cette impression que la vie des gens passe après la procédure.
Finalement ses recherches aboutissent : - elle comprend les raisons qui ont motivé sa mère lors de sa mise en adoption - sa mère avait alors dit : « C’est mieux pour Jeanette d’avoir un père et une mère » - à l’époque, sa mère était sans ressources, elle avait 17 ans, et le père ne voulait pas de l’enfant - elle découvre finalement que sa mère est en vie – elle la contacte – sa mère lui répond et lui envoie une photo d’elle bébé – et un mot tout court, tout simple : « Tu comprends Jeanette ? Tu as toujours été voulue ».
Chapitre 14 : « Étrange rencontre »
C’est impressionnant, Jeannette Winterson, dans ce chapitre, y va encore d’un laïus sur les « émotions », avant que d’aborder la... rencontre avec sa mère.
« Les choses que je regrette le plus dans ma vie ne sont pas mes erreurs de jugement mais mes déficiences émotionnelles... le fantasme populaire selon lequel il est possible de penser sans éprouver d’émotions perdure. Pourtant cela est impossible. Il y a de la subjectivité même quand nous prétendons à l’objectivité... Chaque fois que nous disons Je pense, nous ne laissons pas nos émotions à la porte. Dire à quelqu’un de ne pas être émotif revient à lui dire d’être mort ».
Et la rencontre avec la mère aura lieu. Étrange dit-elle ; mais je crois surtout que cette rencontre ne s’est pas passée comme elle l’avait imaginée, tout simplement. En fait il n’y a rien eu d’autre qu’une rencontre normale dans un tel cas ; et surtout, la surprise, s’il y a, est du bon côté : - Sa mère, elle s’appelle Ann, est bouleversée d’apprendre comment cela se passait dans la maison de Madame W. Jeannette lui dit que cela n’est pas grave (ce n’était pas la réponse la plus adéquate) - Sa mère est franche et généreuse (elle accepte bien que Jeanette ait une copine, plutôt qu’un mari) – Ann n’a jamais cessé de travailler, et elle a eu 4 maris – Elles discutent, Jeanette, sa copine Suzie, le frère de Ann, la sœur de Ann, et c’est facile, la rencontre dure 5 heures et, quand ils se quittent, Ann lui dit : « Je me demandais si tu essaierais de me retrouver. Je l’espérais ».
Chapitre 15 : « La blessure »
« Ma mère a dû s’arracher une part d’elle même pour me laisser partir. Il ne s’est pas passé un jour sans que je sente la présence de cette blessure ».
Mais le plus difficile à vivre dans tout cela, c’est que Jeanette Winterson ne le savait pas.
Coda
Quand Jeanette Winterson a commencé ce livre, elle ne savait pas où cela la mènerait. Elle écrivait, dit-elle, en temps réel. « J’écrivais le passé tout en découvrant l’avenir ».
Jeanette Winterson croit qu’elle a de la chance : - elle a eu cette chance de découvrir les livres, - cette chance de pouvoir étudier, - et, paradoxalement, cette chance de connaître cette vie folle et chaotique que lui a ménagée Madame W. Elle n’aurait pu devenir ce qu’elle est devenue sans cela.
« Cette histoire est véridique mais elle n’en reste pas moins une version parmi d’autres ».
« Je n’ai aucune idée de ce qui va se passer ensuite ».
Qu’est-ce que je retiens d’un tel livre ?
Je ne sais pas, c’est si plein.
D’abord, c’est crû ; en effet, l’auteur ne nous épargne aucun détail ; sa vie est un chaos. Son âme, son intelligence, ses émotions sont malmenés de telle façon (je repense encore au film Les Oranges – je dis cela parce que les images sont fortes) qu’elle n’a pas d’autre choix que de s’inventer une vie, de s’imaginer une autre vie. ET une vie qui va lui coller à la peau ; ainsi ses textes, livres, et tout le reste, prennent racine dans un imaginaire débordant. Ses auteurs préférés vivent en elles – Dickinson, Brontë, Eliot, Stein – elle les a incorporés. Il n’y a pas d’autres issues, son écriture et ses livres la sauvent, elle est LA littérature. Ce texte est un des meilleurs textes que j’aie lus.
Mais, aussi, c’est vrai. On n’a pas cette impression d’être amené en bateau. La réalité décrite – l’une d’elle, une version, dit-elle, - est trop forte ; ça ne s’invente pas des histoires comme celles-là.
Et il y a aussi ces émotions, - c’est violent - si intenses, si profondes, si fortes, - elles nous bousculent, elles nous obligent à les voir attentivement, on a l’impression de percer le personnage, on en vient à se mettre à sa place, on réagit comme elle, on devance même ses émotions, on les fait siennes ; bref on a cette impression qu’on la connaît plus qu’elle même ne peut se l’avouer – et on est en mouvement avec elles ; notre corps, notre âme, nos pensées s’agitent avec elles. On ne sait plus si c’est le texte qui nous provoque ainsi, ou si c’est nous qui imaginons tout cela. Nous sommes pris par cette « littérature » d’exception. On est dans la douleur, dans le plaisir, dans l’amour, dans le chagrin, dans les rappels incessants de sentiments cachés, passés, occultés... qui refont surface et qui broient sa vie, mais aussi notre vision de cette vie bouleversante... nous suffoquons parfois.
Voir d’autres critiques à l’adresse suivante...
